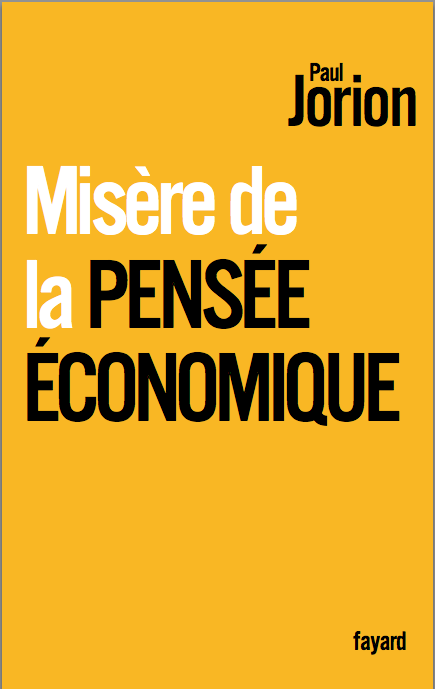-
UNIVERSITÉ D’ÉTÉ TRANS-MUTATION – « Le capitalisme à l’agonie »
-
LA LIBRE BELGIQUE, « Descendre encore les taux, ce serait jouer avec le feu », le 4 octobre 2012
Un entretien donné au quotidien La Libre Belgique.
La BCE a fait des promesses et sorti les “grands moyens” en septembre. Le soufflé n’est-il pas déjà retombé ?
Mario Draghi s’exprime toujours avec extrêmement de précision. Son langage est très prudent et compréhensible par les financiers, pas toujours par les observateurs. Il ne…
-
LES CONSÉQUENCES TRAGIQUES D’UNE HABITUDE INEPTE ?
-
STEWARDSHIP OF FINANCE, Leçon inaugurale, à Bruxelles, demain 4 octobre à 14h45
-
LE MONDE : Non au traité budgétaire européen ! Collectif de plus de 120 économistes, le 2 octobre
Non au traité budgétaire européen !
Texte original, non-modifié.
Depuis 2008, l’Union européenne (UE) fait face à une crise économique sans précédent. Contrairement à ce que prétendent les économistes libéraux, cette crise n’est pas due à la dette publique. Ainsi, l’Espagne et l’Irlande subissent aujourd’hui les attaques des marchés financiers alors que ces…
-
ARTE, France 3, mardi 2 octobre en soirée
Si l’idée que vous vous faites d’une excellente soirée, c’est de m’entendre causer dans le poste (on ne sait jamais !), ce soir vous n’aurez que l’embarras du choix :
À 20h50, sur Arte, je serai l’un des principaux intervenants dans Noire Finance de Jean-Michel Meurice et Fabrizio Calvi, un documentaire en deux parties dont…
-
MISÈRE DE LA PENSÉE ÉCONOMIQUE, DEMAIN EN LIBRAIRIE
-
LA GUERRE NUMÉRIQUE
-
LA SURVIE DE L’ESPÈCE – LE FEUILLETON (II)
-
IPSE, « La protection sociale face aux plans d’austérité », à Dublin, le 5 octobre 2012 à 14h
-
LES AUTRES NOUS ÉPATERONT TOUJOURS !
Extrait d’un article de Frédéric Joignot dans Le Monde : L’homme, cet animal suicidaire peint par Jared Diamond.
Diamond a dégagé de ses études des « collapsus » (du latin lapsus, « la chute ») « cinq facteurs décisifs », qu’il dit retrouver dans chaque effondrement, et parle d’un« processus d’autodestruction la plupart du temps inconscient ». Quels sont ces facteurs ? Un :…
-
Déclaration des citoyens européens pour une régulation effective du système financier et bancaire, par Zébu
-
Cesser le rafistolage économique, pour sortir de la crise, à la foire bio de Muzillac, samedi 29 septembre à 15h30
-
LE TEMPS QU’IL FAIT, LE 28 SEPTEMBRE 2012
-
FAUT QUE TOUT LE MONDE VOIE ÇA, NON ?