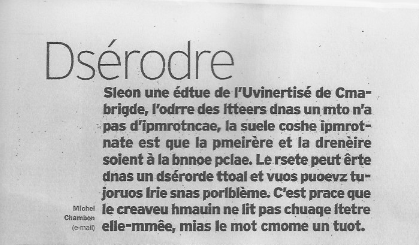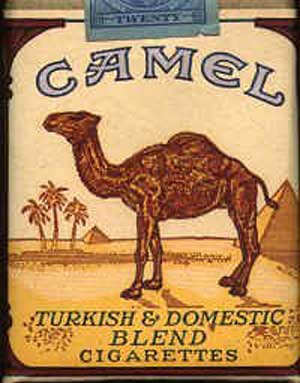-
L’APPROXIMATIF QUI NOUS FAIT HUMAINS
-
CTETE TROHIÈE TINET-ELLE DOUBET ?
-
L’EMPATHIE COMME DISPOSITION À NÉGOCIER, par Timiota
-
L’ILLUSION DU CONCEPT DE DESSEIN, par Fabien Villard
Billet invité. À propos de : LE PROCESSUS « CULTUREL » DE REPRODUCTION / SÉLECTION « NATURELLE » par Jean-Baptiste Auxiètre et Paul Jorion.
Ah le joli texte que voilà ! Enfin révélée, l’illusion du concept de dessein, aussi illusoire que celui de dieu. Tout concourt aujourd’hui à nous en convaincre :…
-
PARLER POUR SAVOIR CE QUE L’ON PENSE
Ayant lu mon texte Le secret de la chambre chinoise, publié en 1999 dans la revue L’Homme, et dont j’ai récemment résumé dans Misère de la pensée économique (pages 31 à 37) l’argument niant l’existence de l’intention et du même coup du libre-arbitre, Annie Le Brun attire mon attention sur deux petits…
-
PRINCIPES DES SYSTÈMES INTELLIGENTS (1989), chapitre 7, réédition en librairie le 23 novembre
-
TÉMOINS… PEU INFORMÉS !
-
PRINCIPES DES SYSTÈMES INTELLIGENTS (1989)
Quand, en 2008, les Éditions La Découverte ont refusé de faire un second tirage de La crise du capitalisme américain, paru l’année précédente, c’est Alain Oriot, aux Éditions du Croquant, qui a décidé de republier l’ouvrage. Alain a publié ensuite en 2010 l’un de mes manuscrits originaux : Le prix.
Je vous ai…
-
LE FAIT QUE NOUS PARLIONS
-
NOTRE CERVEAU : CONSCIENCE ET VOLONTÉ
-
Peur, incertitude, entropie et information, par Paul Tréhin
-
Un contrat social cognitif, par zébu
-
Une civilisation cognitive, par zébu
-
Pourquoi les riches se comportent si mal ?, par Tata
-
😉