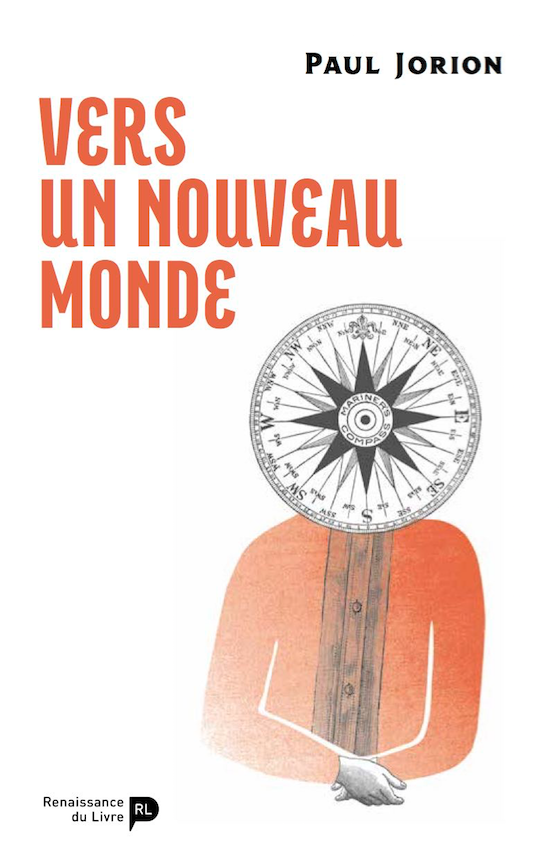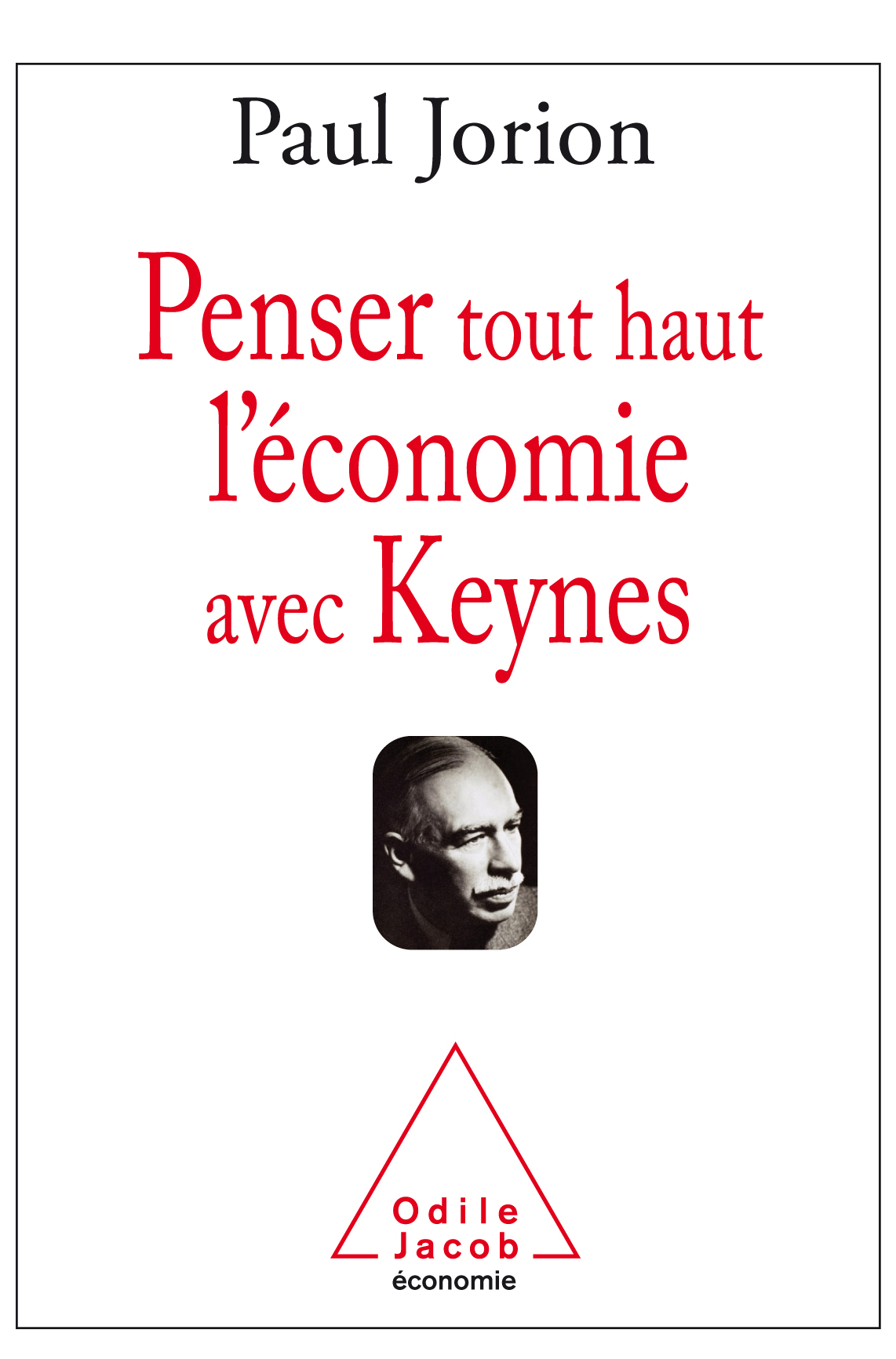-
L’Écho, Un collectif d’économistes répond : Notre modèle économique est insoutenable, le 29 mars 2023
-
De la perte de biodiversité à la rébellion des peuples
-
Université catholique de Lille, ETHICS, Cycle de 6 visioconférences : L’Après-Covid 19, 5. L’Europe et la France, le 21 octobre 2020
-
L’Écho, Paul Jorion et Bruno Colmant: « La situation est grave. En l’absence de solutions, c’est la rue qui décidera », le 22 juin 2019
Urgences Valence
Espace de libertés, « Raréfaction du travail : réinventer l’Etat-providence du XXIe siècle », par Paul Jorion et Vincent Burnand-Galpin, à paraître
Mauvais temps pour les boutiquiers !
Piqûre de rappel : L’État-providence et la croissance, le 22 octobre 2015
Quand je vous disais que nous sommes en train de gagner…
France Info – Un monde d’idées, mardi 10 novembre 2015
Monnaie et citoyenneté, par Virgile Perret
Trends – Tendances, L’État-providence et la croissance, le 22 octobre 2015
 Extrait d’un article à paraître en juin dans un magazine.
Extrait d’un article à paraître en juin dans un magazine.