En novembre 1949, à la London School of Economics, des spectateurs amusés assistèrent à une démonstration de la machine mise au point par Bill Phillips pour représenter le fonctionnement de la monnaie.
La machine reflétait les théories alors dominantes, et en particulier celle de Keynes. Le principe n’en était pas stupide puisqu’il intégrait en particulier de nombreuses rétroactions, autrement dit des mécanismes dont le fonctionnement est très difficile à se représenter a priori et qu’il vaut bien mieux simuler et observer.
Défaut immédiatement visible sur le schéma : ni capitalistes, ni entrepreneurs, ni salariés mais une catégorie unique : « income », revenus. C’était donc très mal parti et nous ne sommes donc pas autrement surpris d’apprendre que la machine de Phillips ne révolutionna pas la science économique.
Il existe encore deux exemplaires de la machine en état de marche, dont celui à l’Université de Cambridge que le Professeur Allan McRobie ressuscita et manipule pour nous en faire comprendre le fonctionnement : La machine de Phillips
Pour en savoir plus : un article de Steven Strogatz, sur le blog d’Olivia Judson au New York Times (merci à Malcolm Dean de me l’avoir signalé !).
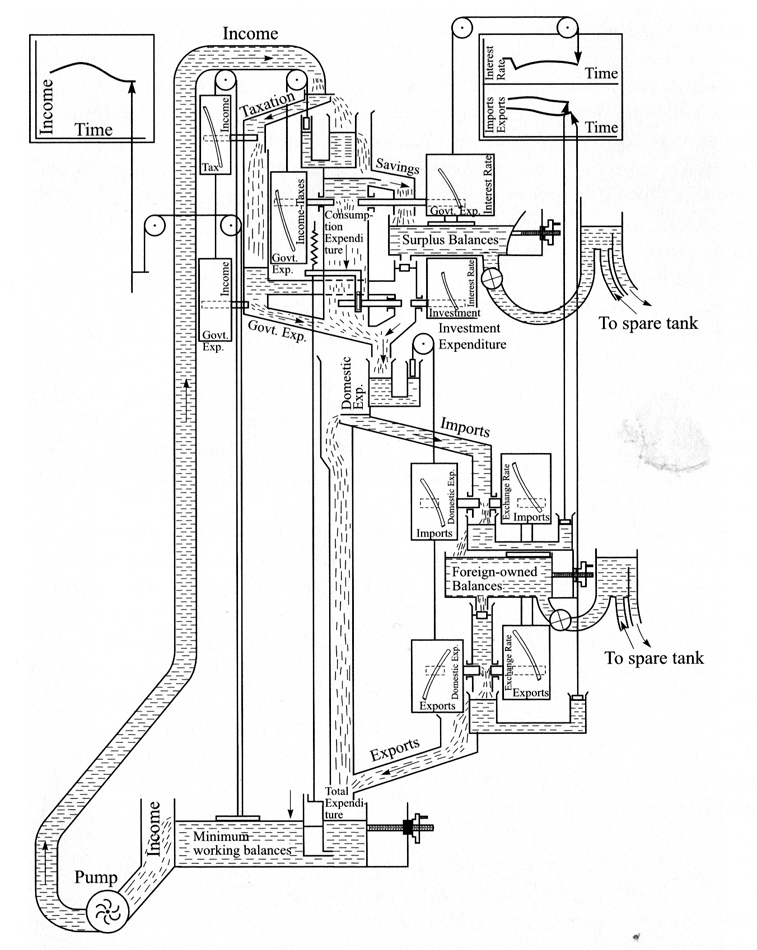
52 responses to “La monnaie : quand tout était simple…”
Pour moi qui adore les machines compliquées et rigolotes, façon Tinguely, c’est l’extase !
@paul:
si je dois « me taper ça » en anglais, je capitule!
en allemand, sivous voulez!
en fait, je crois que je capitule dans tous les cas:
pour moi, la monnaie est plus simple à comprendre, si simple que la plupart des économistes ne comprennent pas parce qu’ils cherchent midi à 14h
jf
Cela ressemble plutot a une usine a gaz (jargon d’informatition).
Ca me rappelle la procédure à suivre pour passer une commande quand je travaillais au CEA..
Des machines j’en ai étudié et j’en ai conçu, en général celles que j’ai conçues, après avoir étudié les précédentes, étaient infiniment plus simples.
Souvent les usines à gaz sont simplifiables après élagage, encore faut il évaluer les principes en oeuvre et supprimer l’inutile, l’à peu près aussi.
Plus les machines sont d’apparence complexe, plus on y perd leur finalité.
Simple suggestion : c’est peut-être là leur finalité…
…un bidule incompréhensible pour le commun des mortels, si incompréhensible en apparence qu’on s’en détourne alors que, comme le suggère jf ci-dessus, il ne faut pas aller chercher trop loin.
Merci en tout cas pour le lien et l’image.
Bonjour à tous.
Et les Shadocks pompaient….., pompaient……, pompaient……,
En pompant l’eau à l’arrière du bateau et en la rejetant à l’avant, ils espéraient repousser les limites de l’océan pour satisfaire à leur dogme sacré: » la croissance, la croissance, la croissance »…
Il existe un troisième exemplaire fonctionnel de cette machine, à Bercy….
Cordiales salutations.
pour moi , la monnaie c’est l’occupation du temps dans la communauté .
Bien sur que la finalité de la complexification a pour unique objectif de rendre le tout incompréhensible. C’est aussi un bon moyen de protéger le savoir, qu’il soit vrai ou faux, et de rende opaque se qui au depart était linpide.
A part celle de johannes finckh (à laquelle je n’adhère pas malgré son « martelage »), y a t’il eu sur ce blog, de la part de Paul Jorion, des propositions (pratiques) d’organisation du système bancaire et d’émission monétaire (monnaie banque centrale, et monnaie de dettes des banques commerciales)?
@ Anne.J
actuellement, sur ce blog, des personnes travaillent sur un projet dans ce sens
(voir à droite, la rubrique ECCE )
Le schéma de la machine de Bill Phillips me rappelle le cerveau de Rocard, vu hier soir commenter l’actualité politique et économique longuement (45′) sur TV5 (à minuit !). Pour la partie sur la crise, il a l’air de lire ce blog…
http://www.tv5.org/TV5Site/internationales/emission-13-Internationales.htm?epi_id=492&x=15&y=7
Ce genre de machine permet de comprendre 2 choses :
* les boucles de rétro-action forme ce qu’on nomme des équations non linéaires qui sont étudiées par la théorie du chaos. Sujet passionnant, et en l’occurrence, pour ceux qui connaissent un peu, l’idée serait d’identifier les variables de l’espace des phases. On en saurait alors plus sur ce qui se passe vraiment et sur les prochaines « fenêtres de stabilité » (a supposer que notre modélisation serait suffisamment correcte)
* l’aspect psychologie (psychologie des masses) joue un rôle prépondérant (tiens c’est justement à coup sûr … une variable de l’espace des phases justement).
Ce qui reviens à dire que l’anticipation économique c’est de la psychologie des masses.
Ce qui à comme corolaire, paradoxalement, qu’on peut en savoir plus sur l’avenir de la crise en interrogeant ceux qui y comprennent le moins qu’en demandant aux experts ! lol
Car ils sont le reflet le plus précis de « l’humeur des masses » en vertu même de leur ignorance.
Il est clair qu’aujourd’hui, se sont déjà produits des changements dans la psyché collective. Il n’en faudrait pas beaucoup pour un basculement majeur qui verrait la fin du capitalisme. On sait déjà que la confiance dans les banques à beaucoup diminuée, que les abus des dirigeants et autres financiers deviennent trop criants et par la même, inacceptable face aux difficultés croissantes de la (sur)vie quotidienne. La méfiance s’est instaurée, les comportements sont modifiés :la fête est finie, on se prépare, au moins par précaution pour les plus optimistes. Et pour les victimes de la crise ils viennent grossir le flot de la colère qui monte ou bien de ceux qui déçu par les promesses fallacieuses du capitalisme se tournent définitivement vers d’autres « paradigmes ».
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer ?
Si ils ne comprennent pas, ils sont nos esclaves … nous les tiendrons, ainsi il ne pourront pas se rebeller comme l’ont fait les esclaves avant eux …
C’est ainsi que ce systeme a toujours fonctionné. Par la force, une force violente du temps de l’esclavage du type de celui qu’on connu les Africains (ou bien avant eux des tas d’autres peuples depuis les temps les plus anciens)
ou par une force perverse qui vous laisse croire que ce que l’on vous donne est bon pour vous, mais de l’autre coté, on finit toujours par vous reprendre plus qu’on ne vous a donné. Mais entre le moment ou l’on vous donne et le moment ou l’on vous prend, vous vous etes tellement fait lobotomisé le cerveau par des rêves que l’on vous créé de toutes pieces que vous n’avez rien vu de la maniere dont vous vous etes fait escroqué par une bande de mafieux qui se font passé passé pour des hommes qui veulent votre bien (comme a peu près tout tout les mafieux d’ailleurs )…
Les problèmes de ce systeme sont multiples.
Le fait que chaque peuple est sa monnaie. Meme si il y a une devise dominante, la multitude des devises est inévitablement destructrices pour les uns ou pour les autres a un moment ou a un autre.
Le probleme des banques qui prennent des interets et ainsi s’assurent une prospérité certaines alors meme qu’il n’est pas certains qu’il y est une seule personne compétente dans l’entreprise.
Le problème des Etats qui prennent des Impots parcequ’il est si simple de s’enrichir en de cette maniere et d’entreprendre et de reussir sans posseder la moindre compétence dans un quelconque domaine.
le probleme des interets et de l’impot est le meme probleme que celui du racket entrepris par les mafias.
le probleme des dividendes, le probleme de la speculation sur les produits du sol.
quand les marchés comprendront qu’il faut choisir entre un placement qui fournit un revenu et un placement qui fournit a terme une plus value alors peut etre qu’ils arriveront a quelque chose.
Il n’est pas justifiable que l’immobilier monte, a moins que vous n’agrandissiez votre maison c’est la seule chose qui peut justifier une augmentation de son prix. Tout comme il n’est pas justifiable que l’on fasse monter a outrance les prix des produits du sol, produits vitaux pour les humains sur toute la surface de la terre.
La méthode consistant à comparer la monnaie avec un fluide, l’eau, et donc surtout assimiler son ‘déplacement’ à celui d’une sorte de ‘courant’ est certainement intéressante et permet d’en penser certains aspects.
Mais il est probable que ça soit également un peu limité , voire même trop simplificateur
– Ca ne rend pas compte de l’idée valeur
– Ni du fait que chaque mouvement du courant monétaire correspond à un déplacement en sens inverse d’une « marchandise » et que là se trouve une partie de la réalité.
etc …
@oppossum
déplacement d’un droit de propriété sur une « marchandise »; j’aimerais bien avoir un bilan des droits de propriété avant et après la « crise », et dès maintenant, avoir une idée des déplacements déjà réalisés.
Il va falloir trancher entre ces 3 aspects (« = » est une approximation ici):
– la monnaie = eau (« liquidité » fut aussi choisi pour cette analogie là)
– la monnaie = temps/durée (mais comment comprendre ça, ainsi que l articulation normative des idées de temps/ et de communuté).
Chose curieuse: les propriétés de l’eau dans une machine ne dépendent pas de la machine. Au contraire, c’est la machine qui est élaborée comme telel en raison même des propiétés de l’eau et de la fin pursuivie. A
u contraire, il semble que les propriétés du liquide « monnaie » sont elles-mêmes façonnées par la machine.
C’est d’ailleurs pourquoi il est impossible de décrire la monnaie sans décrire la totalité du système politique (au sens large). La monnaie n’est PAS du sang qui circule. Elle est AVANT TOUT le vecteur de circulation, le système complexe de la circulation sanguine, c’est à dire in fie le corps lui même (politique).
@ Anne.J
Je me permets de vous renvoyer aux propositions bien connues de Maurice Allais, qui ont l’avantage de la cohérence et de la simplicité.
@ JLM
Le concept de « droit de propriété » s’est évanoui, ou si l’on peut dire, a implosé dans la seconde moitié du XXe siècle. Le « droit de propriété » n’est plus, sur le plan juridque, qu’un ensemble empiriques de droits complexes, à chaque fois singuliers, sans qu’on ne puisse trouver de critère unitaire essentiel, autre que purement formel. C’est encore plus vrai en droit anglo-saxon, mais la tendance est lrgement manifeste en droit français également.
Essayez de chopper les thèses récentes en droit consacrées à ce sujet.
Si, en revanche, ce qui vous intéresse et une idée de l’évolution des transferts des « titres de propriété » (approche qualitative) depuis le début de la crise, au delà de la logique « gains »/ »pertes » (quantitative), il va vous falloir passer dans « les coulisses des coulisses » (disons un rideau encore derrière les analyses de ce blog). On est alors dans la logique des affrontements entre puissances, et plus le système économique est intégré au système politique, donc en gros plus le système est unitaire (certains pensent à la Russie ou à la Chine… donc non démocratique ou non libéral au sens stritement politique du libéralisme politique), plus les agents du « privés » et du « public » agissent en synergie, et plus les transferts stratégiques de ce type sont masqués. Le rideau ultime étant bien sûr celui dont pourrait vous parler le « clown blanc », à condition qu’il puisse faire le lien entre « pillage industriel », « blanchiment d’argent » (la crise estune formidable oportunité, une opportunité historique même pour le crime organisé, en col blanc ou pas), et investissements divers et variés dans qlqs terres et gisements d’avenir.
@antoine
j’avais lu je ne sais plus ou : la « crise » n’est pas une crise du capitalisme, c’est l’orgasme du capitalisme.
ce qui rejoint tes propos si j’ai bien compris.
D’accord pour dire qu’en dessous / derrière la monnaie, il y a la propriété, et … ceux qui la font respecter ou non ! et on reviens très loin en arrière la … lol
@ Paul Jorion
Je ne savais pas où poster cette question étant donné que les commentaires sont off sur le post « Donation ».
Est-ce que vous partagez les dons avec François Leclerc ?
L’ inflation c’ est quand il y a des bulles dans le bidule ?
J’ ai bon là ?
@anne.J
Ce 7 mai, Jean Peyrelevade écrivait dans le monde » Le métier de la banque n’est pas de prendre des risques, mais de créer de la monnaie sans risque « .
Selon la pensée « académique », les banques ne créent pas de monnaie
Pour Allais et ses émules, voici que les banques créent de la monnaie et qu’il faut leur retirer ce droit
Pour Peyrelevade les banques créent de la monnaie et doivent seulement exercer ce droit avec justesse !
Ce qui est intéressant il me semble dans cette histoire, c’est la trajectoire du changement de contexte!
J’ai le sentiment que le jeu de passe passe sémantique s’effectue sur la reconnaissance de dette transformée en monnaie… et j’avoue que j’en suis un peu malade à la pensée de tout ce qu’il nous faudra rembourser!
« J’explicite » mon sentiment: si la monnaie « c’est des dettes », et, s’il est naturel que les banques créent de la monnaie, il sera donc naturel de rembourser en monnaie les dettes créées par les banques.
Je crois donc très utile de maintenir, grâce à Paul, une distinction entre monnaie et reconnaissance de dette!
La pompe à phynance dont s’inspire Frédéric Lordon doit beaucoup ressembler à ça. Il suffirait, à côté de la « minimum working balance », (en bas à gauche du dessin), d’ajouter une sorte de « maximum humour swing » pour qu’elle plaise définitivement au « Lucini » de la finance. Pourquoi pas, après tout, puisque les financiers n’en sont pas à une absurdité près.
Après moi….le chaos a dit Charles de Gaulle je crois ?
Depuis 1968,année de naisssance de notre Fille(mai) , notre société humaine n’a-t-elle pas « évolué » ,en donnant un de violents coups d’accélérateur (1973 1980 1990 …) ,vers ce tohu bohu originel dans lequel nous sommes peut-être retournés ?
Pour retournés d’ailleurs nous le sommes tous,ô combien.!!!
« Il viendra » superbe roman de J. Attali (1994 ) est tout simplement merveilleux de prémonition.
http://www.europe2020.org/spip.php?article605&lang=fr
[PS article par Rudo de Ruijter – note PJ]
L’argent est parfois comparé au sang de l’économie. La crise du crédit a douloureusement démontré, que l’économie est dépendante d’une infusion permanente de crédits. Dès que les banques fournissent un peu moins de crédit, des entreprises font faillite et les congédiements massifs se succèdent.
On veut nous faire croire, que les problèmes avec les hypothèques subprimes étaient un incident. Avec une giga-injection de capitaux, un peu plus de règlementation et un meilleur contrôle le système bancaire fonctionnerait bien de nouveau. Et ah oui, nous devons faire confiance aux banques à nouveau.
Cause principale de la crise du crédit
La cause principale de la crise du crédit se trouve dans le système bancaire/d’argent lui-même. Le principe du système est que l’argent est mis en circulation par la fourniture de prêts et dissout au moment où ces prêts sont remboursés. Les banques occidentales se servent de deux règles de jeu :
1. par rapport aux sommes prêtées elles n’ont besoin de disposer que de 8% de capital [1] ;
2. elles doivent garder un petit pourcentage en caisse pour effectuer des paiements pour leurs clients et pour leur fournir de l’argent liquide à la demande.
Avec ces deux règles de jeu la plus grande partie de l’argent, que les clients ont sur leurs comptes de paiement et d’épargne, est prêtée. (Chez la Banque Triodos, 65% est prêté [2], chez la plupart des autres banques beaucoup plus.) L’argent prêté est dépensé par l’emprunteur et arrive ensuite sur des comptes chez d’autres banques. Les clients de la première banque disposent toujours de leurs avoirs, tandis que chez banques recevantes de nouveaux avoirs voient le jour. Grâce à l’argent reçu, ces banques-ci peuvent fournir de nouveaux prêts. Cela continue. Et à chaque fois les avoirs bancaires sont multipliés.
Ce système s’appelle « fractional reserve banking ». [3] Les banques ne peuvent satisfaire qu’à une fraction de leurs obligations. Elles ont prêté l’argent, bienqu’il puisse être réclamé immédiatement. Elles font le pari, que les clients ne demanderont jamais plus qu’elles n’ont de réserve en caisse et qu’au besoin la banque centrale viendra à leur secours. Le pourcentage que les banques n’ont pas le droit de prêter (la réserve de caisse) peut être établi par la loi (aux États-Unis c’était 1:9). Dans beaucoup d’autres pays la banque centrale fixe ce pourcentage minimum. Avant la crise, pour les Pays-Bas, j’ai lu un pourcentage de réserve de caisse de seulement 3%.
Chaque fois qu’un emprunteur dépense l’argent de son emprunt, l’argent déménage à une banque suivante, qui en profite pour fournir de nouveau prêts. Le même argent est donc prêté plusieurs fois. Dans un système de 1:9 le même argent peut être prêté 9 fois. Avec une réserve de caisse de 3% il peut être prêté 32 fois. et à chaque fois qu’il est prêté une banque collecte des intérêts.
Le risque classique pour les banques est que les prêts ne soient pas remboursés. Ce risque augmente, quand moins de nouveaux prêts sont mis en circulation que ceux qui sont remboursés. En effet, à ce moment-là, la quantité d’argent en circulation diminue. Pour le monde bancaire un environnement dans lequel la masse d’argent augmente en permanence offre moins de risques. La banque centrale veille à ce que cette masse d’argent continue de croître (l’inflation de soi-disant 2%). Au besoin, les banques peuvent emprunter de l’argent à la banque centrale contre des garanties consistant en actions ou obligations. Quand le gouvernement emprunte de l’argent la masse d’argent dans le pays augmente également. Mais la plus grande croissance est causée, bien entendu, par le facteur de multiplication, qui est réalisé par les banques elles-mêmes. Quand le facteur de multiplication augmente, les crédits peuvent être remboursés plus facilement. Les revenus des banques sont multipliés aussi. Il y a donc une tendance naturelle pour prêter des pourcentages de plus en plus élevés. En outre, les banques peuvent imposer des exigences de plus en plus élevées`aux emprunteurs pour diminuer les risques. Cependant, la conséquence de cette dynamique est que les réserves de caisse diminuent.
Les réserves de caisse servent à fournir de l’argent liquide aux clients et, surtout, aux paiements mutuels entre les comptes chez les différentes banques. Quand un client de la banque A fait un paiement à un titulaire de compte de la banque B, un peu de réserve de caisse va de la banque A à la banque B. Et dès qu’un client d’une autre banque fait un paiement à un client de la banque A, la réserve de caisse augmente de nouveau. Donc, cet argent fait des va-et-vient entre les banques. Autrefois cela prenait trois jours pour faire un paiement à un client d’un autre banque. Les banques avaient besoin de pas mal de réserve de caisse. Depuis, le système de paiements a été modernisé. Les paiements font des va-et-vient entre les banques le jour même. Chaque jour le même argent peut faire des milliers de va-et-vient entre les banques. Pour effectuer les paiements interbancaires il n’y a besoin que de très peu de réserves. Les banques ont également fait en sorte, que leurs clients n’aient plus guère besoin d’argent liquide. D’abord les employeurs ont été obligés de payer les salaires par virement sur des comptes bancaires. Tout le monde a été pourvu de chèques, de formulaires de virement, suivis de cartes bancaires et du service bancaire par l’internet. Depuis quelques années, aux Pays-bas tout au moins, les banques cherchent à nous imposer des cartes de débit (le « pin-pas ») pour toutes les dépenses modestes. (Note de MFC : En France, le même système a été commercialisé sous le nom Monéo.) Pour chaque euro que nous ne gardons pas dans notre poche, la banque peut fournir un multiple en prêts…
Bien que la croissance de la masse d’argent soit nécessaire pour diminuer le risque d’un crash du système par des prêts non-remboursés, le facteur de multiplication mène finalement à toujours plus d’instabilité et à des réserves de caisse de plus en plus petites. Dès qu’une banque essuie des pertes, cela ne diminue pas seulement son capital, mais souvent également sa réserve de caisse. Selon les règles du jeu, lorsqu’une banque arrive en dessous des 8% de capital ou lorsqu’elle n’a plus assez de réserves de caisse, elle a perdu. En 2007 ce furent les prêts hypothécaires aux conditions « privilégiées » qui causèrent l’arrêt du système, mais cela aurait aussi bien pu arriver avec des pertes sur d’autres types de prêts, comme des prêts au Tiers Monde. Les banques n’avaient tout simplement plus assez de réserves pour faire face à des pertes. Que des difficultés dans une banque se propagent vers d’autres banques, vient du fait que les banques empruntent de l’argent les unes des autres et se vendent des papiers de valeur pour optimiser la composition de leur balance. Le fait que les prêts subprimes étaient emballés comme un produit financier composé, n’a fait qu’augmenter les dégâts. Cependant, la cause principale de la crise n’était pas les pertes sur les subprimes, mais la capacité structurellement diminuée des banques pour faire face à des pertes. Et cela est la conséquence logique de la dynamique naturelle dans le « fractional reserve banking ».
Pris en otage
Dans beaucoup de pays, le gouvernement a été appelé à l’aide pour sauver les banques. Cela est remarquable, car les banques fonctionnent en dehors de tout contrôle démocratique. Ce furent les directeurs des banques centrales qui ont amené (ou dupé) les ministres des finances dans des réunions internationales et obtinrent des crédits pour les banques de montants inimaginables. Nous nous portons garants avec nos impôts futurs. Mais les banques paieraient des intérêts conformes au marché. Autrement dit, elles feront payer leurs clients : vous et moi. En fait, les ministres de finances avaient le dos au le mur. Les banques ne devaient pas tomber, car elles étaient trop importantes.
Autrefois, des parlementaires se sont désaisi du pouvoir sur l’argent. Ils n’avaient pas le moindre notion de ce que c’était l’argent, ni la moindre idée sur comment le système d’argent fonctionnait. Aujourd’hui, ce sont les banques qui déterminent combien d’argent il y a en circulation et combien la population doit payer pour ce service. Le facteur de multiplication mène également à un déplacement du pouvoir : relativement, les banquiers prennent de plus en plus de décisions d’investissement dans le pays et le gouvernement de moins en moins. Puis qu’il y a de plus en plus d’argent en circulation, de plus en plus de choses sont achetables. Cela a mené, entre autres, au démantèlement des tâches de l’état. Beaucoup de services, qui sont importants pour le bon fonctionnement de la société, comme le transport public, les postes, le téléphone, les services des eaux et de l’énergie, ont été vendus par le gouvernement à des entreprises privées, basées sur la recherche de profits. Les entreprises privées produiraient mieux. Mais, en fait, ces privatisations câchent un déplacement du pouvoir, dû au « fractional reserve banking ».
Nous prétendons toujours, que nous vivons dans une démocratie, mais le parlement n’a plus rien à dire sur un des facteurs des plus importants dans notre société : l’argent. Pour ramener le pouvoir sur l’argent à l’intérieur de la démocratie, il n’y a besoin que de quelques petits changements de loi. Hélas ! Les parlementaires de notre temps, excepté quelques-uns, ne comprennent toujours rien au système d’argent. C’est dommage, car en reprenant le pouvoir sur l’argent et avec une réforme bancaire appropriée, ils pourraient terminer la crise de crédit quaisment immédiatement. [4]
Réforme bancaire
Décrite en bref, cette réforme bancaire pourrait avoir la forme suivante : la banque centrale deviendrait une banque d’état et ferait partie du ministère des finances. Cette banque serait la seule autorisée à créer de l’argent pour des prêts. Ce serait au parlement de décider quelle sorte de crédits doivent avoir la priorité dans l’intérêt de la société. Ces prêts pourront être accordés à des conditions favorables. De cette façon le parlement aura beaucoup plus d’influence sur la forme que prend la société.
Les banques commerciales actuelles deviendraient des guichets de service pour les prêts de la banque d’état au public. Elles gèreront les comptes de paiement et d’épargne de leurs clients pour le compte de la banque d’état. Elles ne pourront plus disposer librement de l’argent de leurs clients et ne pourront plus multiplier les avoirs. Cependant, elles pourront réunir des fonds pour les prêter.
Ethique
Si le trésorier d’un club de sport local utilise l’argent à la dérobée pour l’investir et ainsi pour s’enrichir, il risque d’être condamné. Mais lorsque des banquiers gèrent les comptes de paiement de leurs clients de cette sorte, ils restent libres.
Les règles corrompues pour les banques ont leur origine dans un passé lointain, lorsque les orfèvres, et plus tard les banquiers cherchaient délibérément à tromper leurs clients. [5] La seule différence avec autrefois, c’est que le système est devenu officiel et admis par la loi. Bien entendu, cette façon de procéder est gardée câchée le mieux possible. Vous ne trouverez pas un site web d’une banque ou d’une banque centrale, qui explique clairement comment fonctionne une banque et comment est conçu le système. Dans les écoles – hormi quelques très rares exceptions – le sujet n’est pas traité et même dans la plupart des formations économiques le sujet manque dans le programme.
Surtout à partir de 1913, après l’établissement de la Federal Reserve Bank aux États-Unis, les banquiers ont réussi à obtenir un cadre légal à eux dans beaucoup de dizaines de pays et à s’approprier le pouvoir sur l’argent local. Dans chacun de ces pays une banque obtenait le rôle de banque centrale. Les noms de ces banques centrales donnent l’impression, qu’il s’agit d’établissements d’état, tandis que, tout au contraire, elles devenaient indépendantes du gouvernement et du parlement locaux, bien que parfois pas à pas : De Nederlandse Bank N.V. (1914), Bank of Canada (1935), National Bank of Danmark (1936), Deutsche Bundesbank (1957), Banque de France (1993), Bank of Japan (1997), etc. Sur leurs billets de banque il y avait souvent des portraits de rois ou d’hommes d’état. Souvent aussi l’état gardait la responsabilité de battre les pièces de monnaie, ce qui contribuait à donner l’impression que l’argent du pays était issu par l’état. Sur ces pièces également il y avait souvent un portrait inspirant confiance. Au besoin, la religion était utilisée aussi. C’est ainsi que le florin Néerlandais reçût l’inscription « Que Dieu soit avec vous » sur la tranche.
Croissance économique éternelle
Au siècle dernier, c’est grâce au potentiel de croissance économique et à la disponibilité croissante de matières premières et d’énergie, que la multiplication de l’argent ne posait pas de problème, mais, au contraire, attisait cette croissance.
Ma thèse est que le système bancaire actuel constitue un danger pour l’avenir de l’humanité. L’inflation permanente, inhérente à ce système, donne l’impulsion à toujours plus d’activité économique, pour compenser la perte de la valeur de l’unité de l’argent et pour obtenir un peu de l’argent supplémentaire mis en circulation. Et à mon avis, la croyance entêtée, qu’une économie doit croître pour être saine, vient de là. (Et non pas, par exemple, d’un penchant spontané des travailleurs pour travailler toujours plus dur.)
Une société durable, au contraire, suppose un équilibre avec notre environnement. Notre environnement ne croît pas de pair avec l’augmentation de notre activité économique et de notre population. Il s’en trouve détruit. [6] Nous devons nous débarrasser le plus rapidement possible de notre système bancaire inflationnaire et ramener le pouvoir sur l’argent là où il doit se trouver dans une démocratie : au parlement.
Pour ceux que ça intéresse, lire le papier original de Phillips : http://www.econ.puc-rio.br/Mgarcia/Modelos%20mecanicos%20em%20economia.pdf
Je conseille aussi le documentaire de Adam Curtis :
« The Pandora Box, The League of Gentlemen »
http://www.livevideo.com/video/9F912F986DDA4717A19BD9E7B7E9A488/pandoras-box-ep-3-the-league-o.aspx
Il semblerait, d’après Adam Curtis, que cette machine à été effectivement utilisé en Grande Bretagne entre l’après-guerre et le gouvernement Thatcher, avec des résultats plus que mitigés pour ne pas dire catastrophique…
C’est long mais Clair
Lu et approuvé.
Merci
Cette machine n’avait évidemment pas vocation à révolutionner autre chose que l’étude didactique des flux et interactions monétaires afin de concrétiser visuellement les résultats systèmes relevant des différents paramètres. La problématique de l’automate n’est pas d’une grande complexité comparée à ce que nos spécialistes savent traiter aujourd’hui, pour autant la machine de Phillips telle que nous la découvrons dans la démo vidéo (très sympa) est loin d’être simple, mettant en œuvre de nombreuses technologies : plus proches d’une centrale électrique et de ces réseaux de refroidissement que du système monétaire. Cela me fait penser aux travaux pratiques physiques et aux outils de démonstration utilisés lors d’études : sur les fluides, les automatismes électriques ou électroniques de notre scolarité.
Il me semble aujourd’hui qu’une telle machine peut être beaucoup plus aisément modélisée et visualisée par un logiciel offrant un nombre pratiquement illimité de variables et autorisant une visualisation équivalente en y associant seuils, alarmes, branchements conditionnels de toutes natures, action & réaction, bref tous les bienfaits de la simulation informatique.
Bienfaits qui auront coûté la mise à l’écart de 80-90% des équipes d’ingénierie de tests et d’essais (climatiques, aéronautiques, électroniques, nucléaires…)
Alain
@ Crystal
Je connais la situation de François Leclerc qui, ayant ses propres sources régulières de revenus, est très différente de la mienne. Il m’a fait savoir dès le début de sa présence sur le blog comme contributeur que son statut d’invité est, à ses yeux, sa propre gratification. A la vue de votre message, il vient de me le réitérer.
ah, la source de ses rêves nus
séquelle des haltères
je n’en suis pas revenu
iGor milhit : pas mal du tout, surtout les deux premiers vers.
@Paul :
Je profite de l’exposé sur cette machine à gaz pour vous féliciter de votre intervention radiophonique (!), et en passant je me demandais si vous aviez remarqué que dans le schéma anatomique que vous exposez là ; il y’avait plusieurs tuyaux, plusieurs réservoirs (c’est compréhensible, puisque l’argent doit être compliqué !) mais qu’une seule POMPE (pump) ! Du coup je vous soupçonne d’élaborer dans votre blog l’anatomie de cette « pump », soit la pompe à fric nécessaire à la civilisation libérale … Sachez que c’est très vilain ! 🙂
@ tous
un lien qui me semble intéressant sur le mécanisme de la création de la monnaie.
http://www.chomage-et-monnaie.org/Documents_html/QRFAQCreationMon.html
@ Paul Jorion
Merci !
J’apprécie beaucoup ce système. A l’usage je trouve que c’est un bonne idée.
Je me demandais juste si à partir d’une certaine somme d’autres contributeurs pouvaient en profiter.
Amicalement.
@Sylvie (8 juin 10h12) et Le Naïf (8 juin 14 h 14)
Merci, mais comme je suis curieuse c’est la clarification de la position de Monsieur Jorion qu’il m’intéresse de connaître (qui doit émettre la monnaie, quelle monnaie, quels intérêts, rôle des banques privées, rôle de la banque centrale, rémunération de l’épargne, etc ?). Les position d’Allais sont connues, quand à ECCE, à part quelsues débats et des liens sur ce blog, pas vu de propositions (pour le moment sans doute)
@ Anne.J
Je vais commenter le texte d’Allais auquel vous renvoyez.
@Paul Jorion
Je suis impatiente… votre point de vue sera de toute façon très intéressant.
Ybable a écrit
« La banque centrale deviendrait une banque d’état et ferait partie du ministère des finances. Cette banque serait la seule autorisée à créer de l’argent pour des prêts. Ce serait au parlement de décider quelle sorte de crédits doivent avoir la priorité dans l’intérêt de la société. Ces prêts pourront être accordés à des conditions favorables. De cette façon le parlement aura beaucoup plus d’influence sur la forme que prend la société »
J’ai lu attentivement votre exposé. Je relève ce point su lequel j’attire votre observation.
Je suis , comme vous , démocrate. Mais , sans partager le dégoût et le malaise que beaucoup éprouvent devant le système démocratique qui donne l’impression d’être de pure forme, je partage l’impression que plus on ‘monte’ dans les institutions , plus la possibilité d’une alternative parait difficile. A un certain niveau il devient difficile de faire bouger les choses.
Je pense que ce ne sont pas toujours les hommes au pouvoir qui en sont responsables, mais aussi la société civile qui demande à la fois le beurre, l’argent du beurre, et en prime le sourire de la crémière, tout en lorgnant sur son cul.
Donner le pouvoir total (Car tout de même la ou les puissances publiques ont encore en main quelques leviers …) à l’Etat pour réguler le flux monétaire , c’est faire entrer la création monétaire dans le cercle de la démagogie, du clientélisme et de la facilité , en la soumettant au caprice de l’opinion . Je rappelle que les Etats, dans leur ensemble se sont montrés extrêmement laxistes dans les politiques d’équilibre budgétaires, si bien qu’à présent ce keynesianisme institué et répété leur a ôté toute marge de manœuvre !
Et c’est donc , de plus , faire rentrer la politique monétaire entièrement dans le cercle d’une certaine impuissance et d’une absence d’alternative.
Enfin fixer l’attribution des crédits à quelques fonctionnaires d’Etat , c’est surestimer largement les compétences , la clairvoyance et la capacité à analyser les multiples aspects de l’économie pour optimiser les choses.
Je ne dit pas que le ‘marché’ soit parfait, mais à moyen terme, à un moment donné, correctement entretenu et régulé (soit en plus , soit en moins) , il n’est plus manipulable : il n’est pas une solution complète mais il est au moins un thermomètre , un alerteur .
@Opposum
Le texte n’est pas de moi, j’ai mis l’URL source juste avant, mais je l’ai trouvé suffisamment pertinent par rapport au sujet pour le coller ici.
3 remarques :
* la naissance du capitalisme conjointe avec l’idée de « main invisible du marché » c’est exactement la solution imaginée pour pallier à ce problème de dérive institutionnelle sur les affaires monétaires qui a été constaté de longue date. C’est pour cette raison que les USA s’accrochent tellement au libéralisme, en tant que « terre de liberté », ils ne veulent plus de l’interventionnisme de l’état concernant les affaires monétaires. Il est regrettable que cette belle analyse que j’ai posté fasse fi de l’histoire économique, du moins sur ce point. Donc bien sûr, proposer un retour en arrière n’est clairement pas une solution envisageable. Mais qu’avons nous à proposer à la place ?
* Nous avons un vrai problème de fond. Adam Smith (je résume/simplifie un peu l’histoire) à imaginé le capitalisme pour enlever une partie du pouvoir aux puissants et le redonner au marché, espérant ainsi assurer une meilleure redistribution des richesses et des libertés. Mais il avait prévenu demblé : le corporatisme est une menace pour le marché. D’ou les lois anti-trust. Mais nous voyons bien aujourd’hui que des groupes d’intérêts se sont emparés de ce « pouvoir » repris aux puissants seigneurs de l’époque, et qu’ils n’en font pas meilleur usage. Malheureusement, le capitalisme possédait en lui les germes de sa propre destruction, puisque, sa nature même favorise l’émergence, la croissance, et l’installation durable de ces « corporations ».
* Concernant la démocratie, je vous invite à lire : http://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/la-france-est-elle-une-democratie-57203
L’idée que la France est une démocratie est généralement acceptée par la plupart des observateurs, en particulier à l’étranger, sans que la question fasse débat. Il est cependant permis d’examiner cette assertion en détail, et les choses nous apparaissent alors moins nettes.
La démocratie consiste en un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. « Par le peuple », la chose paraît difficile lorsque l’on parle de nations comptant des millions de citoyens – bien qu’à la vérité, l’expérience n’ait jamais été tentée – voici pourquoi la France a fait, comme tous les autres pays, une entorse à ce principe en y substituant le gouvernement « par les représentants du peuple ». C’est ce que l’on appelle la démocratie indirecte. Les citoyens élisent donc librement ceux qui vont porter leur parole au sein d’une assemblée où ils débattront. Ce système est en soi imparfait, car bien sûr, celui que j’élis, par exemple, parce que ses opinions sont proches des miennes en matière économique n’aura pas nécessairement les mêmes idées que moi en matière de défense, de moeurs, de diplomatie, etc… Se rajoutent à ce défaut ontologique trois biais spécifiques au cas Français.
– En premier lieu, l’assemblée dont nous parlons n’a de compétence qu’en matière de pouvoir législatif. Le pouvoir exécutif rend des comptes au Parlement, mais les ministres ne sont pas élus par le peuple. De fait, ce n’est le cas nulle part dans le monde, la situation Française se caractérisant du reste par un degré de démocratie légèrement supérieur à la moyenne en ceci que le Président de la République, qui exerce de fait les fonctions de chef de gouvernement, est directement élu par les citoyens. Notez enfin que le pouvoir judiciaire, entre les mains de fonctionnaires de carrière, est largement hors de portée du suffrage populaire, et que la souveraineté du peuple ne s’y exerce que par le rare et folklorique truchement des jurys d’assises.
– En second lieu, le pouvoir législatif du Parlement est strictement encadré par l’exécutif, qui décide de l’ordre du jour de l’Assemblée Nationale. Les députés n’ont donc aucun moyen de débattre d’un sujet qui n’aurait pas l’agrément du Président de la République, une spécificité Française qui réduit considérablement la souveraineté et la crédibilité du Parlement.
– Enfin, le parlement se compose de deux chambres, l’Assemblée Nationale et le Sénat. Ce dernier n’est pas élu au suffrage universel, mais par le vote des « grands électeurs », principalement les maires. Ce système avait, à l’origine, pour unique objet d’empêcher la gauche d’arriver au pouvoir, en donnant autant de voix à quelque obscure bourgade agraire du bocage Normand qu’à Paris et ses hordes d’ouvriers bolcheviques. Ce système à l’antidémocratisme patent est toujours en place de nos jours, car il est impossible de réformer la constitution sur ce point sans avoir l’aval du Sénat…
Dans la pratique, le Parlement n’a que le pouvoir de voter servilement les lois qui lui sont proposées par le gouvernement ou, de plus en plus souvent, directement par les groupes de pression économiques ou moraux qui font le siège du Palais Bourbon. Lorsque le parlement vote mal, on le fait revoter, comme on l’a vu récemment.
Il n’existe que peu de reliquats de véritable démocratie dans la pratique du pouvoir. Les citoyens ont rarement voix au chapitre. Souvenons-nous que le dernier référendum national date de quatre ans – la pratique du référendum local étant très marginale – et que l’actuel Président de la République s’était fait fort, durant sa campagne, de n’en organiser aucun durant son mandat, sous prétexte que le peuple est bête et qu’il ne comprend pas les questions qu’on lui pose. On ne saurait mieux faire l’éloge de l’oligarchie. En somme, tout se passe comme si la démocratie « à la Française » consistait à se déplacer au bureau de vote une fois tous les cinq ans, et à obéir servilement le reste du temps.
Cela pourrait effectivement passer pour une sorte de démocratie, dévoyée, mais enfin, qui aurait sauvegardé l’essentiel : le choix du peuple. Mais là encore, dans la pratique, tout s’est mis en place depuis des années pour réduire la pertinence de ces choix, toujours en raison du fait que le peuple est bête et mal éduqué et qu’il ne connaît pas son intérêt, la preuve, c’est qu’il ne vote pas comme on veut. Qui se souvient du référendum sur le quinquennat ? Sous le premier mandat de Jacques Chirac, celui-ci avait eu l’idée brillante – qui traînait en fait dans l’air depuis un bon moment – de ramener le mandat du Président de la République de 7 à 5 ans. Voilà qui va dans le bon sens, bêla-t-on alors de conserve, car cela signifiait que l’on aurait le droit de choisir plus souvent ceux qui nous gouvernent. Mais il n’en a rien été, et voici pourquoi. Jadis, le mandat du Président étant de sept ans et celui des députés de cinq seulement, ils se retrouvaient décalés. Au cours d’un septennat, on pouvait donc changer deux fois ceux qui nous gouvernaient, la première fois à la Présidentielle, la seconde cinq ans plus tard aux Législatives. En moyenne, l’élection décisive se déroulait donc tous les 3,5 ans. Avec le quinquennat, les deux élections étant synchronisées, on ne vote qu’une fois tous les 5 ans. Le voyez-vous mieux, le progrès démocratique ? De fait, si on examine les évolutions constitutionnelles intervenues ces vingt dernières années, on s’aperçoit qu’il n’y a jamais eu la moindre avancée ayant permis de redistribuer un peu de pouvoir au peuple. Ou plutôt si, il y en eut un : en 2005, on avait inclus un – dérisoire – alinéa pour obliger à passer par voie référendaire lorsqu’il s’agirait de ratifier toute nouvelle adhésion d’un pays à l’Union Européenne. C’était pour rassurer les Français au sujet de la Turquie. L’alinéa en question a depuis mystérieusement disparu à l’occasion du dernier chambardement constitutionnel voulu par le Président Sarkozy (c’était officiellement pour moderniser les institutions, on ne voit pas bien le rapport).
Du point de vue institutionnel, tout est fait pour protéger de plus en plus les élus contre les méfaits du suffrage universel. Mais les institutions ne sont pas tout, il y a aussi, et surtout, les usages, le contexte social dans lequel s’opère le choix du peuple. Ainsi, la liberté d’expression est-elle généralement considérée comme nécessaire à la pratique démocratique, car seul un citoyen bien informé peut voter en connaissance de cause. Cette liberté est garantie par la Constitution. Sauf dans certains cas prévus par la loi afin d’éviter des « abus ». Quels sont ces cas ?
– Injure
– Diffamation
– Divulgation d’éléments relatifs à la vie privée
– Divulgation de données fiscales
– Entorse à la propriété intellectuelle
– Négation de génocide
– Citation de marque commerciale dans un medium grand public
– Dénigrement de marque commerciale
– Pédopornographie
– Incitation à la haine raciale
– Non-respect de la présomption d’innocence
– Non-respect du secret de l’instruction
– Non-respect du « droit à l’image »
– Apologie du suicide, de la torture, de délits divers…
– Infraction au secret défense
– etc…
Il n’aura échappé à personne que si vous désirez empêcher quelqu’un de s’exprimer et que vous avez de l’argent à y consacrer, vous trouverez toujours dans cette liste non-exaustive au moins un moyen de faire taire le gêneur. Néanmoins, la Constitution garantit votre droit à la liberté d’expression. Il suffit juste que ce que vous avez à dire ne cause de chagrin à personne.
Cet arsenal juridique est d’autant plus ubuesque que dans les faits, les principaux organes de presse ont, depuis quelques années, tous basculé dans le giron de grands groupes industriels et financiers, amis et associés de l’actuel pouvoir, ce qui permet de s’interroger sur leur indépendance. L’enquête de fond n’ayant jamais été la spécialité de la presse Française, on comprend que l’Etat n’a, en somme, rien à craindre de ce côté là. C’est donc uniquement à destination des particuliers que l’on a, année après année, organisé cet étouffant système du « vous êtes libres de dire que vous êtes d’accord avec nous » qui conduit invariablement à nous donner le choix, à chaque élection, entre l’énarque de droite et l’énarque de gauche, qui sont d’accord sur tout et mèneront, avec des nuances de pure sémantique, des politiques indiscernables.
Plus on s’interroge sur la pratique démocratique dans notre pays, plus on est contraint de constater que le gouvernement « par le peuple » n’est pas à l’ordre du jour, et historiquement, il est vrai qu’il l’a rarement été. Qu’en est-il alors du gouvernement « pour le peuple » ? Car si la France de de Gaulle et Pompidou ne valait guère mieux en matière de censure et de respect des formes démocratiques, au moins peut-on créditer les hommes d’état de ce temps d’une certaine efficacité dans leur gouvernement. N’ont-ils pas relevé la France de ses ruines, et bâti un des pays les plus prospères du monde sur le socle d’une solide indépendance nationale ? Les années 50 et 60 n’ont pas manqué de scandales et d’affairistes, pourtant, on construisait, on entreprenait, on bâtissait l’avenir en investissant dans l’innovation et la jeunesse. En somme, si les institutions étaient déjà imparfaites, les politiciens de cette génération, issus de la guerre et de la résistance, étaient dotés d’une qualité morale et intellectuelle suffisante pour n’en point trop tirer profit à leur avantage personnel.
On ne peut certes pas en dire autant de la génération actuellement au pouvoir.
à Ybabel [08:24]
YASUA.
Il Y A Surement Une Alternative décente qui respecte la Constitution existante.
J’en ai la certitude.
Paul va commenter Allais … retour des guerres de religions! 😉
[Duhem, La Théorie physique, Vrin, p. 108-109 ]
Toute cette théorie de l’Électrostatique constitue un ensemble de notions abstraites et de propositions générales, formulées dans le langage clair et précis de la Géométrie et de l’Algèbre, reliées entre elles par les règles d’une sévère Logique; cet ensemble satisfait pleinement la raison d’un physicien français, son goût de la clarté, de la simplicité et de l’ordre.
Il n’en va pas de même pour un Anglais; ces notions abstraites de point matériel, de force, de ligne de force, de surface d’égal niveau potentiel, ne satisfont pas son besoin d’imaginer des choses concrètes, matérielles, visibles et tangibles. Un physicien anglais dit que: «Tant que nous nous en tenons à ce mode de représentation nous ne pouvons nous former une représentation mentale des phénomènes qui se passent réellement». C’est pour satisfaire à ce besoin qu’il va créer un modèle.
Le physicien français ou allemand concevait, dans l’espace qui sépare les deux conducteurs, des lignes de force abstraites, sans épaisseur, sans existence réelle; le physicien anglais va matérialiser ces lignes, les épaissir jusqu’aux dimensions d’un tube qu’il remplira de caoutchouc vulcanisé; à la place d’une famille de lignes de forces idéales, concevables seulement par la raison, il aura un paquet de cordes élastiques, visibles et tangibles, solidement collées 1 par leurs deux extrémités aux surfaces des deux conducteurs, distendues, cherchant à la fois à se raccourcir et à grossir; lorsque les deux conducteurs se rapprochent l’un de l’autre, il voit ces cordes élastiques les tirer, il voit chacune d’elles se ramasser et s’enfler; tel est le célèbre modèle des actions électrostatiques imaginé par Faraday, admiré, comme une œuvre de génie, par Maxwell et par l’École anglaise tout entière.
L’emploi de semblables modèles mécaniques, rappelant, par certaines analogies plus ou moins grossières, les particularités de la théorie qu’il s’agit d’exposer, est constant dans les traités de physique anglais; les uns en font seulement un usage modéré; d’autres, au contraire, font appel à chaque instant ces représentations mécaniques. Voici un livre destiné à exposer les théories modernes de l’électricité, à exposer une théorie nouvelle; il n’y est question que de cordes qui se meuvent sur des poulies, qui s’enroulent autour de tambours, qui traversent des perles, qui portent des poids: de tubes qui pompent de l’eau, d’autres qui s’enflent et se contractent; de roues dentées qui engrènent les unes dans les autres, qui entraînent des crémaillères; nous pensions entrer dans la demeure paisible et soigneusement ordonnée de la raison déductive; nous nous trouvons dans une usine.
Bien loin que l’usage de semblables modèles mécaniques facilite l’intelligence d’une théorie à un lecteur français, il faut au contraire à celui-ci, dans bien des cas, un effort sérieux pour saisir le fonctionnement de l’appareil, parfois très compliqué, que l’auteur anglais lui décrit, pour reconnaître des analogies entre les propriétés de cet appareil et les propositions de la théorie qu’il s’agit d’illustrer; cet effort est souvent beaucoup plus grand que celui dont le Français a besoin pour comprendre dans sa pureté la théorie abstraite que le modèle prétend incarner.
L’Anglais, au contraire, trouve l’usage du modèle tellement nécessaire à l’étude de la Physique que, pour lui, la vue du modèle finit par se confondre avec l’intelligence même de la théorie.
@contrarement à ce qu’affirme ybabel, le banques ne créent jamais de monnaie! Cela ne serait pas du tout sérieux!
A mon sens, toutes ces considérations sur le « multiplicateur sont totalement inutilisables et inutiles!
La branqueprête … ce qu’elle emprunte, soit aux déposants, soit sur le marcé interbancaire!
Ce qu’elle reçoit en provision de la BC reste dans ses fonds propres et n’est, en principe, pas destiné aux prêts. Ainsi, les considérations autour des réserves fractionnelles ne tiennent pas davantage la route!
jf
@ Mr Ripley s’amuse
La grande différence entre l’économie et la physique est que, d’une manière générale, les lois de la physiques sont stables et que, lorsqu’elle ne le sont pas, parvenir à une modélisation plus générale pour retrouver cette stabilité est un but légitime de la science.
Rien de tel en économie. Les lois de la monnaie ne sont pas stables. Elles ne sont pas une donnée du processus mais un résultat. Les lois de la monnaie ont changé lorsque le système de Bretton Woods a été institué, puis à nouveau lorsque l’étalon-or pour le dollar a été abandonné. Elles ont changé plus récemment lorsque le financement d’état est devenu le business model majoritaire des banques occidentales et peut-être à nouveau lorsque (Paul Jorion a parlé alors de la fin du capitalisme) la Fed et la BoE ont décidé d’émettre de la monnaie pour financer l’état.
L’article cité par Ybabel
http://www.europe2020.org/spip.php?article605&lang=fr
est de Rudo de Ruijter. Citez vos sources SVP !
Un article de Simon Johnson:
http://contreinfo.info/article.php3?id_article=2753
Brrrrr on n’est pas sorti de l’auberge
autant pour moi !
j’ai cité aussi l’article a la suite du lien : http://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/la-france-est-elle-une-democratie-57203
qui est l’article intitulé « La France est-elle une démocratie ? » par « Asp Explorer »
et donc, je précise, si ce n’était pas clair, que ce que j’ai écrit sur la démocratie n’est pas de moi, mais provient du lien que j’ai mis en guise d’intitulé de ma citation.
@johannes finckh :
Vous avez raison, les banques ne créent jamais de monnaie, si, comme à votre habitude, vous limitez le terme « monnaie » aux billets de banque ou aux comptes des banques commerciales en banque centrale.
Par contre, et bien évidemment, les banques commerciales créent de « leur » monnaie (celle, scripturale inscrite sur votre compte en banque, que vous utilisez tous les jours en payant en C.B. ou par chèque), lorsqu’elles émettent un crédit ( ce que Paul Jorion nomme » reconnaissance de dette » ), augmentant l’ensemble de ce que les économistes nomment eux – peut être à tort – « monnaie » (dans le sens de « masses monétaires ») , car « les crédits font les dépôts«
@ johannes finckh
Après autant de mois de discussions sur la monnaie, c’est un peu court comme réponse !
Si l’on vous suit : dépôts prêtés par les déposants + emprunts à la BC = montants des prêts aux emprunteurs
C’est ce qu’on devrait trouver dans les bilans des banques et ainsi il n’y aurait donc pas de problème.
Les quelques tableaux bancaires que j’ai consultés montrent en général un rapport, entre les deux membres de l’équation, supérieur à un, voire très supérieur à un : c’est donc une illusion ? Comme la crise, je suppose.