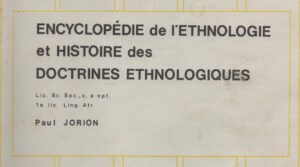
La Cambridge Anthropological Expedition to the Torres Straits de 1888
A paru dans les notes de mon cours Encyclopédie de l’ethnologie et histoire des doctrines ethnologiques publiées aux Presses Universitaires de Bruxelles en 1979, pp. 31-34.
La présence de l’« anthropologiste » François Péron (1775-1810) au sein de l’expédition du Commandant Baudin aux Terres Australes de 1800 à 1804 constituait un évènement isolé au début du XIXe siècle car jusqu’à la fin du siècle le travail de terrain en anthropologie devait demeurer exceptionnel. On pourrait se demander comment il est possible que les anthropologues aient pratiqué aussi longtemps leur recherche sans que la pratique du terrain leur soit apparue comme une condition indispensable. Dans ces termes, la question est cependant mal posée car elle implique que la récolte de données relatives à la vie des communautés « primitives » ait de tout temps pu apparaître comme susceptible d’apporter les réponses aux questions que l’anthropologie se posait. En fait, et la chose va de soi, le terrain anthropologique ne devient véritablement indispensable qu’à partir du moment où l’anthropologie commence à se confondre avec une « sociologie des sociétés sans écriture ni machinisme ». Tant que l’anthropologie est définie comme une « histoire naturelle de l’homme » au double sens de classification des « races » humaines et d’histoire des populations humaines, d’autres données que « sociologiques » s’imposent et, étant de récolte plus aisée que la pratique de l’observation directe, retiennent toute l’attention des anthropologues.
Remarquons tout d’abord, la chose mérite d’être notée, que les options polygéniste et monogéniste, qui constituent des paradigmes concurrents, ne sont nullement symétriques, et en particulier, font appel à des données empiriques de types différents. L’anthropologie polygéniste prolonge purement et simplement le projet classificateur de la botanique et de la zoologie. L’approche est synchronique et vise à déterminer sans équivoque les limites des différentes « espèces » humaines. Les données empiriques recherchées sont d’ordre physique, et c’est la craniologie qui constituera le noyau fort de cette anthropologie polygéniste (plutôt que « physique »). L’approche est aussi résolument « réductionniste », les comportements, l’éthologie des différentes espèces humaines (les « races ») étant censés être totalement explicables à partir de ces différences dans le physique. De ce point de vue, toute idée d’ « unité de l’homme » est une illusion dangereuse.
Pour le monogéniste au contraire, la question de la classification des races se pose avec beaucoup moins d’acuité puisqu’il ne s’agira jamais que de classer des variétés et non des espèces différentes mais, comme l’unité de l’homme semble démentie par l’actuelle dispersion des populations humaines, la tâche principale du monogéniste consistera dans la démonstration de cette unité. Celle-ci ne peut être que diachronique et sera nécessairement historique dans sa tentative de reconstruction des péripéties de la dispersion à partir du premier couple. Du point de vue monogéniste, la classification ne sera jamais qu’instrumentale et provisoire, puisqu’elle cache la réalité, l’unité de l’homme. Les données empiriques susceptibles d’être utilisées sont d’abord philologiques, puis lorsque la réalité de l’ « antiquité de l’homme » aura été établie par Boucher de Perthes (Jacques Boucher de Crèvecœur – 1788-1868), les données archéologiques et paléontologiques deviendront prépondérantes. Ce qu’il faut retenir, c’est que la victoire du parti monogéniste, rendue décisive par le renfort des darwinistes, signifie la victoire d’une approche historique de l’anthropologie sur l’approche biologique. D’autant qu’une certaine anthropologie prônée par Paul Broca et centrée sur la physiologie du cerveau se détache du corps de l’anthropologie, d’une part, du fait de sa complexité, rapidement apparue, qui en fait un champ de recherche à soi tout seul, d’autre part, du fait que cette neurophysiologie naissante, s’intéresse surtout à l’homme individuel, domaine traditionnel de la médecine.
Ce seront les excès de l’histoire spéculative, tant diffusionniste qu’évolutionniste, qui jetteront provisoirement le discrédit sur l’ensemble de l’histoire spéculative. Le fonctionnalisme, à partir de la constatation banale que les sociétés primitives ne sont pas absurdes au point de ne pas fonctionner, imposera l’enquête de terrain prolongée, dite « étude sociologique approfondie ».
Ce ne sera toutefois que progressivement que s’imposera ce nouveau type d’enquête qui ne sera pas réalisé, mais promu, par les participants de l’expédition aux Îles du Détroit de Torrès (chapelet d’îles entre la péninsule du Cap York en Australie et la Nouvelle-Guinée. Le Détroit doit son nom à Luis Vaez de Torres qui le découvrit en 1606), et ce sera parmi leurs élèves que se trouveront ces premiers « sociologues » des sociétés « primitives ».
En fait, comme l’a fait remarquer Penniman, la CAETS s’inscrira d’abord sous le signe de l’archaïsme avant d’apparaître comme une entreprise d’avant-garde, l’origine de l’expédition résidant dans un voyage d’étude effectué par A. C. Haddon, seul, dans les îles du Détroit de Torrès, en 1888 en tant que zoologiste uniquement. Alfred Cort Haddon (1855-1940), alors professeur de zoologie à Trinity College, Dublin, rêvait d’entreprendre un périple, tel celui de Darwin sur le Beagle, ou de Huxley sur le Rattlesnake, entreprises alors scientifiquement démodées.
En 1888, Haddon se rendit donc dans les Iles du Détroit de Torrès pour étudier les coraux de la Grande Barrière, problématique assez servilement darwinienne. Pour rentrer quelque peu dans ses frais, il ramena de son expédition quantité de « curiosités », entre autres une collection de crânes décorés (sa fascination pour les crânes, qui est représentée dans son portrait qui orne la bibliothèque d’anthropologie qui porte son nom à Cambridge, lui valut le surnom de « chasseur de têtes »). Il se mit à publier quelques articles relatifs aux mythes des indigènes des Iles du Détroit de Torrès, et après quelque temps abandonna la zoologie au profit de l’anthropologie ; c’est ainsi que, toujours à Dublin, il voulut organiser une enquête ethnographique sur toute l’Irlande, et écrivit personnellement un essai sur les habitants des îles d’Aran, plus tard immortalisés par le cinéaste Flaherty. En 1893, il établit sa famille à Cambridge, décidé à chercher fortune là, tout en n’abandonnant pas son poste de professeur à Dublin. C’est alors qu’il conçut le grand projet auquel son nom resterait attaché, la Cambridge Anthropological Expedition to the Torres Straits.
Dès son retour en Angleterre en 1889, Haddon s’efforça de mettre sur pied une nouvelle expédition, anthropologique, ou plutôt psychologique, cette fois. Son obsession était que certaines coutumes des indigènes du Détroit des Iles de Torrès allaient disparaître sans avoir été enregistrées ; il revient sans cesse sur ce thème dans de nombreux articles au titre parfois aussi explicite que celui-ci : « The Saving of Vanishing Knowledge » (1897). Non sans peine, et malgré la mauvaise volonté de l’Université de Cambridge, il parvint à réunir les fonds nécessaires à l’expédition en 1898. Les membres de l’expédition étaient outre Haddon lui-même, W.H.R. Rivers, qui était alors lecteur en neuro-psychologie à Cambridge et se consacrerait aussi à l’anthropologie après le retour de l’expédition, deux de ses étudiants W. Mc Dougall, qui deviendrait un psychologue très influent, et C.S. Myers, qui deviendrait Professeur de Psychologie à King’s College à Londres, C.G. Seligman, alors jeune médecin et ami de Myers, il deviendrait un anthropologue connu bien que professant une anthropologie dépassée et dépourvue d’imagination, son plus grand mérite aura sans doute été d’avoir été le trésorier et le conseiller infatigable de son élève Malinowski quand celui-ci sera sur le terrain de 1914 à 1918. Deux autres participants étaient Anthony Wilkin qui devait malheureusement mourir sur le terrain en Egypte quelques années plus tard, et S.H. Ray, un personnage assez médiocre dans l’opinion de ses compagnons, instituteur, il se trouvait toutefois être le spécialiste en Angleterre des langues mélanésiennes ; son travail sur le terrain se caractérisa par sa lenteur, au retour de l’expédition il retomberait dans l’anonymat ; en 1927, Haddon obtint pour lui une pension « en reconnaissance des services rendus à la littérature et à l’étude de l’ethnologie ».
Dans une History of Anthropology qu’il publierait en 1910, Haddon mentionne la CAETS sous le titre de « Psychologie comparative », et il semble en effet que ce soit surtout la psychologie qui ait bénéficié de l’expédition. Tout comme Péron s’efforçait de comparer la force des Européens avec celle des « Sauvages », il s’agissait ici de comparer le fonctionnement des cinq sens chez les indigènes des Iles du Détroit de Torrès avec des données similaires déjà recueillies en Europe. Le travail était partagé de la façon suivante : Haddon devait s’occuper de mensurations craniométriques, de récolter des mythes et d’étudier les arts décoratifs, Rivers enregistrait des données sociologiques et dirigeait l’équipe des psychologues, s’occupant personnellement des problèmes de vision, Myers s’occupait de l’ouïe et de l’odorat, et des temps de réaction, Mc Dougall enquêtait sur la sensibilité tactile, Ray se consacrait à la linguistique et Wilkin prenait des photos.
L’expédition quitta l’Angleterre le 10 mars 1898 et rejoignit l’Ile Jeudi le 22 avril. Diverses îles furent visitées jusqu’en octobre quand Rivers et Wilkin repartirent vers l’Angleterre. En janvier 1899, Haddon, Seligman et Ray se rendirent à Bornéo où Mc Dougall et Myers se trouvaient déjà depuis le mois d’août. Charles Hose, résidant à Sarawak avait invité toute l’expédition, leur promettant des contacts de premier choix avec les Dayak chasseurs de têtes. La fascination pour la chasse aux têtes avait une fois de plus joué, et on ne s’étonnera pas d’apprendre que le livre, destiné au grand public, que Haddon écrirait sur l’expédition s’intitule « Head-Hunters, Black, White and Brown » (1901). De Bornéo, Myers et Mac Dougall devaient ramener la matière d’un livre intitulé « The Pagan Tribes of Bornéo » (1912). Les rapports de l’expédition devaient être laborieusement publiés par Haddon de 1901 à 1935.
Les Rapports de l’expédition constituent une littérature vieillotte qui serait définitivement ridiculisée par la publication d’ouvrages « sociologiques » du type de ceux de Malinowski, Firth, Fortune, Bateson, etc… Seules émergent du lot les contributions de Rivers. Alors que Haddon mettait au point la « méthode définitive pour la description des jeux de ficelles », on voit Rivers élaborer la « Méthode généalogique » encore utilisée aujourd’hui et qu’il devait perfectionner chez les Todas (1906) ; pour la première fois aussi, il établit que la vision est globalement la même chez une population « primitive » que chez l’Européen. Il faut noter que son étude sur la vision, qui relevait plus spécifiquement de la psychophysiologie, constituait une contribution au moins aussi importante que les recherches sur la parenté fondée sur des généalogies qui s’ébauchent ici.
Si l’on veut résumer l’apport de la Cambridge Anthropological Expedition to Torres Straits, il faut insister sur le fait que son importance n’est pas tant dans ses résultats que dans sa postérité. L’expédition avait partiellement détourné Rivers de la psychologie et l’avait intéressé à l’anthropologie dont il allait devenir un des penseurs les plus originaux. Elle avait aussi offert une occasion de pratiquer l’enquête de terrain à Haddon et Seligman qui allaient alors systématiquement pousser leurs étudiants dans cette voie. Les résultats ne se feraient pas attendre : Radcliffe-Brown allait faire sous la supervision de Rivers du terrain aux Iles Andamans et en Australie, terrain sans originalité mais qui allait révéler un penseur parmi les meilleurs de l’anthropologie, tandis que Malinowski allait faire un terrain méthodologiquement révolutionnaire sous la supervision de Seligman, et en appliquant très scrupuleusement les conseils méthodologiques de Rivers présents dans son œuvre.
Laisser un commentaire