La Vraisemblance discrète du préjugé
A paru dans L’Homme 1989, 111-112 : 67-73
– La succession historique de deux discours, le récit de voyage et l’ethnologie, portant sur les sociétés primitives, incite à croire à une continuité entre les deux genres. L’ethnologie écrite durant un siècle sur le mode monographique emprunté au protocole scientifique ne serait alors qu’une parenthèse. Il n’en est rien : l’ambition, partiellement illusoire, du discours scientifique oblige cependant à l’explication maîtrisée ; la forme romancée au contraire, confondant à dessein le vrai et le vraisemblable, permet au préjugé, à l’intuitif le moins accessible, d’évoluer librement. Cette dernière, par son recours au ressort psychologique en tant qu’identification spontanée au héros, omet la question fondatrice de l’ethnologie : le caractère irréductible ou non de l’altérité de l’Autre.
Dans la mesure où l’ethnologie est discours, elle a affaire à l’écriture et par la même est en relation banale avec la littérature. Mais l’interrogation « ethnologie et littérature », pour autant qu’elle est féconde, vise un rapport plus précis entre notre discipline, à savoir : en tant que celle-ci implique un authentique travail sur la langue, accompagné ou non d’un épanchement subjectif. Les propos que l’on peut entendre aujourd’hui dans les couloirs de l’ethnologie affirment que le rapport entre ethnologie et littérature a toujours été plus étroit qu’il n’a paru, voire même que notre discipline n’a valu ce qu’elle vaut qu’en tant que contribution à la littérature ou tout au moins à un type de discours fondé sur le « je de l’énoncé » et qui s’apparente davantage aux humanités qu’aux sciences de l’homme.
Cette thèse mérite débat car, confirmée, elle obligerait à revoir, et de manière drastique, la prétention qui fut jusqu’ici celle de l’ethnologie, d’être – ou d’avoir été – une science de l’Homme. Confirmée, elle nous forcerait à admettre que le regard qui fut posé par nous, ethnologues, sur l’autre, tendait et ne tendait qu’à susciter la complicité par l’identification implicite, c’est-à-dire, à s’écrire comme récit de fiction. La curiosité qui nous a conduits et qui nous conduit encore sous des cieux souvent peu cléments aurait été motivée non par la quête d’un savoir à constituer mais par la recherche d’illustrations, d’ « emblèmes » qui nous permettraient de ficeler au mieux un discours exemplaire et, pour reprendre un terme ancien, mais approprié ici, édifiant.
Cette parenté affirmée entre le « souci littéraire » et le « souci ethnologique » a pour elle au moins la plausibilité que lui confère le rapprochement possible entre l’ethnologie écrite et la tradition du récit de voyage. Car, que l’on puise au hasard chez d’Acosta (Histoire naturelle et morale des Indes Occidentales, 1589), Léry (Le Voyage en Terre du Brésil, 1578) ou leurs successeurs, on trouvera amplement de quoi se conforter dans l’opinion qu’il s’agissait pour eux de tirer les leçons, pour notre bénéfice, des misères qui accablent un peuple privé – pour les auteurs les plus anciens – des lumières de Dieu, et – pour les plus récents – des institutions fondées sur le Droit naturel ou sur la Raison.
Plausibilité donc de la thèse qui, entre le récit de voyage et l’ethnologie moderne, suppose une continuité due à un souci commun d’édifier le lecteur par le récit de mœurs exotiques constituant autant d’illustrations parlantes, de règles de vie à imiter ou plus souvent à rejeter avec force au vu des conséquences affreuses qu’elles entrainent pour ceux qui s’y conforment. Faut-il rappeler qu’un tel souci d’édification fut repris par le roman depuis le déclin comme genre des gestes et légendes (au sens d’André Jolles [1874-1946]). Plausibilité d’une continuité entre monographie ethnologique et récit de voyage cependant battue en brèche par la plausibilité contraire d’une rupture entre eux, rupture qui aurait été marquée et datée par l’attribution à l’ethnologie du rôle de science sociale ou de science de l’Homme.
On peut tout aussi bien en effet, et l’histoire de notre discipline au siècle dernier fait plus qu’y inviter, considérer que cette continuité prétendue relève de l’illusion, de l’erreur de perspective, induite malencontreusement par la nature identiquement exotique de l’objet embrassé par l’un comme par l’autre. Et cela, ceux qui nous pressent aujourd’hui de reconnaître enfin – et d’en tirer les conséquences – l’étroite parenté entre ethnologie et littérature, le savent pertinemment. Car ce qui les pousse depuis quelque temps à mener campagne, ce n’est pas seulement la recherche de la vérité, c’est aussi, et peut-être surtout, le sentiment d’écœurement éprouvé aujourd’hui par tous, ethnologues comme lecteurs profanes (la chose nous est, hélas, confirmée par les éditeurs que chacun de nous sollicite), devant le caractère proprement illisible des monographies ethnographiques qui adoptent encore souvent le style suranné du protocole scientifique façon second Empire.
Mais, faute de comprendre comment le style de la monographie est advenu à l’anthropologie, l’herméneute se prive des moyens de mener victorieusement son combat. D’où nous vient donc cette forme d’écriture qui distille l’ennui avec tant d’efficacité, sinon de la rencontre d’un ensemble de préoccupations visant à imposer au lecteur des connotations aujourd’hui oubliées, après qu’elles se sont dévalorisées au cours d’un long processus d’érosion ? Les limites obligées de l’adhésion du voyageur à son propre propos furent rapidement atteintes. À quoi bon en effet prendre les dieux à témoin, jurer de la véracité de ses dires sur les livres sacrés, appeler l’abomination sur ses descendants jusqu’à la septième génération si jamais l’on avait menti : tout filou le fait bien mieux, mû qu’il est par une conviction toute professionnelle ? Alors un déplacement eut lieu, en sciences morales comme en sciences naturelles, vers des garanties qui ne fussent plus liées aux personnes, mais aux institutions. En imposant une retraite sur ces questions aux docteurs de l’Église, le Savant se mit désormais à parler sur le ton de la démonstration (épistémè), abandonnant au profane et au politicien celui de l’opinion (doxa). Avec pour conséquences, dans les propos de l’honnête homme, le reflux de la rhétorique, qui comme on sait ne convient qu’à la défense des thèses mal assurées ; ce que l’on peut décrire en d’autres termes comme la neutralisation de l’affect dans le discours du Savant. Ainsi que l’observèrent les Anciens, la rhétorique n’emporte la conviction qu’en gagnant le cœur de celui à qui l’on parle : ce qui vaut donc pour certains et non pour d’autres et chaque fois pour un moment seulement. Le Savant a cessé de discourir en son nom propre pour se transformer en porte-parole – si possible anonyme – d’une Science qui s’engendre pour le bénéfice de tous et sans que ceux qui s’expriment comme des desservants soient jamais ni juges ni parties. Ainsi s’est constitué ce style propre de sérieux qu’a relevé Bourdieu (1984 : 46-47) et qui sied à tout membre de l’Université.
Tout ceci fut oublié, et parfois pour de très bonnes raisons : le discours d’une science de l’Homme ne peut, pas plus qu’aucun autre, se concevoir entièrement sur le mode de la démonstration ; la neutralisation de l’affect est, elle, toujours de l’ordre du semblant puisque, comme l’ont mis en évidence à la suite de Duhem les Kuhn et les Feyerabend, toute théorie s’impose par l’inversion d’un rapport de forces où l’adhésion des personnes est loin d’être un élément indifférent – Sneed (1979) introduit comme l’un des paramètres d’une théorie de physique mathématique la croyance du physicien à une théorie spécifique. Quant à l’université, qui croit encore aujourd’hui au caractère obligé de son désintéressement dans la recherche d’un Savoir dont l’Humanité serait automatiquement la bénéficiaire ?.
Est-ce à dire que les temps seraient revenus pour que le Savant adopte à nouveau le style de l’adhésion véhémente à son propre message, et sur un mode qui s’est défini d’emblée comme celui du semblant : celui de la fiction romanesque ?
Il y a en effet dans l’expérience de terrain de chacun de nous certaines choses que nous pensions avoir comprises sur l’humain et que ni la monographie ethnologique ni l’ouvrage de théorie anthropologique ne permettent de rendre dans leur véracité. Et cela, parce que ces choses ne se situent pas dans cet espace de modélisation qu’est la « réalité-objective », feuillet intermédiaire que la science moderne a voulu situer entre l’« existence-empirique » du monde sensible de l’« être-donné » de la chose-en-soi, mais dans un autre espace, l’espace non théorique de l’expérience dite clinique, c’est-à-dire là où se situe l’homme en tant que singulier, en tant que Personne. Et cette occasion offerte à chacun de nous de communiquer ce qu’il a pu comprendre dans un registre autre que celui de la « réalité-objective », rien ne s’oppose à ce qu’il la saisisse, pour autant bien entendu qu’il exprime cette expérience en phrases dont la forme séduira un lecteur.
Mais il y a là des dangers dont le moindre n’est pas la tentation d’adjuger à la forme littéraire une valeur hégémonique et de lui attribuer de façon dogmatique (et généralement sur un ton prophétique) la vertu d’être le seul mode valide de transmission d’un Savoir sur l’humain. Pour construite qu’elle soit, la convention d’un espace de modélisation historiquement défini comme « réalité-objective » présente des garanties (humaines et non transcendantales !) de rigueur et de droit de poursuite pour la Rationalité, qui ne se rencontrent nulle part ailleurs dans l’univers du discours.
Si la forme littéraire, dans la mesure où elle est associée au talent, assure le retour à la lisibilité, elle apporte aussi avec elle une boîte de Pandore dont nul ne peut prétendre maîtriser le chaos potentiel. Passons sur les ambiguïtés inévitables du recours, pour représenter le réel, à un style originellement conçu pour mettre en scène la fiction : qui dira comment trier le vrai du vraisemblable lorsqu’ils sont offerts ensemble à la lecture ? Quel sera le statut, dans l’ethnologie subjective, de ce que Barthes appelait l’« effet de réel », truc d’écriture évoquant un élément du réel historique pour mieux soutenir l’adhésion (ironique) du lecteur au déroulement de la fiction (au moment où j’écris ces lignes un moineau est entré dans la cuisine par la fenêtre entrouverte et picore des miettes de pain, reliefs d’une table non débarrassée : vrai ou faux ?). Ces ambiguïtés sont réelles et propres à l’écriture littéraire mais elles ne suffiraient pas à la condamner comme véhicule d’un savoir ; malheureusement d’autres périls plus sérieux pour la connaissance sont tapis en son sein.
Dans un ouvrage récent (Delbos & Jorion 1984), nous avions commencé un chapitre relatif à la constitution d’un savoir chez la personne par un long extrait d’un conte de Kipling intitulé Quiquern (Le Second livre de la jungle). Le récit met en scène le difficile apprentissage de la chasse par un jeune Esquimau, et nous observions à propos de ce texte qu’il n’est possible de dire aussi VRAI sur la constitution d’un savoir à condition de dire aussi FAUX sur la vie des Esquimaux. Et ce parce qu’il s’agit de littérature, c’est-à-dire d’une mise en scène talentueuse du vraisemblable et non d’un rapport sur le vrai. Kipling, en écrivain, utilise avec maestria un procédé qui fait jouer un double ressort : d’une part obliger le lecteur à combler l’ellipse inévitable du récit à partir de son intuition (qui n’est autre que le savoir implicite qu’il s’est créé à partir de son propre vécu), d’autre part le forcer à s’abstraire de son environnement familier et à remplir les blancs d’une scène inconnue, à l’aide d’éléments préfabriqués qu’il empruntera nécessairement à son expérience, c’est-à-dire à son histoire.
Pour que ce procédé réussisse, il faut que le cadre exotique qui sert de faire-valoir – et de rien d’autre – à la projection « psychologique » du lecteur dans l’univers du récit soit celui d’un exotisme apprivoisé : un exotisme aussi inattendu, que cet « art d’aéroport » qui accueille le touriste à l’escale et ne ressemble en rien à la production artistique locale mais accumule de manière synthétique et excessive les caractères de ce que le voyageur croit savoir du pays qu’il traverse. Exotisme prisonnier d’un imaginaire indigent, en l’absence précisément d’un authentique savoir sur l’autre. Pourquoi alors le chromo est-il convoqué plutôt que le tableau de l’altérité ? Parce que l’exotisme véridique, s’il était reconstitué tel qu’en lui-même, à savoir non comme inconnu mais comme incompréhensible, distrairait le lecteur et interdirait par là même cette projection du savoir personnel implicite qui, dans l’alchimie de l’écriture et de la lecture réunies, fait au roman sa réussite.
C’est là le ressort dit psychologique de la technique romanesque : il s’oppose à la constitution maîtrisée de la connaissance. Bien plus, il substitue au savoir, impliquant une création ex nihilo, la confirmation pure et simple du préjugé ; d’où le caractère non accidentel de la vogue, chez Geertz et ses disciples, des thuriféraires du préjugé entendu comme disposition à la connaissance (!), tels Dilthey et Gadamer. Car le ressort psychologique ne permet de combler le vide de l’ellipse littéraire que par l’identification au héros ; autrement dit, il évacue par un tour de passe-passe la question centrale de l’anthropologie : l’identité ou non du sujet exotique et du sujet lecteur de roman exotique, du « Mélanésien de telle ou telle île » et de nous-mêmes.
Malinowski, « créant » de son propre aveu le Trobriandais, ne fit rien d’autre que confier le sort de son texte à la magie du ressort psychologique : ce qui s’engouffre invisiblement à la lecture des Argonauts of the Western Pacific (1922), c’est ce que Durkheim a appelé notre « social intériorisé », notre identité sociale et culturelle dans la mesure où elle est inscrite en nous comme inaccessible à la conceptualisation. Et c’est pourquoi, sous la plume de Malinowski, le Trobriandais, représentant authentique d’une culture de Don, nous apparaît sous les traits d’un boutiquier malin et calculateur et que nous tendons à le juger « si humain », entendez, si étonnamment semblable à nous-mêmes. Sahlins (1976 : 83-86) a formulé à ce sujet la question qui s’imposait : si le Trobriandais est si semblable à nous, dit-il en substance, pourquoi se conduit-il d’une manière qui nous paraît si étrange ?
C’est pourquoi l’écriture littéraire – à ne pas confondre avec le souci d’écrire correctement et agréablement – tourne le dos à la vocation de l’anthropologie comme science de l’Homme. Son recours à l’intuition du lecteur fait l’économie de ce qui constitue l’objet même de l’anthropologie : rendre compte de l’altérité de l’autre en tant qu’autre, et non préjuger du règlement de la question par son omission pure et simple. Ce que le romancier réussit comme son art, c’est tirer, en vue de l’identification spontanée au héros, le parti le meilleur de l’implicite que le lecteur véhicule en lui-même et projette sur le texte à l’occasion de sa lecture. Au contraire, et de manière irréductible, ce que l’anthropologue réussit comme sa science, c’est de ne tenir à aucun prix pour acquise la transparence de l’autre et de tendre vers l’idéal d’une explication totale de ce qui fait pour nous son altérité. Les bornes de cette exigence tiennent bien entendu, dans un cas comme dans l’autre, aux moyens que la langue met à notre disposition.
La différence est là, essentiellement : confiance d’une part à l’intuition, à l’implicite, comme véhicule de vérité ; renoncement d’autre part à l’intuition en tant que dépositaire du préjugé dénoncé dans son essence de non-savoir et constitution sous une forme non ambiguë d’un savoir explicite. D’un côté ce que Sperber a qualifié d’ethnographie interprétative, toute en sous-entendus ; de l’autre ce qu’il a appelé anthropologie théorique, toute en points sur les i (Sperber 1982, chap. I). La première demande sans doute un certain talent : découvrir dans la langue la connaissance sur l’Homme qui y est déposée et construire un texte qui la développe de manière rhétorique pour induire le lecteur à s’y reconnaître et à s’y fondre. La seconde exige un autre talent : contourner la langue en déconstruisant le savoir spontané qui s’y trouve et rebâtir avec des moyens éventuellement appauvris par le refus de la métaphore un visage de l’autre. L’identité de ce dernier à nous-même pourra le cas échéant être démontrée, mais elle ne peut en aucune manière être tenu pour allant de soi. L’une et l’autre tâche sont complexes, mais celle de l’anthropologue théoricien rencontre une difficulté qui lui est propre : le portrait que nous dressons de cet autre que nous nous sommes choisi comme l’objet de notre discipline, est condamné à ne paraître plausible et acceptable à l’intelligence immédiate que dans la mesure où il est faussé : ce qu’a d’invraisemblable et de rétif à la compréhension un portrait authentiquement ressemblant constitue le défi d’une anthropologie, science de l’Homme. En abandonner le projet en raison de sa difficulté, c’est trahir l’un des idéaux les moins contestables de notre culture : s’efforcer de comprendre l’autre pour l’irréductibilité de son altérité et non pour ce qu’un regard d’incompréhension distraitement posé sur lui reflète nécessairement de notre propre identité.
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
BOURDIEU, P., 1984 Homo academicus. Éd. De Minuit.
DELBOS, G. & P. JORION, 1984 La Transmission des savoirs. Paris, Éd. de la Maison des Sciences de l’Homme.
MALINOWSKI, B., 1922 Argonauts of the Western Pacific. London, Routledge & Sons.
SAHLINS, M., 1976 Culture and Practical Reason. Chicago, The University of Chicago Press.
SNEED, J., 1979 The Logical Structure of Mathematical Physics. 2nd Ed. Dordrecht, Reidel.
SPERBER, D., 1982 Le Savoir des anthropologues. Paris, Hermann.
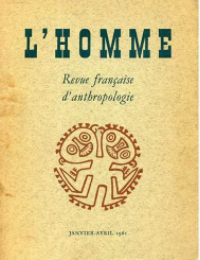
Laisser un commentaire