Retranscription de Le projet d’Intelligence Générale Artificielle, le 24 novembre 2021
L’intelligence générale artificielle ou le sens commun pour les machines
La question essentielle en ce moment, en intelligence artificielle, quand on pense à un robot qui serait très semblable à un être humain en termes d’intelligence, c’est une question qu’on pose sous deux formes : celle de ce qu’on appelle une intelligence générale artificielle ou une intelligence artificielle générale et la question du sens commun : comment donner un sens commun à la machine. En fait, c’est à peu près la même chose. Je vais pouvoir montrer assez facilement pourquoi c’est la même question en réalité et pourquoi on peut lui donner la même réponse.
Les gens qui posent cette question disent : « Oui, on ne pourra jamais donner aux robots une intelligence artificielle générale ». Je vais le dire dans l’ordre, intelligence – générale – artificielle et donc, je vais dire IGA par la suite, I.G.A. ou IGA.
Comment donner une IGA ? Les commentateurs disent : « Il faut donner à la machine en fait une émotion et ça, on ne pourra jamais le faire », « Il faut qu’elle soit un être vivant », « Il faut lui donner un corps ». C’est-à-dire que les gens disent un certain nombre de choses qui renvoient à certains traits qui sont propres à l’être humain.
Un modèle de l’être humain
Ce que je vais faire maintenant, c’est proposer un modèle tout à fait général et montrer pourquoi nous avons besoin d’une intelligence générale en tant qu’être humain. Et je vais montrer qu’il y a un ensemble de particularités, qu’il y a un ensemble de fonctions, qu’il y a un ensemble de tâches qu’il faut que la machine essaye de réaliser, et que si elle veut les assumer, elle a besoin en effet d’un certain type d’équipement. Et il se fait que je crois avoir une représentation complète de quoi il s’agit.
Je vais travailler par couches, je vais commencer par des choses simples à dire et ensuite, je vais ajouter plusieurs étages et quand une vision globale sera atteinte, je dirai quelques mots sur comment on peut réaliser ça en fait sous forme de programmation : quel type de programme il faut créer – du type de ceux que j’ai déjà créés quand j’étais chercheur en intelligence artificielle. Et je terminerai là-dessus avec une petite remarque : pourquoi avoir fait tout ça, ça produit en réalité une IGA ? Bien, un certain nombre de constatations et je ferai aussi des remarques en termes de programmation au fur et à mesure.
La libido
Qu’est-ce qui est propre à l’espèce humaine ? Un caractère qui est le même pour la quasi-totalité des animaux – en tout cas ceux qu’on appelle les « animaux sexués – c’est qu’il n’y a pas de preuve qu’il y ait autre chose qui soit nécessaire pour définir la mission d’un être humain individuel que de dire qu’il doit se reproduire. Qu’il s’agisse d’une description de type surnaturel, d’un message divin : « Unissez-vous et reproduisez-vous, et peuplez la Terre » [Genèse 1:28 : « Croissez et multipliez-vous, remplissez la terre »] ou bien que ce soit dans une perspective je dirais tout à fait athée en termes de gènes, du gène égoïste qui cherche simplement à se reproduire.
Et il y a donc une sorte de force dans la nature mais qui est simplement au départ d’ordre chimique et ensuite biologique parce que les molécules s’attirent, qui produit au bout d’une certaine évolution des espèces bisexuées où les représentants des deux sexes, des deux genres, vont essayer de se rapprocher pour produire ensemble des enfants : pour que l’espèce se perpétue.
La seule chose dont on ait la preuve, c’est que l’espèce cherche à se perpétuer. Evidemment, c’est une représentation anthropocentrique de dire que « l’espèce cherche à se reproduire » mais le fait est que les espèces se reproduisent et qu’elles utilisent – quand elles sont bisexuées – ce système qui consiste à faire se rapprocher deux types de population : les mâles et les femelles, et produire des enfants à partir de là.
Les pulsions
Donc, le point de départ de cet être humain dont il s’agit de faire un modèle, le point de départ c’est qu’il doit se reproduire, voilà. Et on peut, quand on parle du fait de la survie individuelle, le fait qu’on mange, qu’on boive, qu’on respire et aussi qu’on doive se débarrasser des déchets, c’est-à-dire qu’on doit aussi faire pipi et faire caca, et aussi on doit dormir, on doit reconstituer des forces.
On peut déjà faire un modèle informatique de cela avec de la programmation orientée objet où on pourra créer de petites instances qui interagiront. On créera des « hommes » et des « femmes » et on fera qu’il y ait une pulsion qui grandit en eux, un besoin de se rapprocher. Dans l’acte sexuel, il y a satisfaction, c’est-à-dire que la tension qui montait va disparaître à la suite de l’acte. L’acte va réaliser quelque chose, c’est l’acte qui, par ses conséquences, va assurer la reproduction, mais il y a une tension qui monte chez les hommes et chez les femmes qui va les conduire à se rapprocher, à s’accoupler, et la tension va baisser. Et aussitôt qu’elle aura disparu par une descente de gradient (c’est l’opération d’un point de vue physique, c’est comme ça qu’on va le modéliser), par une montée en puissance et puis une descente de gradient brutale. Et à partir de ce moment-là, le processus va recommencer : la tension va remonter.
Donc, au départ, on a ce qu’en psychanalyse on appelle la libido, cette force, cette pulsion qui pousse les sexes de se rapprocher pour s’accoupler et que la tension baisse. Tout d’abord, parce qu’il y a une période dans la vie d’un être humain où il ne peut pas se reproduire, il y a toute une période de montée, de constitution de l’enfant, puis de l’adolescent, et les relations entre enfants ne sont pas fécondes si jamais elles devaient avoir lieu. Il y a d’abord constitution donc de l’espèce jusqu’à un certain âge. Les gens, quand ils sont en âge de s’accoupler, doivent satisfaire un certain nombre de besoins pendant ce temps-là : ils doivent manger, ils doivent boire, ils doivent faire pipi, ils doivent faire caca, etc. Et dans toute la période qui précède : l’enfance et l’adolescence, on le fait sans qu’il n’y ait véritablement reproduction et on peut considérer qu’il y a une « période de latence » comme on dit, il y a une période où la libido ne s’exerce pas sur les enfants [ou plutôt sous la forme embryonnaire que Freud a appelé « sexualité infantile »], puis il y a une période de puberté où la libido s’exerce sans doute mais les rapports ne sont pas encore féconds. Et puis il y a production d’enfants. Puis on arrive à une période où la femme cesse d’être féconde ; l’homme cesse d’avoir de la libido et donc n’est plus attiré par la femme, etc.
Alors, pour permettre justement qu’il y ait cette reproduction, il faut que soient assurées les fonctions de manger, boire, etc. pendant toute la période. Là aussi, on peut représenter ça de la même manière : il y a montée de la faim, puis on mange, satiété : le besoin tombe à zéro et puis il va se reconstituer. Et, par exemple pour manger, on peut dire qu’il y a trois moments : quand on se réveille, on commence à avoir faim, on mange. Il y a une période qui va jusqu’au déjeuner pendant laquelle l’appétit remonte et on va le satisfaire etc., puis ça va retomber et puis arrive le soir, on a de nouveau faim et on mange et voilà, on peut aller dormir. Pendant ce temps-là, il y a le processus de la fatigue : la fatigue monte, on a envie de dormir, on dort, etc. Pareil, le lendemain matin, quand on se réveille, on va petit à petit se fatiguer dans la journée. On aura envie de dormir, etc.
Une instance de la classe être humain
Donc, avec la programmation, on peut déjà créer je dirais de manière linéaire sur le temps dans la journée, on peut créer un petit être, on va appeler ça une « classe » parce que ce sera une « instance » dans une « classe » – ça, c’est le langage de la programmation – on va créer une instance particulière d’une classe et cette instance aura à tout moment un certain degré de faim, un certain degré de soif, un certain degré de vouloir faire pipi et un certain degré de vouloir faire caca, aura un certain degré de fatigue qui va monter aussi. Et on peut donc faire une sorte d’agenda, de minute en minute, avec un petit robot auquel on dit simplement : « Quand tu es arrivé au moment où tu dois faire pipi, tu as une période d’un quart d’heure pendant laquelle il faut que tu trouves le moyen de faire pipi. Quand tu as faim, il faut que tu trouves une période d’une heure durant laquelle tu dois manger ». Même chose pour boire, même chose pour dormir. Et on va ajouter sur l’ensemble et sur une période plus longue l’envie de s’accoupler, voilà, l’envie de la copulation qui là aussi devra être satisfaite si on est dans les âges de la reproduction.
Donc, faisons un petit robot avec ces simples contraintes : la tension monte pour manger, pour boire, etc. et à tout moment de la journée, on peut regarder où ils en sont : quel est le degré de fatigue, quel est le degré de faim, quel est le degré de soif, etc. et bien sûr, cette petite machine a des tâches à accomplir : faire pipi, faire caca, trouver de la nourriture, etc. On peut déjà faire un petit personnage et le petit personnage, bien entendu, il doit concilier tout cela.
On sait nous, et on peut le lui dire, qu’on peut faire pipi et caca en même temps. On peut boire et on peut manger en même temps mais également, on a plus souvent soif dans la journée qu’on n’a faim, etc. Ou on fait plus souvent pipi qu’on ne doit faire caca, etc. Donc, on peut déjà créer un petit robot qui ne produit rien dans le monde si ce n’est qu’il doit assurer ces fonctions et il doit trouver le moyen de les satisfaire.
La contrainte du travail
Bon, alors, on va ajouter un certain nombre de choses petit à petit. Par exemple, si on est dans une société comme j’en ai connu certaines en Afrique, le problème de boire et de manger, il est assez simple parce qu’on peut trouver des choses à boire et à manger tout autour de soi très facilement [grimper dans un cocotier et couper une noix verte où il y a à boire et à manger], et donc, il y a un accès immédiat à la nourriture et à la boisson. Bon, aussi, on ne doit pas chercher des toilettes publiques parce qu’on peut aller dans la jungle et voilà, faire ses besoins de cette manière-là.
Mais on va ajouter tout de suite comme une contrainte qui est celle d’un être humain dans un environnement urbain moderne, une contrainte supplémentaire, c’est qu’il faut avoir de l’argent, il faut payer pour boire et il faut payer pour manger, et il faut payer pour dormir, voilà. Alors, ça peut être un loyer, ça peut être un hôtel, ça n’a pas d’importance. On va mettre une contrainte supplémentaire par rapport à ces besoins qu’on a définis, une contrainte supplémentaire : il faut travailler. Il faut que, pendant un certain temps, on travaille et on sait que si on travaille un certain nombre d’heures, on va avoir une certaine somme d’argent et cette somme d’argent, on pourra l’utiliser le lendemain pour acheter à boire, pour acheter à manger, pour trouver un endroit où dormir. Donc on a déjà une petite machine qui a un certain nombre de contraintes et on peut lui faire son agenda sur la journée, non seulement les besoins élémentaires, la tension sexuelle qui monte, la libido et en même temps, un certain temps qu’on doit passer à travailler pour obtenir une certaine somme d’argent. Bon, donc voilà les contraintes.
La mémoire
Alors, de quoi est équipé ce petit robot pour faire ça ? Il va être équipé d’un certain nombre de choses. Il y a un certain nombre de choses qui lui permettent par exemple de savoir dans quel ordre faire les opérations. Qu’est-ce qui lui permet de savoir l’ordre dans lequel il faut faire les différentes opérations ? C’est sa mémoire. Donc, il faut la constitution d’une mémoire et il faut que cette mémoire ait une dynamique qui lui permette de savoir ce qui est pertinent à chaque moment, ce qui est pertinent c’est-à-dire ce sont les gestes qu’il faut faire et bon, ça, j’en ai déjà fait le modèle puisque c’est mon logiciel ANELLA que j’ai fait dans les années 87 à 90. On sait déjà, je sais déjà ça, comment ça marche.
Constitution d’une mémoire. Cette mémoire, elle a un double fonctionnement : on l’utilise à tout moment pour juger d’une situation présente : la mémoire nous permet de savoir ce qu’il faut faire et, par ailleurs, la perception de ce qui se passe au moment présent nous permet d’obtenir des informations qu’on peut ajouter en mémoire. Donc il y a un double mouvement pour la mémoire : la mémoire qui descend qui a été stockée, qui a été emmagasinée et qui descend parce qu’on va l’utiliser en contexte et une mémoire qui est en train de se constituer et qui va soit s’ajouter à celle qui est déjà là, soit la modifier. On va raffiner, voilà, on va nuancer, on va améliorer la performance en modifiant légèrement la mémoire.
Le Ça, le Moi et le Surmoi
Bon, alors, qu’est-ce qui va gérer cette mémoire ? Eh bien, là, on est vraiment dans la psychanalyse. On a trois choses qui peuvent faire fonctionner cette mémoire : il y a d’une part l’inconscient qu’on appelle aussi le « Ça » en psychanalyse. L’inconscient, c’est tout ce qui se passe de manière automatique, voilà. Je ne fais même pas attention mais je dois faire pipi depuis un moment et je suis en train de chercher un endroit où je vais pouvoir le faire. C’est inconscient, je n’y réfléchis pas, etc. Il peut se trouver qu’à un autre moment, vraiment, j’ai laissé passer le temps et tout à coup, je me dis : « Bon eh bien maintenant, il faut vraiment que je trouve un endroit pour aller pisser parce que ça commence à urger ». Là, c’est le « Moi », là c’est conscient.
Et la différence entre l’inconscient et le conscient, la conscience qui est le Moi, c’est que – si je ne fais pas attention, si je n’y réfléchis pas – je vais inconsciemment aller vers les toilettes et faire pipi et je n’y penserai même pas, donc le Ça se sera occupé entièrement de cela. Bon, si je tarde et que ça vient à mon attention que maintenant, il faut que je fasse quelque chose de particulier, il faut que je fasse attention parce que, maintenant, je dois aller faire pipi. Là, le Moi embraye et ce que peut faire le Moi que ne peut pas faire l’inconscient, c’est planifier de manière délibérée, dire qu’il faut maintenant que je le fasse dans les 5 minutes et aussi de le faire selon des étapes, des étapes dont on peut énumérer consciemment l’ordre dans lequel il faut les faire et les faire dans cet ordre-là.
Donc, on a quelque chose qui fonctionne de manière automatique par la mémoire, c’est le Ça. On a quelque chose qui peut utiliser la mémoire et qui peut, voilà, faire des opérations délibérées, c’est le Moi. Et on a une troisième instance en psychanalyse, c’est le « Surmoi ».
Alors, qu’est-ce que c’est le Surmoi ? C’est un truc qui s’ajoute à la mémoire. La mémoire, elle est organisée on va dire comme un réseau neuronal artificiel comme utilisent les systèmes actuels de deep learning, d’apprentissage en profondeur. Le Surmoi, ce sont des règles, ça ressemble à ce qu’on appelait en informatique un « système-expert ». C’est un ensemble de règles et ces règles, on peut les appliquer.
Ce qu’il y a, c’est que le Surmoi est le plus souvent inconscient et lui, il va appliquer les règles mais en arrière-plan, il va les imposer. C’est pour ça qu’on parle parfois d’un « Surmoi tyrannique » parce que ce sont des choses qui se sont inscrites, ce sont des choses que les parents ont dites, que les professeurs, les instituteurs, etc. ont dites. Ce sont des règles à respecter ou des choses qu’il faut faire. C’est ce que le sociologue Emile Durkheim, appelait le « social intériorisé », ça va interférer avec ce que font et le Ça et le Moi mais c’est très pratique parce que, bien sûr, un savoir sous forme de règles, ces règles peuvent être énoncées.
On peut connaître des procédures de manière très économique en enchaînant des règles mais quand nous réfléchissons par ce qu’on appelle l’intuition, eh bien, là, il n’y a pas de règle qui soit appliquée. Là, c’est le fonctionnement du réseau neuronal tel quel. C’est ça que nous appelons l’intuition, ce sont des raisonnements qui se passent chez nous mais on n’y a pas accès. On ne sait pas exactement comment ça se passe. C’est de l’ordre inconscient, voilà.
Le verbe
Donc, on a des instances qui peuvent diriger le type d’opération qui doit être faite et qu’est-ce qu’on a en plus ? Et ça, c’est le dernier élément, on a la parole. La parole nous permet d’emmagasiner en particulier des mots en mémoire.
Ces mots, nous pouvons les organiser de telle et telle manière. Il y a des choses qui y sont associés. Adam et Eve sont associés dans notre mémoire parce qu’on nous parle toujours d’Adam et Eve. Si on nous parle de pommes et de poires, on ne pourra pas associer les poires à Adam et Eve mais si on parle de la pomme, oui, on peut l’associer à eux, etc. Ça, bon, c’est toute la partie que j’ai couverte dans mon logiciel ANELLA et c’est la partie que je décris donc dans mon livre qui s’appelle Principes des systèmes intelligents » qui a été publié en 1989. Donc, on a la parole.
Le Moi est fait de « est » et de « a »
Alors, pour avoir encore quelque chose en plus, pour avoir véritablement une constitution du Moi, il faut qu’il y ait des choses qui soient le contenu même de ce Moi et là, dans ANELLA, dans la description que j’en fais dans Principes des systèmes intelligents, je fais que la machine acquiert un certain nombre de notions en pouvant les classer de manière très simple au départ entre « choses qu’on a » et « choses qu’on est ». Et ce qui est important pour le Moi, c’est que le Moi va être constitué d’un ensemble de choses qu’il est et qu’il sait qu’il est et d’un certain nombre de choses qu’il sait qu’il a. Mais il a cette capacité aussi de reconnaître que d’autres instances – les autres petits robots qui vont être en interaction, eux aussi peuvent être des choses, eux aussi peuvent avoir des choses.
La parole va nous permettre d’améliorer nos techniques pour obtenir des choses. Si on parle bien, on va pouvoir avoir un bon boulot et dans le boulot, on va faire les choses efficacement si on peut parler aux autres et leur dire ce qu’il faut faire, etc. Même chose pour ce qui est de la reproduction : si on baratine bien, si on peut raconter des salades très bien, on va obtenir des résultats, on ne sera pas obligé d’utiliser – comme le font les animaux sauvages [pas tous : voir les parades nuptiales] – la force brute pour obtenir un partenaire. On pourra, par la conversation, en étant aimable, etc., obtenir le même résultat.
La dynamique d’affect
Bon, alors, j’ai fait un petit tableau. Alors, je résume : il y a les besoins qui créent des tensions qui montent et qu’il faut satisfaire régulièrement. Ça, c’est un premier élément. Il y a un certain nombre de contraintes qui sont liées à ces besoins. Il y a des contraintes directes comme dormir, manger, faire pipi, etc. Il y a une contrainte supplémentaire qui est celle de notre civilisation : gagner de l’argent, travailler pour obtenir de l’argent qui va permettre de payer pour dormir, le coucher, le manger, etc., le boire et c’est un moyen détourné de faire ça. Alors, on a un matériau à l’intérieur, c’est la mémoire et on a un mécanisme pour faire monter de la mémoire, d’enregistrer, de la stocker et la faire descendre. Alors, on a trois instances aussi qui peuvent utiliser cette mémoire et qui peuvent d’abord utiliser cette mémoire, c’est donc le Ça, le Moi et le Surmoi et l’instance du Moi a en plus la capacité de parler.
Bon, il y a aussi des effets de temps en temps, par exemple dans une psychanalyse où on entend le Ça, l’inconscient qui parle et la personne à ce moment-là, dans la séance de psychanalyse, dit au psychanalyste : « Je viens de dire cela mais je ne sais pas pourquoi je l’ai dit ». C’est un effet de l’inconscient. En général, c’est le Moi qui parle et c’est le Moi qui s’entend mais ce qui est très intéressant, c’est que le Moi va aussi entendre ce que le Ça va dire quand il le dit et également, le Moi va entendre ce que le Moi produit et peut réagir à ça, c’est-à-dire réagir émotionnellement et qu’est-ce que c’est que l’émotion, ce sont des valeurs d’énergie qui vont permettre de reconfigurer ce qui est en mémoire, d’attacher une importance plus ou moins grande à ce qui est en mémoire et là aussi, ce qui est en mémoire avec cet ordre que donne cette dynamique d’affect, ça va être très important dans les interactions.
Quand on vous dit : « Qu’est-ce que vous pensez de telle question ? », eh bien, les informations que vous avez en mémoire vont être rapportées en fonction de leur importance. Vous allez commencer par le plus important parce qu’il a en mémoire la valeur d’affect la plus élevée. Même chose si vous êtes en conversation avec quelqu’un à qui vous faites la cour, vous allez dire les choses dans un ordre particulier en disant d’abord les choses importantes, après en disant des choses moins importantes et pendant ce temps-là, le Surmoi va faire de la surveillance : il y a des règles, des choses qu’on ne peut pas dire quand on fait la cour et il y aura un certain filtre, un certain tri qui aura lieu pendant ce temps-là.
Donc la mémoire d’un côté, la parole qui vient comme quelque chose de supplémentaire et les trois instances, Ça, Moi et Surmoi, ont des rapports bien particuliers à la parole comme je viens de le décrire.
Modéliser l’intelligence générale artificielle
On sait que les robots, les machines, on peut leur donner des tâches particulières. Elles peuvent être intelligentes d’une certaine manière. Elles peuvent être intelligentes, une intelligence artificielle peut être très forte à jouer le jeu de go et de gagner au jeu de go : c’est le cas des fameux programmes AlphaGo [dans leurs générations successives] qui sont très forts au jeu de go. Il y a d’autres choses qu’on peut faire. On peut mettre par exemple une intelligence artificielle dans le cockpit d’un avion de chasse et qui va avoir une interaction avec le pilote, voilà. Mais, en même temps – et ça, c’est le reproche qu’on fait toujours – l’intelligence artificielle dans le cockpit de l’avion, elle ne sait pas en même temps comment il faut faire pour préparer une tasse de café. Elle ne sait pas non plus jouer au go pendant ce temps-là, voilà, parce que c’est séparé. Alors, ce qu’on fait maintenant, eh bien on fait des machines qui jouent au go et qui peuvent en même temps verser une tasse de café. Ce n’est pas très compliqué de le faire mais la machine ne le fait pas spontanément.
Ce qu’on veut quand on parle, voilà, d’IGA, d’Intelligence Générale Artificielle, on veut que la machine puisse prendre des initiatives. Or, la réponse, je viens de la donner : une machine ne prendra pas d’initiative si elle n’a pas ses besoins, ses pulsions de faire pipi et de faire caca, de manger, de boire, de respirer, d’avoir envie de dormir. C’est comme ça que nous acquérons un sens commun, c’est ça qui fait que nous acquérons quelque chose qui nous permet d’agir dans la vie de tous les jours sur l’ensemble des tâches qui se présentent devant nous. C’est pour ça, c’est parce que nous avons tous ces besoins qui doivent être satisfaits à une certaine échéance. C’est pour ça que nous avons un savoir général.
Alors, qu’est-ce qu’il faut faire si on veut que la machine acquière un savoir de type général ? Il faut lui donner des besoins comme ceux que je viens de décrire. Il faut leur donner une mémoire. Il faut que cette mémoire soit alimentée en particulier en termes de choses qu’on a ou qu’on est et que la machine puisse trier ce qu’elle a, ce qu’elle est par opposition à des choses que d’autres ont ou sont par rapport à elle.
À partir du moment où le Moi peut s’attribuer des choses qu’il a et qu’il est, ce Moi commence à avoir, je dirais, une véritable existence et le fait qu’il puisse parler lui donne la possibilité en tout cas de donner les apparences d’une conscience, d’une conscience personnelle, d’un être qui existe là en tant que tel et qui peut dire : « Moi ceci et toi cela. Toi, tu possèdes ceci et tu es cela. Moi, je possède ceci et je suis cela », faire la distinction entre les deux.
Alors, voilà, je crois que c’est une description générale du produit du sens commun de l’intelligence générale artificielle que j’ai appelée IGA jusqu’ici, voilà, je dirais, le programme.
Implémentation
J’ai dit que j’allais encore faire quelques remarques en termes de programmation. Eh bien, c’est relativement simple : on va donner… Enfin, « relativement simple », c’est RELATIVEMENT simple. On va donc donner successivement à la machine différents besoins, l’obligation de les satisfaire dans un certain laps de temps, avec la tension qui monte, etc. Et donc si on fait ça, on a déjà un petit robot qui est obligé de faire des choses, d’aller à tel et tel endroit pour aller aux toilettes, pour aller au restaurant et ainsi de suite. On va lui ajouter une mémoire qui va lui permettre de faire ces choses de la manière la plus efficace possible. Cette mémoire va s’améliorer et il pourra le faire de manière de plus en plus efficace et donc, pourra gérer son temps de manière de plus en plus efficace. Il a trois instances pour le faire : le Ça, le Moi et le Surmoi et il dispose d’un outil général qui va alimenter non seulement sa possibilité d’améliorer les choses mais aussi sa représentation de lui-même : c’est le langage, c’est la parole. Et cette parole en particulier, les mots, peuvent être stockés à l’intérieur de la mémoire.
Voilà, j’ai fait un petit tableau. Pourquoi j’ai fait ça ? Parce que maintenant, je vais pouvoir transmettre cela à l’équipe d’intelligence artificielle avec qui je travaille et on aura une véritable carte de ce qu’on va faire, un véritable plan pour les étapes à remplir successivement. Et ce qui est formidable, c’est bien sûr que dans l’équipe, il y a à la fois des gens qui peuvent faire la programmation de l’intelligence artificielle, que nous travaillons avec des gens en robotique et on va pouvoir leur proposer des robots en leur imposant ce type de besoins que je viens de décrire. Et on a une équipe qui fait des jeux vidéos, c’est-à-dire qu’on va pouvoir représenter le comportement de petits personnages en interaction. Parce que ce qui va devenir très intéressant bien entendu, c’est non seulement quand un de ces petits personnages va essayer de faire des choses mais qu’il va y avoir l’interférence d’autres petits personnages. Il va vouloir aller faire pipi et il y aura la queue devant : il faudra qu’il attende. Des choses de cet ordre-là. C’est ce qu’on va faire apparaître.
Et bien entendu, pour ce qui est de l’accouplement, de la copulation, il faut que ce personnage, à ce moment-là, trouve un autre qui se trouve dans le même type de dispositions dans le sexe opposé, et c’est comme cela que la reproduction sera assurée, c’est-à-dire le but général de l’espèce. Bien entendu, pourquoi est-ce qu’on n’a jamais réfléchi dans ces termes-là ? Parce qu’on n’a jamais pensé aux robots. On a dit : « Avec les robots, on va imiter l’intelligence humaine ». On n’a jamais réfléchi véritablement à quel est le substrat qui fait que nous acquérons un sens commun, que nous acquerrons une intelligence générale artificielle. Voilà, merci.
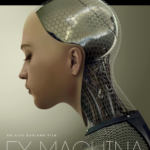
Laisser un commentaire