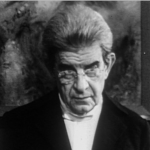 Il y a quelques semaines, j’ai ouvert la caisse où – bien des déménagements plus tard – se trouvaient les œuvres publiées de Lacan. J’ai découvert alors à ma surprise qu’il y avait là un ouvrage dont je n’avais lu que les premières pages. Si vous aviez l’occasion de voir comment je maltraite mes livres – même les plus précieux – de grands surlignages de marqueurs fluos et de commentaires plus ou moins iconoclastes, vous comprendriez pourquoi j’étais sûr que je n’avais pas lu de Jacques Lacan, Le séminaire livre VIII, Le transfert, Paris : Éditions du Seuil, 1991.
Il y a quelques semaines, j’ai ouvert la caisse où – bien des déménagements plus tard – se trouvaient les œuvres publiées de Lacan. J’ai découvert alors à ma surprise qu’il y avait là un ouvrage dont je n’avais lu que les premières pages. Si vous aviez l’occasion de voir comment je maltraite mes livres – même les plus précieux – de grands surlignages de marqueurs fluos et de commentaires plus ou moins iconoclastes, vous comprendriez pourquoi j’étais sûr que je n’avais pas lu de Jacques Lacan, Le séminaire livre VIII, Le transfert, Paris : Éditions du Seuil, 1991.
Sa lecture m’a à ce point aussitôt passionné que je vous ai proposé de consacrer aux réflexions de Lacan sur le transfert et le contre-transfert, plusieurs « lectures non-« bibliques » de Freud, Lacan, &c. » dont j’ai entrepris la série l’année dernière. Cela aura lieu à l’automne et je continuerai de vous informer d’ici-là. Mais cela ne m’empêche pas de cogiter déjà « furieusement », sur la question, pour m’exprimer comme le faisait en son temps, Jean-Jacques Rousseau.
Vous trouverez ci-dessous le fruit de mes premières cogitations. J’ai, de l’amour, une conception moins tragique, moins désespérée, que Lacan, mais cependant suffisamment proche de la sienne que je puisse intituler mes premières réflexions :
Le transfert, à partir de Lacan
Dans l’amour, l’aimé, est celui dont le corps, c’est-à-dire l’aimé en tant qu’objet (et non en tant que sujet), est ce qui induira chez moi la jouissance que me procure le vacillement de mon sentiment d’être sujet. La double sensation de l’aimé comme pur corps, pur objet de mon corps à moi, et de moi comme pur corps, pur objet pour lui, débouche sur ce vacillement.
Lacan : « Ce dont il s’agit dans le désir, c’est d’un objet, non d’un sujet. C’est en ce point que gît ce que l’on peut appeler le commandement épouvantable du dieu de l’amour. Ce commandement est justement de faire de l’objet qu’il nous désigne quelque chose qui, premièrement, est un objet, et, deuxièmement, un objet devant quoi nous défaillons, nous vacillons, nous disparaissons comme sujet. Car cette déchéance, cette dépréciation, c’est nous, comme sujet, qui l’encaissons » (Lacan 1960-1961 : 203).
Dans l’analyse, les voies conduisant à l’amour sont différentes pour l’analysant (le « transfert ») et l’analyste (le « contre-transfert »).
Dans le transfert, l’analyste se définit comme sujet supposé savoir quelle est la source de la souffrance de l’analysant. Si la souffrance disparaît grâce à lui, il sera aimé en tant que sauveteur : il m’a permis d’être sujet en me rendant mon âme, et mon corps voudra, en offrande, communier avec le sien.
Dans le contre-transfert, l’écoute de l’analyste n’est authentique que si elle entend la souffrance de l’analysant : si elle compatit. La compassion (l’« empathie ») va consister en ceci que l’analyste va permettre que se bâtisse à l’intérieur de lui-même un double de l’inconscient de l’analysant. Cette réplique étant indemne des blessures ayant conduit chez l’analysant au refoulement, l’analyste pourra énoncer le signifiant qui fait l’objet d’un tabou chez l’analysant, c’est-à-dire « interpréter », le libérant ainsi de sa souffrance. L’analysant est aimé par l’analyste au sens où au moment où l’analyse atteint son terme, leurs deux âmes n’en constituent plus qu’une seule pour lui.
Lacan : « … mieux l’analyste sera analysé, plus il sera possible qu’il soit franchement amoureux, ou franchement en état d’aversion, de répulsion, sur les modes les plus élémentaires du rapport des corps entre eux, par rapport à son partenaire. Ce que je dis là va un peu fort, en ce sens que cela nous gêne » (Lacan 1960-1961 : 220).
Si dans l’amour, le corps de l’aimé n’attire pas, l’amour sera dit « platonique ».
Laisser un commentaire