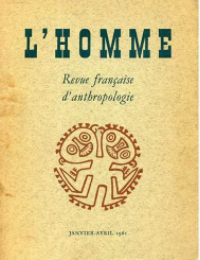
« Aux origines de l’anthropologie française »
A paru dans L’Homme, avr.-juin 1980, XX (2) : 91-98.
- À propos de Aux origines de l’anthropologie française. Les Mémoires de la Société des Observateurs de l’Homme en l’an VIII. Textes publiés et présentés par Jean COPANS et Jean JAMIN. Préface de Jean-Paul Faivre. Paris, Le Sycomore, 1978, 230p. (« Les Hommes et leurs Signes »), 1981, XVI + 327 p., bibl., index, ill ; (« Les Hommes et leurs Signes)
Saluons l’excellente initiative qu’ont prise J. Copans et J. Jamin en réunissant un ensemble de textes écrits sous l’impulsion de la Société des Observateurs de l’Homme, la première société d’anthropologie, qui tint ses séances de 1799 à 1804. L’ouvrage est composé de trois parties : une préface de J.-P. Faivre, une présentation intitulée « De la Filiation déviée à l’oubli des origines », par J. Copans et J. Jamin, et un choix de huit textes, dont les fameuses Considérations sur les diverses méthodes à suivre dans l’observation des peuples sauvages, 1800, de J.-M. Degérando. Il était temps qu’un ouvrage français soit consacré à la Société des Observateurs de l’Homme, puisque le lecteur anglophone pouvait déjà consulter G. W. Stocking (1964) et F. G. T. Moore, ed. (1969), et le lecteur italien un livre très complet sur le sujet : La Scienza dell’uomo nel Settecentode S. Moravia (1970).
Commençons par le choix de textes. Les présentateurs ont rassemblé la plupart des textes courts en rapport avec les activités de la Société des Observateurs de l’Homme, notamment ceux qui furent reproduits dans les diverses revues publiées par la Société d’Anthropologie de Paris au début du siècle. On trouve en outre un extrait de la correspondance du commandant Baudin. Manquent, entre autres, la communication de J. Itard, « De l’Éducation d’un homme sauvage » (1801), reproduite par L. Malson (1964), toutes les leçons d’histoire naturelle de l’homme de L.-F. Jauffret, l’« Histoire de ma vie » de J. Massieu, présentée par lui-même dans « Le Langage par signes des sourds-muets » à une réunion de la Société – on peut la trouver dans F. Berthier (1873) – et le rapport de Degérando sur Victor de l’Aveyron de J. Itard, qui parut pour la première fois dans les Annales de l’Éducation des Sourds-muets et des Aveugles en 1848. C’est surtout l’absence de ce dernier texte qu’on regrettera. Degérando va en effet à l’encontre de Pinel dont le rapport figure dans le recueil. Alors que Pinel assimile de façon peu convaincante Victor à une série d’enfants idiots dont il dresse le portrait détaillé, Degérando émet pour la première fois l’hypothèse d’un frayage nécessaire des fonctions intellectuelles à l’intérieur d’une fourchette d’âges, sans quoi ces fonctions régressent définitivement ; il oppose ainsi très finement un « idiotisme moral » au défaut organique. Je ne pense pas qu’il y ait eu, de la part des auteurs du recueil, une intention délibérée d’écarter ce texte ; plus vraisemblablement, ils n’ont pas dû en retrouver la trace, ce dont on ne saurait les blâmer. Les notes d’introduction sont sans doute trop laconiques et n’ajoutent rien de neuf aux commentaires de Georges Hervé qui présenta ces textes au début du siècle. Seule innovation par rapport à Hervé, le souci systématique de dénigrer l’œuvre anthropologique de François Péron. Nous reviendrons sur cet aspect.
La présentation de Copans et Jamin est très bien faite. Manifestement les deux auteurs possèdent leur sujet et se montrent à même de tirer les leçons de cet embryon d’anthropologie (ou de cet avorton) pour notre pratique actuelle. Les quelques critiques que je dois leur faire ne visent donc nullement à amoindrir leur mérite.
Une critique d’ordre général : les présentateurs, s’ils font preuve de maîtrise pour la période envisagée (1799-1805), semblent moins à l’aise quand ils évoquent le développement de l’anthropologie au cours du XIXe siècle. Ainsi la mauvaise querelle avec les anthropologues physiques, par laquelle débute leur exposé (pp. 25-28), révèle-t-elle surtout une ignorance des rapports entre ethnologie et anthropologie à cette époque. À vouloir dater une distinction nette entre anthropologie et ethnologie avant 1900, on s’expose à de nombreux contresens. On peut convenir, par exemple, que Letourneau était plutôt ethnologue et Topinard plutôt anthropologue, mais, en un temps où les ethnologues n’étaient pas nécessairement plus voyageurs que les anthropologues, rien n’est moins sûr. La chose n’était pas claire pour les savants eux-mêmes, c’est le moins qu’on puisse dire. Qu’on relise, pour s’en persuader, « Anthropologie, ethnologie et ethnographie » de P. Topinard (1876) et la discussion passionnée qui s’ensuivit. On risque peu de se tromper en affirmant que « anthropologie » et « ethnologie » fonctionnèrent comme synonymes au cours du XIXe siècle, au moins en France, en Angleterre et aux États-Unis. Ce qui ne signifie pas que la synonymie était établie. Les membres de l’Anthropological Society of London, en particulier T. Bendyshe, J. Hunt et J. B. Davis, consacrèrent un temps et une énergie considérables à comparer l’extension des deux termes. En Angleterre, Hunt quitta la languissante Ethnological Society pour fonder l’Anthropological Society ; il était clair pour lui qu’il s’agissait du même domaine de connaissances. Si les anthropologues eurent plutôt recours aux données de la crâniométrie, tandis que les ethnologues se référaient davantage à la philosophie, c’est que les premiers croyaient trouver là de meilleurs arguments à l’appui de leur dada : l’« infériorité du Nègre ». En France, lorsqu’en 1859 Broca fonda la Société d’Anthropologie de Paris, son intention était en fait de ranimer la Société d’Ethnologie créée en 1839 par William Edwards et qui ne s’était plus réunie depuis 1848. Seul un désaccord avec les survivants de l’ancienne société obligera Broca à renoncer au terme « ethnologie ». Il n’y a donc rien là qui relève de l’épistémologie. Les thèses extrêmes de Broca sur la question des races — il maintenait que le métis du Noir et du Blanc était un hybride infertile comparable au mulet — lui interdirent de publier dans le cadre de la Société de Biologie. C’est donc un peu accidentellement qu’il dut faire paraître ses articles révolutionnaires sur les localisations cérébrales dans sa propre revue, les Bulletins de la Société d’Anthropologie, l’orientant ainsi vers la crâniologie et la neurophysiologie du cerveau. Ce que nous appellerions ethnologie n’était pas pour autant exclu de ses colonnes. Comme on le sait, l’anthropologie sociale française ne naîtra ni parmi les anthropologues, ni parmi les ethnologues, ni même parmi les folkloristes, mais dans les pages de L’Année sociologique. La querelle que font Copans et Jamin aux anthropologues, accusés de tirer la couverture à eux quand ils affirment être les héritiers spirituels de la Société des Observateurs de l’Homme, est donc particulièrement mal fondée.
Plus loin (p. 37), les présentateurs s’étonnent aussi de la « médicalisation » de l’anthropologie dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Broca était certainement très fier de compter, parmi les 112 membres de sa Société résidant à Paris, 84 médecins, mais tout comme de Quatrefages (1867 : 59) qui laissait « à la Faculté de Médecine tout ce qui est relatif à l’Homme considéré comme individu », Broca distinguait soigneusement le domaine de la médecine de celui de l’anthropologie, cette dernière s’occupant uniquement de l’ « histoire collective du genre humain ». Pourquoi alors tant de médecins ? Lorsque l’Idéologie se donna pour programme d’établir le catalogue des productions naturelles et sociales réelles, en écartant les « vaines théories » et les « spéculations hasardées » (Jauffret, cité p. 73), elle se coupa de la philosophie qui avait jusqu’alors monopolisé la réflexion sur l’homme. Un seul autre domaine avait accumulé un savoir empirique sur l’homme tel qu’il était et non tel qu’il devait être : la médecine. Le nombre considérable de médecins dans l’anthropologie du XIXe siècle ne résulte donc pas d’un quelconque complot, mais d’une localisation de fait des compétences susceptibles de fonder une connaissance empirique de l’homme.
Copans et Jamin remarquent à juste titre que « le silence sur Degérando n’est pas dû au hasard puisqu’il correspond à un silence constant sur les problèmes de méthode de terrain au sein de l’anthropologie française » (p. 43). Il y a quelques années, J. Guiart (1967 : 87) écrivait : « Le seul fait de l’expatriation provisoire donne droit à faire partie de la profession, comme si l’on avait découvert en cela un lourd secret pesant sur toutes les consciences » ; et un peu plus tard (1968 : 84) : « Les analyses critiques portant sur la validité des matériaux sont rares, parce que considérées comme discourtoises. Il s’ensuit que, contrairement aux sciences exactes, l’ethnologue ne subit aucune pression, et ne risque aucun compliment, quant au sérieux de la formulation de ses données. » Il faudrait toutefois se méfier d’une illusion rétrospective : le programme de Degérando est tout entier condillacien et, de ce point de vue, constitue plutôt le programme d’une « psychologie comparée » que celui d’une anthropologie sociale. Il est amusant de constater que lorsque la Cambridge Expedition to Torres Straits aura renoué en 1898 avec la pratique du terrain organisé, son initiateur et chef, A. C. Haddon, la considérera toujours comme ayant été une entreprise de « psychologie comparée » (1910 : 86). Malinowski n’aurait pas pu inventer ce qu’il appellera l’ « enquête sociologique intensive » si Durkheim n’avait auparavant fondé l’anthropologie sociale. Quant à affirmer, comme le font les présentateurs (p. 43), que Malinowski n’a « théorisé sa pratique qu’a posteriori », il ne faudrait pas perdre de vue que Rivers avait déjà procédé à une théorisation de la pratique de terrain dans son introduction à The Todas (1906) et dans « Anthropological Research outside America » (1913), si bien que la réflexion méthodologique de Malinowski ne présentait aucune urgence. Notons toutefois que dans « Baloma» (1916), texte écrit par Malinowski alors qu’il n’avait encore passé que neuf mois dans les îles Trobriand, se trouve (huitième partie) une réflexion poussée sur la méthodologie du travail de terrain.
Copans et Jamin minimisent cependant l’influence que les Considérations… de Degérando eurent sur le développement de l’anthropologie. L’« Instruction générale adressée aux voyageurs… » que l’on trouve dans le premier numéro des Mémoires de la Société d’Ethnologie (1840) est directement inspirée de ce texte. L’« Instruction générale… » servira elle-même de modèle aux « Queries respecting to Human Race to be Addressed to Travellers and Others » — ancêtres des célèbres Notes and Queries —, rédigées à la demande de la British Association for the Advancement of Science (cf. Urry 1972 : 46). Il existe donc bien une filiation entre les Considérations et les questionnaires ethnographiques modernes.
Ma dernière remarque pour ce qui touche à la Présentation est relative à François Péron. À la page 39, les présentateurs citent Honigmann (1976) à propos de Péron, « l’ethnographe inepte qui était à bord… ». Quand on se reporte au texte de Honigmann, on s’aperçoit que sa seule référence est F. G. T. Moore (1969). L’opinion défavorable que Moore entretient à l’égard de Péron repose en grande partie sur le rôle d’espion que celui-ci joua lors de son séjour à Port Jackson, la future Sydney. Dans un échange de lettres, Moore m’a confirmé (comm. pers.) : « Je crois avoir montré dans mon livre, preuves à l’appui, que Péron gâcha la meilleure occasion qui lui fut offerte de faire du travail anthropologique — le long séjour à Port Jackson — en préparant le ‘rapport d’espion‘ qu’il soumettra ensuite au général Decaen. » Les considérations nationales restent donc pertinentes à deux siècles de distance ! L’Angleterre maintenait le blocus de la France et l’on aurait mauvaise grâce de reprocher sa curiosité à Péron, soldat de la République. Il serait piquant que le personnage de Péron, premier ethnologue (« anthropologiste ») de terrain, ait encore à souffrir dans la littérature anthropologique française contemporaine d’une représentation négative, conséquence du fait qu’en 1803 il espionna une colonie pénitentiaire britannique en Australie !
La préface de rancœur de M. Faivre fait question. Pourquoi d’ailleurs Copans et Jamin ont-ils sollicité cette encombrante contribution dont la perspective réactionnaire s’accorde mal avec la leur ? Je ne reprocherai pas à M. Faivre d’ignorer l’anthropologie, il n’en a sans doute que faire, mais plutôt de maltraiter l’histoire, ce qui pourrait le toucher davantage. L’expédition australienne dirigée par Baudin pose un problème historiographique : nous en possédons deux comptes rendus contradictoires, le Voyage de découvertes aux Terres Australes de Péron et Freycinet, et le journal de bord du commandant Baudin ; dans une large mesure, il faut choisir entre les deux versions. Faivre choisit Baudin, j’aurais plutôt tendance à choisir Péron. Les préoccupations ethnologiques de celui-ci me sont plus proches, et son itinéraire me plaît : il a été fait prisonnier et a perdu un œil au service de la République, il s’embarque, non par ambition comme l’affirme Faivre (p. 17), mais par dépit amoureux, « la personne à laquelle il était attaché lui fut refusée parce qu’il n’était point assez riche » (Deleuze 1816 : 437). Quant à Baudin, il m’apparaît comme le « fayot » dans toute son horreur ; son anti-intellectualisme systématique surgit à chaque page de sa correspondance (pp. 207-217) et son journal le montre encore plus franc que lorsqu’il s’adresse à Jussieu, qui pourrait après tout se formaliser. Voilà pour mes préjugés, libre à M. Faivre d’en avoir d’autres. Nous sommes cependant, lui et moi, tenus par les mêmes documents, et des usages méthodologiques existent quant à la façon de les faire parler. Voyons comment procède M. Faivre.
« À juste titre », écrit-il, « l’Australien Ernest Scott [a] déplor[é] […] la légende de l’incapacité malveillante de Baudin propagée par les rédacteurs officiels du Voyage… » (p. 16). Il serait intéressant de voir exactement en quels termes Scott déplore cette légende. À la page 164 de Terre Napoléon (1910), celui-ci rapporte que « von Humboldt reconnaissait qu’il n’avait que peu de confiance dans le caractère personnel du capitaine Baudin », principalement « en raison du mécontentement de la Cour de Vienne lors d’un de ses précédents voyages ». Faivre se contente de noter à ce sujet que « [Baudin] voyait Alexandre de Humboldt […] qui aurait pu s’embarquer avec lui » (p. 15). Mais poussons plus loin si nous voulons découvrir la bonne opinion que se fait Scott (1910 : 168) du commandant Baudin : « … et le résultat de sa mauvaise navigation fut que les vaisseaux de Baudin mirent 145 jours à joindre Le Havre à l’Ile Maurice, où ils restèrent pour radouber, tandis que Flinders [qui effectuait un voyage d’exploration parallèle pour le compte de l’Angleterre; P. J.] mena l’Investigator de Spithead jusqu’au Cap Leeuwin, où il aborda l’Australie, en 142 jours. » Poursuivons, car la bonne opinion de Scott se confirme : « … le simple fait qu’il fallut à Baudin du 8 mai au 20 juin, 43 jours pour voguer de Kangaroo Island à Sydney […] suffit à montrer comment le caractère obtus de Baudin contribue à aggraver la détresse de ses hommes » (ibid.: 183-184). Il y a mieux encore. Après une longue discussion relative à la navigation de Baudin, Scott note : « Il n’est dès lors pas étonnant que Freycinet confia qu’il était ‘surpris’ des manœuvres de Baudin, on peut à peine considérer qu’elles étaient celles d’un être rationnel, certainement pas celles d’un commandant responsable de la sécurité de deux navires et de la vie de leurs hommes » (ibid.: 225). M. Faivre considère que Scott « déplore la légende de l’incapacité malveillante de Baudin », il me semble plutôt qu’à partir d’une lecture minutieuse de sa navigation, il en apporte les meilleures preuves.
Scott n’est d’ailleurs pas seul à mettre en doute la santé mentale de Baudin. Dans leur ouvrage consacré à l’expédition, Bouvier et Maynial (1947 : 207) citent le journal de Baudin à la date du 6 juillet 1803 : « Je laisse à penser l’effet que fit ce changement de route auquel personne ne s’attendait, car personne n’a su jamais où j’allais, ni ce que je voulais faire, ni ce que je faisais pendant la campagne… » Ils commentent : « Y avait-il seulement chez lui un soin jaloux de préserver son indépendance, ou bien jouissait-il du plaisir satanique d’étonner, de dérouter, par les bizarreries de sa conduite, ceux qui l’approchaient et qui le connaissaient si mal. » Quant aux derniers jours du commandant, je ne sais si nous serions encore aussi admiratifs devant ce qu’un de ses officiers appelait sa grande force d’âme : « Il avait recueilli dans un bocal d’esprit-de-vin ses poumons qu’il avait vomis dans des souffrances inouïes, et il les montrait à toutes les personnes qui le venaient visiter » (ibid. : 219). M. Faivre affirme que Jules Verne déplora « qu’une conspiration du silence ait paru régner en France depuis le retour de l’expédition » (p. 16) ; il se garde de dire cependant que Jules Verne (1880 : 187) considérait que les hommes du commandant Baudin auraient sans doute eu moins de raison de se plaindre de lui s’il avait été en pleine possession de toutes ses facultés ; on ne peut être plus explicite.
Pour en revenir à Péron, il serait fastidieux de répondre à toutes les imputations malveillantes de M. Faivre à son égard : arriviste, courtisan, froussard, etc., et dont malheureusement Copans et Jamin se font quelquefois l’écho. L’œuvre anthropologique de Péron devra un jour être évaluée pour son mérite propre, disons simplement ici qu’il fut le premier anthropologue de terrain, qu’il courut des risques considérables pour mener à bien une tâche rendue quasi impossible par la mission cartographique de l’expédition, qu’il fut emporté par la tuberculose à l’âge de trente-cinq ans, et que probablement seule cette mort prématurée l’empêcha de rédiger son œuvre anthropologique ; à la lumière de ces précisions, le venin de M. Faivre semble tout à fait indécent.
Je ne retiendrai qu’un seul point. M. Faivre laisse entendre que l’expédition eut à pâtir de la fronde isolée de Péron, et peut-être de Louis de Freycinet, « savant acariâtre, doublé d’un marin de ‘ cabinet ‘ » (p. 15). Rappelons que c’est ce « marin de cabinet » qui ramena l’expédition à bon port. Ce point d’histoire est heureusement facile à éclairer car nous disposons d’autres témoignages à ce sujet. M. Faivre écrit par exemple : « Bory Saint-Vincent […] dut débarquer, à l’aller, à l’Ile de France » (p. 17). Or il se trouve que Bory de Saint-Vincent (1804: 189) — auteur d’un des premiers traités anthropologiques (L’Homme (Homo). Essai zoologique sur le genre humain, 1811) — s’est longuement expliqué sur sa défection lors de l’escale à l’Ile Maurice ; écoutons-le : « [Le commandant] affecta de publier partout que la moitié des membres de l’expédition étaient inutiles à son succès ; que l’Institut lui avait donné des savants dont il n’avait que faire ; qu’il n’avait besoin que de ramasseurs […] Les géographes et les astronomes, surtout, n’étaient pas bien dans l’esprit du commandant ; il prétendait que ses officiers auraient suffi pour la géographie et l’astronomie, et que d’ailleurs il aimait mieux découvrir un mollusque nouveau qu’une terre nouvelle » ; « il était d’ailleurs furieux que ce fût à des indispositions que nous dussions notre débarquement, qu’il aurait voulu qualifier d’indiscipline» (ibid.: 191) ; « c’est dans cet état d’incertitude vraiment cruel que, combattu par le désir d’accompagner mes amis, et par la crainte de succomber dans une expédition mal dirigée, c’est dans cet état dis-je, que je demeurai flottant, inquiet, irrésolu, jusqu’au moment où j’appris que le commandant avait fixé le départ de l’expédition pour le lendemain » (ibid.: 192). Un autre naturaliste, M. J. Milbert (1812 : VII-VIII), débarqué lui aussi à l’Ile Maurice, écrit ceci : « Les relations déjà publiées ont suffisamment instruit le public des privations et des contrariétés que nous éprouvâmes à bord : on sait de quelle manière funeste elles influèrent, dans le cours de cette longue traversée, sur la santé du plus grand nombre. Je fus un de ceux qui furent laissés malades à l’Ile-de-France ; ce qui certainement n’eût pas eu lieu si, conformément aux intentions du gouvernement, l’on nous eût fourni les aliments sains et abondants que nous devions avoir. »
Ce qu’il faudrait encore expliquer, c’est la résistance à Péron, comme Freud parle de résistance à la psychanalyse. Pourquoi oppose-t-on, comme le modèle à la caricature, Degérando qui invente le Sauvage — une fois de plus et déjà — à Péron qui le décrit effectivement ? Sans doute parce que des Observations sur l’anthropologie… (cité ici pp. 177-185) au Voyage de découvertes aux Terres Australes, le Sauvage des Lumières, auquel nous tenons encore tant, s’effondre avec fracas. Le Sauvage que décrit Péron, c’est l’inverse du Orou du Supplément au voyage de Bougainville, il n’a aucun message de grande sagesse à nous transmettre. Aimable, inventif, mesquin, il est identique à nous dans ses préoccupations comme dans ses gestes : affreusement banal. Degérando, c’est la préhistoire de l’anthropologie, Péron, sa conclusion. Et nous préférons toujours les débuts…
N.B. Je publierai de la même manière un texte consacré à proprement parler à l’œuvre anthropologique de François Péron en Australie.
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
BERTHIER, F.
1873 L’Abbé Sicard, précis historique sur sa vie, ses travaux et ses succès. Paris, C. Douniol.
BORY DE SAINT-VINCENT, J.-B.
1804 Voyage dans les quatre principales lles des Mers d’Afrique fait par ordre du gouvernement pendant les années 1801 et 1802. Paris, 3 tomes.
BOUVIER, R. & E. MAYNIAL
1947 Une Aventure dans les Mers Australes. L’Expédition du Commandant Baudin
(1800-1803). Paris, Mercure de France.
DEGÉRANDO, J.-M.
1848 « Considérations sur le sauvage de l’Aveyron », Annales de l‘Éducation des Sourds-muets et des Aveugles 5 : 110-118.
DELEUZE, J.-P.-F.
1816 « Éloge historique de François Péron », in F. PÉRON & L. DE FREYCINET, Voyage de découvertes aux Terres Australes, II : 434-457.
GUIART, J.
1967 « L’Ethnologie qu’est-elle? », Cahiers internationaux de Sociologie 42 : 85-103.
1968 « Réflexions sur la méthode en ethnologie », Cahiers internationaux de Sociologie : 45 : 81-98.
HADDON, A. C.
1910 History of Anthropology. London, Watts & Co.
HONIGMANN, J. J.
1976 The Development of Anthropological Ideas. Homewood, IIl., Dorsey Press.
MALINOWSKI, B.
1916 « Baloma: The Spirits of the Dead in the Trobriand Islands », Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland: 353-430.
MALSON, L.
1964 Les Enfants sauvages. Paris, Union générale d’Éditions (« 10/18 »).
MILBERT, M. J.
1812 Voyage pittoresque à l’Ile de France, au Cap de Bonne-Espérance et à l‘Ile de Ténériffe. Paris, 2 tomes.
MOORE, F. G. T., ed.
1969 « Translator’s Introduction », in J.-M. DEGÉRANDO, The Observation of Savage Peoples. London, Routledge & Kegan Paul: I-58.
MORAVIA, S.
1970 La Scienza dell’uomo nel settecento. Roma, Laterza.
PÉR0N, F.
1807 Voyage de découvertes aux Terres Australes, I. Paris.
PÉRON, F. & L. DE FREYCINET
1816 Voyage de découvertes aux Terres Australes, II. Paris.
QUATREFAGES, A. DE
1867 Rapport sur les progrès de l’anthropologie. Paris.
RIVERS, W. H. R.
1906 The Todas. London, Macmillan.
1913 « Anthropological Research outside America », Reports on the Present Conditions and Future Needs of the Science of Anthropology. Washington.
SCOTT, E.
1910 Terre Napoléon. London, Methuen.
STOCKING, G. W.
1964 « French Anthropology in 1800, Isis LV (2), 180: 134-150.
TOPINARD, P.
1876 « Anthropologie, ethnologie et ethnographie », Bulletins de la Société d’Anthropologie de Paris II : 199-229.
URRY, J.
1972 « The Development of Field Methods in British Anthropology, Notes and Queries: 45-57 (« Proceedings of the Royal Anthropological Institute »).
VERNE, J.
1880 Les Grands navigateurs du XVIIIe siècle. Paris.
Laisser un commentaire