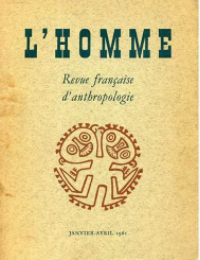
Un ethnologue proprement dit
A paru dans L’Homme, oct.-déc. 1980, XX (4) : 119-128.
- À propos d’une réédition de James Cowles PRICHARD, Researches into the Physical History of Man. Edited with an introductory essay by George Stocking, Jr. Chicago, The University of Chicago Press, 1973, CXLIV + 568 p., bibl., index. [1re éd. 1813.]
L’époque de l’anthropologie à laquelle appartient James Cowles Prichard est mal connue. Très récemment encore, la première moitié du XIXe siècle constituait un blanc sur la carte historiographique de l’anthropologie. Les rares auteurs qui s’attachaient à écrire l’histoire de notre discipline s’empressaient d’accrocher l’évolutionnisme social de la deuxième moitié du XIXe siècle aux Lumières françaises et écossaises, pourtant depuis longtemps éteintes. Soixante-dix à quatre-vingts ans de l’histoire de l’anthropologie étaient ainsi passés sous silence, prix à payer pour le ridicule attaché aujourd’hui à un temps où une énergie considérable était consacrée exclusivement à la crâniométrie.
Quel manuel d’anthropologie récent mentionne les textes importants du début du XIXe siècle, L’Histoire naturelle de l’Homme (1821) de Lacépède ou L’Homme (1825) de Bory de Saint-Vincent ? Pourtant, après les premiers appels du pied au XVIIIe siècle, c’est bien alors que s’inaugure une réflexion anthropologique véritablement empirique. E. B. Tylor, que nous considérons souvent comme « le fondateur de l’anthropologie moderne », attribuait précisément ce titre à Prichard, et dans l’effervescence paléontologique des années 1860, James Hunt, le très raciste président de l’Anthropological Society of London (fondée par J. Hunt et R. Burton — sans doute le victorien le plus haut en couleur —, sécessionnistes de la languissante Ethnological Society of London), se plaignait amèrement — « il ne s’agit pas d’un mince déshonneur », disait-il — que les ouvrages de Prichard fussent encore considérés comme les ouvrages anthropologiques de référence (Hunt 1863 : 8).
Alors que les livres autrefois consacrés à l’histoire de l’anthropologie mentionnaient, et parfois examinaient en détail, l’œuvre de Prichard (de Quatrefages 1867; Haddon 1910), les ouvrages plus récents, soit l’ignoraient tout à fait (Lowie 1937; Kardiner & Preble 1961), soit ne lui réservaient qu’une attention distraite. C’est le cas de Penniman qui, dans A Hundred Years of Anthropology (1935), lui consacre seulement deux pages ; encore est-ce surtout pour le brocarder, lui attribuant l’opinion qu’Adam et Ève devaient être noirs, ou, déformant l’esprit de ses remarques sur la variété de moutons « ancon » dont les courtes pattes leur interdisent de sauter les haies (pp. 62-63), laissant entendre que Prichard voyait dans une telle mutation un heureux effet de cette harmonie qui réjouissait Bernardin de Saint-Pierre. Seules trouvent grâce aux yeux de Penniman les quelques phrases qui lui permettent de compter Prichard au nombre des précurseurs de Darwin, exercice gratuit auquel tous les naturalistes du XVIIIe siècle peuvent aussi bien être soumis. C’est aussi le cas de Burrow, encore plus économe que Penniman, puisque dans son remarquable ouvrage, Evolution and Society. A Study in Victorian Social Theory, où il analyse pourtant l’œuvre d’auteurs plus anciens, il n’évoque Prichard que dans une note en bas de page qui lui reconnaît cependant la qualité de « plus éminent des ethnologues anglais » (1966: 123).
C’est seulement depuis peu que Prichard a recouvré la faveur des commentateurs : Harris lui consacre quelques pages dans The Rise of Anthropological Theory (1969), de même que Voget dans A History of Ethnology (1975). Mais si l’on excepte un petit ouvrage consacré à Prichard peu de temps après sa mort par J. A. Symonds (1849), aucune analyse détaillée n’avait été faite de l’œuvre de l’ethnologue anglais. C’est pourquoi l’on saura gré à George Stocking d’avoir republié la première édition (1813) du principal ouvrage de Prichard, ces Researches into the Physical History of Man, dont le titre appellera en écho, un demi-siècle plus tard, les Researches into the Early History of Mankind and the Development of Civilization (1865) de E. B. Tylor. On remerciera aussi Stocking d’avoir fait précéder cette réédition d’une introduction substantielle (110 pages) qui nous éclaire sur cette période peu étudiée de l’anthropologie britannique dont Prichard fut le plus beau fleuron.
Il faut s’interroger sur ce silence de trois quarts de siècle qui règne sur l’histoire de l’anthropologie, et sur l’œuvre de son plus brillant représentant. Stocking a raison d’incriminer la définition actuelle de l’anthropologie (p. xii) qui ne laisse aucune place à son équivalent d’autrefois, l’ « ethnologie » à proprement parler; celle-ci convoquait aux fins de classement des races un amalgame de preuves qui nous paraissent aujourd’hui relever de branches distinctes du savoir : l’anthropologie physique, l’anthropologie sociale et la paléontologie naissante, mais aussi la philologie et les religions comparées. Le concept de « race » permettait d’ailleurs un subterfuge dont tous n’étaient pas dupes, et particulièrement Paul Broca. Dans l’article « Anthropologie » qu’il rédigea en 1867 pour le Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, Broca remarquait que l’usage de ce mot pour désigner une variété du groupe humain évite d’avoir à se prononcer sur la question de l’interfertilité de ces diverses variétés. Le mot « espèce » résoudrait cette question par la négative, alors que le mot « variété » impliquerait au contraire que le groupe humain ne constitue qu’une seule espèce. Si l’on ne s’était accordé sur le terme « race », monogénistes et polygénistes utiliseraient des mots différents que l’agnostique en ces matières rejetterait pareillement (1867: 197).
Nous sourions quand Hérault de Séchelles considère que les gens de lettres, en 1785, ont les idées « bien plus combinées et plus réfléchies que celles des philosophes anciens » (in Gaillard 1977 : 153). Pourtant, c’est un reproche semblable que nous adressons à nos prédécesseurs en anthropologie, leurs propos nous paraissant souvent confus pour la simple raison que nous voulons y reconnaître, inextricablement mêlées, des notions que nous avons pris l’habitude, depuis, de distinguer. En l’occurrence, ce qui nous dérange chez Prichard, c’est ce qui nous apparaît comme un certain laxisme dans l’application de — ce qui deviendra — la méthode diffusionniste à un continuum empirique allant du « physique » au « moral » de l’homme, ou, si l’on veut, de ses os à ses cérémonies.
Mais la principale raison qui a fait tomber l’œuvre de Prichard dans l’oubli est celle qui permet aujourd’hui à l’historien « charitable » de le remettre en selle : son caractère déjà foncièrement rétrograde au moment même de sa conception. En cultivant une vision passéiste, Prichard se mettait — bien sûr à son insu — en position de devenir à nos yeux le chaînon manquant entre le XVIIIe siècle et la deuxième moitié du XIXe. Mais seulement dans la mesure où nous ne voulons rien entendre d’une anthropologie fascinée par les crânes et ancrée dans une phrénologie vouée à l’échec, d’une anthropologie réductionniste et scientiste, spiritualiste et laïque.
En fait, il est assez rassurant que l’œuvre de Prichard ait pu, même provisoirement, être oubliée. Cela signifie que l’histoire des idées attache plus de prix aux révolutionnaires et aux non-conformistes qu’aux autorités incontestées de leur temps pour leur zèle à défendre les valeurs établies. Car Prichard maintint avec élégance le drapeau d’une cause qui apparaissait aux esprits modernistes de l’époque définitivement perdue. N’est-ce pas comme à contrecœur qu’en 1867 de Quatrefages écrit : « Toutefois il est un homme dont il serait injuste de ne pas au moins mentionner le nom et les ouvrages. Je veux parler du docteur James Cowles Prichard » (1867: 17).
James Cowles Prichard (1786-1848) fut, pratiquement toute sa vie, médecin dans la ville de Bristol, après avoir étudié successivement à Édimbourg, Cambridge et Oxford. De confession quaker par tradition familiale, il se tourna ensuite vers l’Évangélisme, ce qui lui permit de poursuivre des études à l’Université, dont l’accès était alors réservé aux membres de l’Église anglicane. Il était à la fois généraliste et psychiatre, et réputé pour la foi qu’il accordait à la toute récente pharmacopée chimique : Thomas Hodgkin devait dire dans un éloge de son défunt ami : « En tant que médecin praticien, le Dr. Prichard était remarquable par la sûreté de son diagnostic, et par la rapidité et l’énergie qu’il mettait dans l’administration des remèdes » (1850 : 206). De 1845 à sa mort, en 1848, il vécut à Londres où il présida l’Ethnological Society of London, honneur qui lui aurait certainement été accordé plus tôt s’il n’avait vécu en province. Il mourut, affirme Hodgkin, d’avoir exercé sa charge d’Inspecteur des Asiles d’Aliénés (Commissioner of Lunacy) dans des conditions difficiles, « ce qui attire une fois de plus notre attention sur les récompenses accordées au mérite intellectuel et celle réservées aux exploits militaires » (ibid.: 207).
Si nous négligeons les ouvrages « professionnels » de Prichard, médicaux et biologiques, son livre le plus connu fut Researches into the Physical History of Man dont la première édition de 1813 développait sa thèse en médecine, essai exceptionnellement long, soutenue à Édimbourg en 1808. Ce même ouvrage connut encore deux autres éditions (en 1826, et en cinq volumes publiés de 1836 à 1847) considérablement augmentées par de nouveaux apports de matériel ethnographique, le thème se déplaçant d’ailleurs de la simple justification du récit adamique vers une illustration du déterminisme du milieu, préfiguration de Ritter.
Les deux autres ouvrages anthropologiques les plus notables de Prichard furent The Eastern Origin of the Celtic Nations (1831), où il s’opposait à l’opinion alors défendue par quelques-uns, selon laquelle les peuples celtes constituaient un ensemble absolument distinct du reste de l’humanité (p. Lxxiii), et The Natural History of Man (1843), ouvrage dans lequel il résumait ses théories anthropologiques à l’intention du grand public, faisant à cette occasion plus que des concessions au « dégénérationnisme » de l’homme de la rue, en admettant, par exemple, que le Boschiman devait être une forme dégénérée du Hottentot (pp. lxxxvii-vii). Ce dernier livre fut traduit en français par F. Roulin et publié en deux volumes à Paris, la même année, sous le titre Histoire naturelle de l’Homme.
En résistant à l’esprit du temps à partir d’un a priori moral — l’unité spécifique du groupe humain —, Prichard évita de se laisser enfermer dans l’impasse du polygénisme, lequel était bien entendu condamné à moyen terme par le triomphe du darwinisme qui, sans vraiment donner raison aux monogénistes, faisait tomber la polémique en désuétude. Mais c’était surtout politiquement que le polygénisme était condamné, dans la mesure où son apparent progressisme scientifique servait de caution théorique aux esclavagistes des États confédérés, qui ne devaient pas tarder à être vaincus sur le terrain. Tout comme la querelle sur la personne de Napoléon, l’opposition entre monogénistes et polygénistes départageait de façon assez paradoxale le camp des anthropologues et celui des ethnologues. Du côté des monogénistes, on trouvait des hommes très religieux comme Prichard ou le quaker Hodgkin, mais aussi Th. H. Huxley qui devait dire que, pareils aux serpents morts entourant le berceau d’Hercule, les cadavres de théologiens entourent le berceau de toute nouvelle science ; les polygénistes, eux, comptaient dans leurs rangs le raciste James Hunt qui se félicitait de la répression sanglante de la révolte noire à la Jamaïque (Hunt 1866a : lxxviii), mais aussi celui qu’il aurait qualifié de « négrophile » s’il n’avait été son ami, Broca, sympathique aux Communards et appelé par la gauche à siéger au sénat.
Comme l’a fort bien noté Hodgkin, le polygénisme avait contre lui de trop bien rendre compte des faits, et du même coup le monogénisme était heuristiquement plus rentable car plus difficile à accorder avec les apparences : l’hypothèse de l’origine indépendante à partir de plusieurs couples, « en fournissant une explication toute faite aux nombreuses variétés de morphologie, de couleur et de stature, a tendance à diminuer l’ardeur de la recherche; alors que le désir de découvrir la preuve de connexions, malgré la diversité, est comme la lanterne qui éclaire notre chemin dans l’obscurité de la nuit » (Hodgkin 1850: 186).
En défendant jusqu’au milieu du XIXe siècle la chronologie mosaïque et le récit adamique, Prichard assura la survie de l’hypothèse d’une descendance unique de l’homme. Le darwinisme liquidera le polygénisme en substituant un couple de primates inconnus à Adam et Ève; c’est cette substitution même qui nous semble aujourd’hui décisive, mais elle pouvait apparaître relativement subsidiaire à certains esprits de l’époque, puisque Hunt s’opposait au darwinisme en lui reprochant, avec quelque raison d’ailleurs, de simplement reformuler la doctrine prichardienne de l’unité de l’homme (Hunt 1866b).
Deux représentations concurrentes se proposent pour rendre compte de cette « ethnologie » du début du XIXe siècle : celle d’une « proto-anthropologie » se dissolvant vers 1865 pour se restructurer dans la première problématique « moderne » de l’anthropologie — l’évolutionnisme; celle d’une anthropologie progressant sans rupture mais dont se détachent successivement la psychologie, la philologie, l’anthropologie physique, la paléontologie et l’archéologie préhistorique, pour ne laisser fonctionner sous les noms d’ethnologie et d’anthropologie qu’une histoire spéculative, de plus en plus sociologisante, centrée sur la description des « peuples sauvages ». Quoi qu’il en soit de la réalité de la seconde description, l’idée d’une rupture est suggérée par l’incapacité de notre vocabulaire anthropologique contemporain à rendre compte de cette proto-anthropologie autrement que comme une simple monstruosité. On serait tenté de parler d’ « évolutionnisme » dans le cas de Prichard si le concept avait conservé un sens plus proche de son sens premier. Prichard est évolutionniste dans la mesure où il s’intéresse avant tout au développement de la « civilisation », mais le courant auquel nous appliquons le qualificatif est foncièrement progressiste, alors que le système de Prichard exclut l’idée même de progrès, et est, à tout prendre, nous l’avons vu, plutôt « dégénérationniste » ou « dérivationniste », s’attachant plus au mécanisme global de la « Chute », où s’inscrivent une multitude de « rechutes » localisées — telle cette dérivation du Hottentot en Boschiman.
Prichard ne doute pas de la réalité de la Chute, et il est certain pour lui qu’Adam connut la Vraie Religion. Pourtant il se montre toujours prêt à mettre la perspective progressiste en parallèle avec la sienne propre, d’où ces formulations hybrides qui semblent ménager la chèvre et le chou, par exemple, à propos du chamanisme, « cette forme de superstition qui convient à l’humanité qui a perdu depuis longtemps, ou n’a pas encore atteint par l’art et la technique, la maîtrise des éléments physiques » (p. lxxxvi). La façon dont Prichard soumet le témoignage biblique à une imitation de critique historique est aussi très curieuse : c’est au seul titre de témoin-privilégié, par exemple, que Moïse est convoqué : « Nous invoquons seulement l’autorité de Moïse pour les faits qui eurent lieu à une époque peu éloignée de la sienne et dont il aurait eu connaissance par le témoignage humain uniquement » (p. 472). De même, quand il est question du déluge, le statut que Prichard reconnaît à la relation biblique ne permet pas qu’on l’oppose à une version « scientifique », l’ordre naturel ne pouvant être bouleversé par le miracle, mais seulement momentanément suspendu : « Mais cet événement [le déluge] étant tout à fait miraculeux et hors du cours naturel des choses, nous ne pouvons pas compter que ses conditions et ses conséquences s’enchaînent selon une connexion naturelle. » Le déluge passé, les animaux furent « certainement reportés dans leurs anciens séjours par les mêmes moyens surnaturels qui les avaient déplacés, ou dans ces lieux pour lesquels leur constitution avait été originellement créée » (pp. 138-139).
Stocking résume avec bonheur ce qui distingue la position de Prichard de celle de Tylor, inventeur d’un nouveau paradigme anthropologique dans le dernier quart du XIXe siècle :
« Chez Prichard, l’unité psychique de l’humanité n’est pas le point de départ de la réflexion sur le développement de la civilisation, mais le point d’aboutissement de sa réflexion sur l’unité de l’homme. Tandis que Tylor fit appel à l’unité psychique comme à un principe qui lui permettait d’établir la séquence uniforme du développement de la religion, Prichard prit les régularités qu’il observait dans le domaine de la religion comme base pour fonder l’unité psychique de l’homme. Ce qui revient à dire qu’ils s’intéressaient aux mêmes phénomènes, mais à des problèmes différents. En fait, on pourrait dire que, de Prichard à Tylor, le donné et la problématique sont inversés : la préoccupation constante de Prichard fut l’unité de l’homme, celle de Tylor fut le développement de la religion » (p. XCI).
Prichard est aussi, à sa façon, un « diffusionniste ». Il s’efforce de connecter par le mécanisme de l’emprunt la totalité des cultures alors connues. Mais ce qui l’intéresse, ce ne sont pas tant les péripéties historiques en elles-mêmes que la mise en évidence du postulat de l’unité originelle de l’homme, apparemment démentie par l’éparpillement actuel de la famille humaine. Le diffusionnisme de Prichard est donc purement instrumental et ne déborde pas du domaine de l’administration de la preuve; l’intérêt pour le cheminement de traits culturels isolés, préoccupation majeure des futurs diffusionnistes, lui reste étranger. Mais le principe de la reconstruction historique est le même :
« … l’autorité directe de l’histoire ne nous fournit qu’une représentation imparfaite de l’origine des nations. C’est pourquoi nous dépendons souvent de la lumière réfléchie qui nous vient de la comparaison des langues, de l’analyse des institutions civiles et religieuses et des affabulations mythologiques, ou d’une démarcation nette des affinités entre us et coutumes de différentes tribus » (pp. 243-244).
Prichard recourt aussi, et massivement, aux données que nous appellerions d’anthropologie physique, ce qui le situe sans équivoque dans son siècle, mais l’usage qu’il en fait est très différent de celui qu’en font ses adversaires polygénistes. Ceux-ci pratiquent un réductionnisme biologisant où le physique de l’homme est la clef de sa culture, dans une perspective physiognomoniste où se lit encore l’impact de la phrénologie, « idéologie scientifique » selon les termes de Canguilhem, qui anticipa abusivement sur le développement de la neurophysiologie, mais troubla néanmoins considérablement cette proto-anthropologie qui nous occupe. Prichard, lui, ne lit dans le physique que le symptôme du culturel, à chaque époque de la civilisation correspond un ensemble strictement défini de caractères physiques : une couleur de peau, une morphologie et un volume crânien, par exemple (p. lxxxix). C’est dans cette optique qu’Adam, Ève, Noé (p. 555) et, d’une façon plus générale, « les plus anciennes nations dont nous ayons le souvenir, étaient des Nègres » (p. 473). Et c’est dans la même optique aussi que se situe son hypothèse surprenante que le teint du Nègre s’éclaircirait à mesure qu’il se christianiserait. Le niveau de la civilisation est la variable indépendante, la couleur de la peau, la variable dépendante. Le climat, qui pour Buffon ou Jauffret constituait le facteur déterminant la couleur de la peau, est pour Prichard à peine un facteur favorisant : « … dans ces races qui subissent l’effet de la civilisation, un climat tempéré augmente la tendance aux variétés claires » (p. 232).
Les Researches into the Physical History of Man comprennent deux parties d’importance sensiblement égale. Dans la première, Prichard s’efforce de montrer que la variété des types physiques humains n’excède pas celle que l’on rencontre couramment au sein des autres espèces animales ; il met ensuite en évidence que chaque espèce animale est issue d’une petite population unique dont on peut localiser le berceau, et qu’il en est de même pour l’homme. Dans la deuxième partie, il se fait fort de démontrer cette origine unique en reliant historiquement toutes les populations humaines. Il consacre un soin tout particulier à mettre en évidence que les anciens Égyptiens (p. 377) et les anciens « Hindous » (p. 392) étaient des Nègres originaires sinon de la même région, du moins de nations contiguës (p. 471). Plus d’un quart du volume est consacré à la démonstration de ce point particulier, que l’on retrouvera évoqué en des termes très semblables par les « migrationnistes » anglais (hyper-diffusionnistes), cent ans plus tard.
Le piège que nous tend involontairement le texte de Prichard est celui d’une familiarité trompeuse suggérée par une lecture transformiste. Piège d’autant plus réel qu’il est tentant de voir — comme n’hésite pas à le faire Penniman — une préfiguration du transformisme darwinien dans le fixisme de Prichard. Pourtant rien ne leur est commun : le paradigme biblique donne la totalité des espèces, ou tout au moins des genres, comme créée simultanément. C’est à l’intérieur de ce paradigme, et tout particulièrement chez Buffon, comme l’a montré Lovejoy (1959 : 84-113), que naît l’hypothèse qu’un seul type aurait été créé dans chaque genre, et que les différentes espèces se seraient constituées par « déviation naturelle » (p. 13) à partir de ce type. On conçoit alors l’impiété d’un Linné qui place les singes anthropoïdes aux côtés de l’homme dans le genre Homo, donc à l’intérieur de ce que les esprits éclairés considèrent un espace possible de « déviation naturelle ». C’est à ce mini-transformisme, qui ne déborde jamais les limites du genre, que s’apparente le fixisme de Prichard. Avant d’être un précurseur de Darwin, Prichard est donc d’abord un élève de Buffon, et c’est bien tel qu’il apparaissait à de Quatrefages huit ans après la parution de L’Origine des espèces: « Prichard est essentiellement de l’école de Buffon; mais on voit partout qu’il a su profiter des progrès de la science » (de Quatrefages 1867 : 17).
Prichard s’intéresse au mécanisme de cette déviation naturelle : « acquérir une idée des causes en général qui prédisposent principalement à la production des variétés » (p. 204). « Les climats ont des effets sur ces variations » (p. 207), mais « la cause de loin la plus puissante de l’évolution [sic] des variétés dans le règne animal est la domestication » (p. 208), car « les animaux à l’état sauvage se procurent une alimentation simple et peu variée, en quantités précaires et insuffisantes » (p. 208). « Dans la race humaine, la vie civilisée est à la condition des Sauvages, ce que, chez les animaux inférieurs, l’état domestique est à la condition naturelle ou sauvage » (p. 209). Cette opinion, qui explique l’intérêt porté par l’époque aux « hommes sauvages » d’une part, aux « enfants sauvages » d’autre part, sera reprise par Spencer et par Schopenhauer, et plus récemment encore banalisée par K. Lorenz. Prichard, lui, l’emprunte à Blumenbach, le fondateur d’une ethnologie basée sur la crâniologie : « L’homme est un animal domestique […] C’est par lui que les autres animaux domestiques ont été conduits à cet état de perfection. Il est le seul qui se soit mené soi-même à la perfection » (Blumenbach 1865 : 340).
On ne saurait conclure sans attirer l’attention sur une particularité de cet ouvrage composé de la réédition des Researches into the Physical History of Man et d’une longue introduction de Stocking. Il ne s’agit pas vraiment de la réédition longtemps attendue d’un classique de la littérature anthropologique devenu introuvable, mais plutôt d’un essai de Stocking, intitulé From Chronology to Ethnology, trop long pour faire un article, trop court pour faire un livre, suivi de la première version du principal ouvrage de Prichard, présenté là surtout à titre illustratif. Est-ce à dire que la lecture en soit inutile ? Pas nécessairement. Bien sûr, les données ethnographiques sont toutes de deuxième main et ne répondent pas toujours à nos critères d’authenticité, mais l’écriture de Prichard est extrêmement plaisante et l’humour vient toujours à propos voiler des articulations qui, sinon, seraient sans doute fort laborieuses. Les questions que Prichard pose, et auxquelles il répond quelquefois, nous sont bien entendu étrangères, elles ont cessé d’être légitimes au sein de notre domaine, mais on se prend souvent à songer qu’il s’agissait de questions premières auxquelles, préalablement à toute recherche empirique de terrain, une anthropologie digne de ce nom aurait dû répondre.
Quoi qu’il en soit de l’actualité de Prichard l’ethnologue, il est un autre Prichard qui demeure avec nous, c’est Prichard le philanthrope, membre de l’Aborigines Protection Society, créée pour remédier au « contraste surprenant entre le comportement des Britanniques chez eux et outre-mer » (Stocking 1971 : 370) ; la loi française interdisait la création d’un équivalent de l’Aborigines Protection Society, c’est pourquoi William Edwards, qui avait été pressenti par ses compatriotes britanniques, fonda, à partir d’un néologisme, la Société d’Ethnologie de Paris (Hunt 1865 : xcvi-xcvii). Celui qui, vers 1840, déclarait qu’ « une tache indélébile marquera les nations chrétiennes et civilisées quand il apparaîtra que, par la recherche égoïste de leur seul avantage, elles auront détruit et déplacé tant de familles et tant de nations, et ceci, sinon en les assassinant réellement — encore qu’il semble que la pratique se répande aujourd’hui —, du moins en les privant de leurs moyens de subsistance, et en les soumettant à la tentation de s’empoisonner elles-mêmes et de concourir ainsi à leur propre déchéance. Lorsque cette œuvre [de mort] sera arrivée à son terme, les seules excuses ou circonstances atténuantes que l’on pourra lui trouver seront celles qu’invoqua le premier meurtrier pour la mort de son frère. Et nous serions tentés de croire que ce récit fut toujours destiné à illustrer les temps où les Européens christianisés n’auront laissé sur la terre aucun vestige vivant de ces nombreuses races qui habitent aujourd’hui des régions lointaines, mais qui connaîtront bientôt le sort funeste que nous leur avons réservé, si nous persistons dans la méthode qui fut la nôtre jusqu’ici, depuis le temps de Pizarre et de Cortés jusqu’à nos colons anglais en Afrique du Sud » (cité par Hodgkin 1850 : 202).
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
BLUMENBACH, J. F.
1865 The Anthropological Treatises of Blumenbach and Hunter. Traduit par Th. Bendyshe. London.
BROCA, P. P.
1867 « Broca on Anthropology », The Anthropological Review 5 : 193-204.
BURROW, J. W.
1966 Evolution and Society. A Study in Victorian Social Theory, Cambridge University Press.
GAILLARD, Y.
1977 Buffon. Biographie imaginaire et réelle, suivie de Voyage à Montbard (1785) par Hérault de Séchelles. Paris, Hermann.
HADDON, A. C., with the help of A. H. Quiggin
1910 History of Anthropology. London, Watts & Co.
HARRIS, M.
1969 The Rise of Anthropological Theory. A History of Theories of Culture. London, Routledge & Kegan Paul.
HODGKIN, T.
1850 « Obituary of Dr. Prichard (1849) », Journal of the Ethnological Society of London II : 182-207.
HUNT, J.
1863 « Introductory Address on the Study of Anthropology, The Anthropological Review I : I-20.
1865 « The President’s Address » , Journal of the Anthropological Society of London 3: LXXXV – CXIII.
1866a « The President’s Address », JASL . : LIX-LXXXI.
1866b « On the Application of the Principle of Natural Selection to Anthropology. In reply to views advocated by some of Mr. Darwin’s disciples » The Anthropological Review 4 : 320-340.
KARDINER, A. & E. PREBLE
1961 They Studied Man. London, Socker & Warburg. (Trad. franç.: A. GUÉRIN, Introduction à l‘ethnologie. Paris, Gallimard, 1966.)
LOVEJOY, A. D.
1959 « Buffon and the Problem of Species », in B. GLASS, D. TEMKIN & W. L. STRAUSS, Forerunners of Darwin, 1745-1859. Baltimore, The Johns Hopkins Press : 84-103.
LOWIE, R.
1937 The History of Ethnological Theory. New York, Holt, Rinehart & Winston. (Trad. franç. : H. GREMONT & H. SADOUL, Histoire de l’ethnologie classique des origines à la Deuxième Guerre mondiale. Paris, Payot, 1971.)
PENNIMAN, T. K., with the help of B. Blackwood & J. S. Weiner
1935 A Hundred Years of Anthropology. 3rd ed., London, Duckworth, 1965.
QUATREFAGES, A. DE
1867 Rapport sur les progrès de l‘anthropologie. Paris.
STOCKING, G.
1971 « What’s in a Name ? The Origins of the Royal Anthropological Institute », Man, n.s., 6 (3) : 369-390.
SYMONDS, J. A.
1849 Some Account of the Life and Character of the Late James Cowles Prichard. Bristol.
VOGET, F. W.
1975 A History of Ethnology. New York, Holt, Rinehart & Winston.
Laisser un commentaire