La vidéo en anglais ici.
Sur le blog : Le Présent holographique :
Un précis de la théorie de la conscience par résonance à flux croisés (CFRT)
Le podcast NotebookLM (beaucoup plus détaillé) : Une théorie révolutionnaire de la conscience : CFRT (Cross-Flow Resonance Theory)
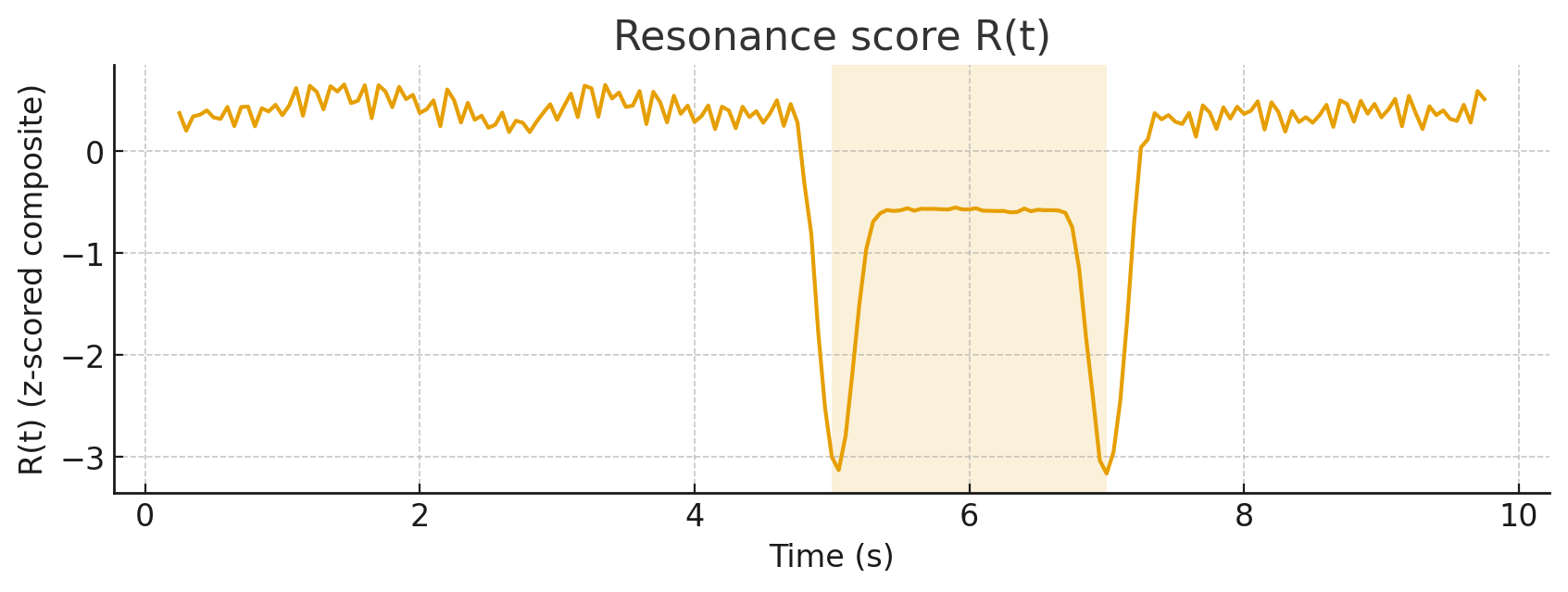
Répondre à CloClo Annuler la réponse