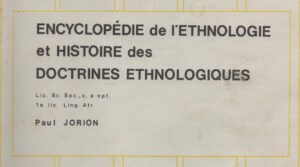
James George Frazer (1854-1943)
A paru dans les notes de mon cours Encyclopédie de l’ethnologie et histoire des doctrines ethnologiques publiées aux Presses Universitaires de Bruxelles en 1979, pp. 24-27.
Sir James Frazer est né en 1854 dans la classe moyenne de la ville écossaise de Glasgow. Il devint en1873, fellow de Trinity College à Cambridge grâce à un mémoire sur Platon. Il fut nommé en 1908 détenteur de la première chaire nommée « Anthropologie sociale » à l’Université de Liverpool. Il n’enseignera qu’un an, détestant cordialement l’enseignement. Jusqu’à sa mort en 1943, il demeurera à Cambridge produisant volume sur volume. Il n’aura que des rapports extrêmement limités avec le monde extérieur, laissant à son épouse, autrice française, le soin de lui servir de public relations, d’attaché de presse et de rewriter. Son influence dépassera de beaucoup le milieu de l’anthropologie, elle sera entre autres massive dans les études classiques. Son conformisme social et sa plume agréable contribueront à familiariser le grand public avec la littérature anthropologique.
Edmund Leach, qui est parmi les anthropologues de la second moitié du XXe siècle celui qui s’est le plus intéressé à Frazer – dont il ne parvient d’ailleurs pas à comprendre la gloire passée – a classé l’œuvre de Frazer sous six rubriques :
1) Traductions et éditions des auteurs classiques
Frazer consacra plusieurs volumes à Pausanias, présenta les Fasti d’Ovide et édita une édition de Salluste pour les écoles.
2) Écrits consacrés au concept d’« âme »
The Belief in Immortality and the Worship of the Dead. 3 vol. (1915/22).
The Fear of the Dead in Primitive Religion (1933)
Autant de textes qui développent les idées exprimées par Tylor dans son Primitive Culture (1871).
3) Écrits consacrés au totémisme
Totemism and Exogamy 4 vol. (1910).
Totemica (1937).
4) Le folklore de l’Ancien testament
Folklore in the Old Testament 3 vol. (1918)).
5) Une version abrégée de la bible
Passages of the Bible : Chosen for their literary beauty and interest by J.G. Frazer (4 éditions à partir de 1895).
6) Le Rameau d’Or et ouvrages apparentés
The Golden Bough, 1 vol. en 1890, 3 vol. en 1900, 12 vol. en 1915, plus un 13ème vol. en 1937.
Psyche’s Task (1909).
The Worship of Nature (1926).
Mis à part l’enthousiasme inébranlable de Malinowski pour l’œuvre de Frazer, les anthropologues ont en général été très critiques envers ce compilateur manquant singulièrement d’imagination mais dont l’érudition était stupéfiante, voire même inquiétante du fait de son caractère manifestement obsessionnel. Frazer refusait de lire les comptes-rendus de ses ouvrages, toute critique l’affectant profondément. Le folkloriste Andrew Lang, son confrère, s’étant moqué de l’intérêt qu’il portait aux cultes consacrés aux légumes, qualifiant l’œuvre de Frazer de « variété Covent Garden de l’anthropologie » (Covent Garden est le principal marché aux légumes de Londres), il en fut à ce point affecté qu’il resta au lit plusieurs semaines.
L’œuvre de Frazer repose sur le principe évolutionniste supposant que toute société passe nécessairement par une série de mêmes stades, culminant dans la « civilisation ». Il est possible en conséquence de reconstituer une histoire universelle en empruntant des données à l’ensemble des cultures. En conformité avec la logique de la « survivance » mise au point par Tylor, Frazer complétait notre connaissance archéologique et littéraire de l’antiquité par des données empruntées au folklore contemporain, mais aussi aux sociétés qualifiées de « primitives » dans la logique évolutionniste.
On trouve par exemple chez Frazer un texte biblique « expliqué » par une procession religieuse contemporaine ou une cérémonie australienne « expliquée » par un récit de la mythologie grecque. Le Rameau d’Or est tout entier fondé sur un tel canevas évolutionniste. L’anecdote qui sert de prétexte à lancer ce qui deviendra une véritable saga en treize volumes est la légende rapportée par Ovide que le prêtre de Diane à Aricia, sur les rives du lac de Némi en Italie, était assassiné par celui qui deviendrait son successeur, après que celui-ci avait coupé un rameau d’un arbre dont les branches étaient, affirmait-on, en or. S’ensuivit un gigantesque périple où nous étions invités à explorer systématiquement la totalité des coutumes et mythologies du genre humain.
Frazer remplissait des cahiers entiers (certains qui ont été conservés, et que j’ai pu consulter, ressemblent à de véritables bottins) de renseignements glanés dans le monde entier et relatifs aux thèmes qu’il avait retenus, et qu’il consignait alors sur des tickets de vestiaire collés ensuite soigneusement sur des pages vierges. Les éditions successives de ses œuvres étaient composées en interpolant tout ce qu’il avait pu découvrir comme information supplémentaire entre deux éditions. Frazer était en réalité incapable de résumer ou de synthétiser ce que des anthropologues davantage portés vers la réflexion auraient considéré comme un simple matériau préparatoire, au point de parfois recopier côte à côte des interprétations contradictoires du même fait. Macmillan, son éditeur, dut à plusieurs reprises réfréner son enthousiasme à publier. Après sa mort, Angus Downie, son secrétaire, crut nécessaire de faire publier encore de copieux volumes de notes inutilisées.
Frazer estimait faire œuvre de littérature plutôt que de science, une opinion valide, toute réflexion théorique étant pratiquement absente de son œuvre. Il se vantait d’« ajouter le charme magique du style » à des citations empruntées à d’autres. Leach a voulu comparer les textes originaux à leur version « améliorée » par les soins de Frazer, pour mettre en évidence les distorsions de sens intervenues à cette occasion. Il est indéniable que son ton est plaisant, et l’une de ses disciples, Jane Harrison, parle de son « génie pour les titres ». C’est d’ailleurs lui qui a conseillé à Bronislaw Malinowski d’intituler son premier ouvrage Argonautes du Pacifique Occidental, au lieu de Troc primitif. Un livre consacré à l’esprit d’entreprise et d’aventure dans les mers du Sud, le titre beaucoup moins vendeur certainement que le Polonais avait lui retenu.
Leach caractérise à juste titre l’œuvre de Frazer de « cartographie des coutumes », il ajoute toutefois peu charitablement que « tel un mauvais avocat, il accumule les arguments les plus hétéroclites pour dérouter le jury ». L’œuvre actuelle qui rappelle sans doute le mieux celle de Frazer, malgré son intention toute différente, est celle de Tolkien.
Frazer était un disciple et un ami de William Robertson Smith (il lui dédiera Le Rameau d’Or) et c’était d’ailleurs celui-ci qui avait décidé de sa carrière en lui confiant la rédaction des articles « totémisme » et « tabou » dans une nouvelle édition de l’Encyclopædia Britannica. Toutefois, contrairement à Robertson Smith, l’esprit sociologique était étranger à Frazer, et il attribuait aux grandes institutions une origine personnalisée : chacune avait son inventeur, comme Prométhée pour le feu.
Les trois théories du totémisme de Frazer sont celles-ci :
1) le totémisme a pour origine la coutume de confier son âme à une plante ou un animal particulier. L’espèce entière est ensuite associée.
2) le totémisme est une institution qui organise la coopération entre les différentes parties d’une société. Il assure une sorte de protection « écologique » d’une espèce.
3) le totémisme dérive d’une coutume qui veut qu’une femme voue son enfant à naître à une espèce naturelle qui lui servira d’ « ange gardien ».
Même si elle est fausse, seule la deuxième explication nous fait encore sens aujourd’hui ; Malinowski la reprendra dans son premier article en anglais : « The Economic Aspect of the Intichiuma Ceremonies » (1912).
La théorie de la magie de Frazer est elle banale, mais on la voit encore occasionnellement défendue de nos jours : « La magie repose sur des erreurs. En conséquence, d’un point de vue théorique, elle est une pseudo-science, tandis que d’un point de vue pratique, elle est une pseudo-technique, celle-ci se subdivisant en une magie positive : la sorcellerie, et une magie négative : le tabou. »
D’une manière générale, Frazer parle avec condescendance des sociétés traditionnelles comme composées de « primitifs » se trompant sur à peu près tout, ses propos étant d’ailleurs toujours empreints d’un racisme candide. Pour lui, le principe explicatif de tout raisonnement qui n’est pas à proprement parler scientifique est la « folie humaine ». Il fait le compte-rendu de l’ensemble des croyances en les intégrant dans une vaste fresque historique, extrayant chaque coutume du contexte où elle pourrait en fait avoir un sens : sa « méthode comparative » est aux antipodes de l’approche sociologique qui sera défendue par l’anthropologie fonctionnaliste qui naîtra dans les années 1920. En n’avançant que des bribes d’explication théorique, Frazer évite bien entendu de se tromper comme l’avait fait son prédécesseur immédiat Tylor, mais le fatras qu’il nous propose de faits hétéroclites, rapprochés de manière plus ou moins convaincante, n’est pas nécessairement plus éclairant.
Sir James Frazer n’a jamais envisagé de se rendre sur le terrain pour y observer le fonctionnement d’une coutume primitive « in situ ». On raconte à son sujet l’anecdote suivante, peut-être véridique : quand on lui demanda un jour s’il avait jamais rencontré un « Sauvage » en chair et en os, il aurait répondu : « Dieu m’en préserve ! » Il avait toutefois un intérêt prodigieux pour la collecte de nouvelles informations relatives aux populations « primitives » et il s’était constitué dans les nations exotiques un réseau de correspondants à qui il confiait un questionnaire extrêmement détaillé portant sur les us et coutumes des populations avec lesquelles ils étaient en contact.
Depuis la disparition de Frazer (1943) et de Malinowski (1942), les anthropologues n’ont cessé de s’interroger sur l’admiration que Malinowski professait pour celui qu’il considérait comme son maître. Comme il est impossible de découvrir même un seul point commun entre l’œuvre des deux anthropologues, la question se pose effectivement. Deux éléments fournissent un début de réponse : d’une part Malinowski, jeune anthropologue polonais, ressentait le besoin de se placer sous l’aile protectrice d’une autorité (même contestée) s’il voulait faire carrière en Angleterre, il était d’autre part très préoccupé de la place qu’occupait l’anthropologie dans l’esprit du public et de ce point de vue, Frazer était le vulgarisateur connu de tous des « coutumes primitives », ce qui garantissait un auditoire à ceux qui se réclamaient de lui. Malinowski n’affirmait-il pas que Frazer « avait mis l’anthropologie sur un pied d’égalité avec les études classiques » ?
Laisser un commentaire