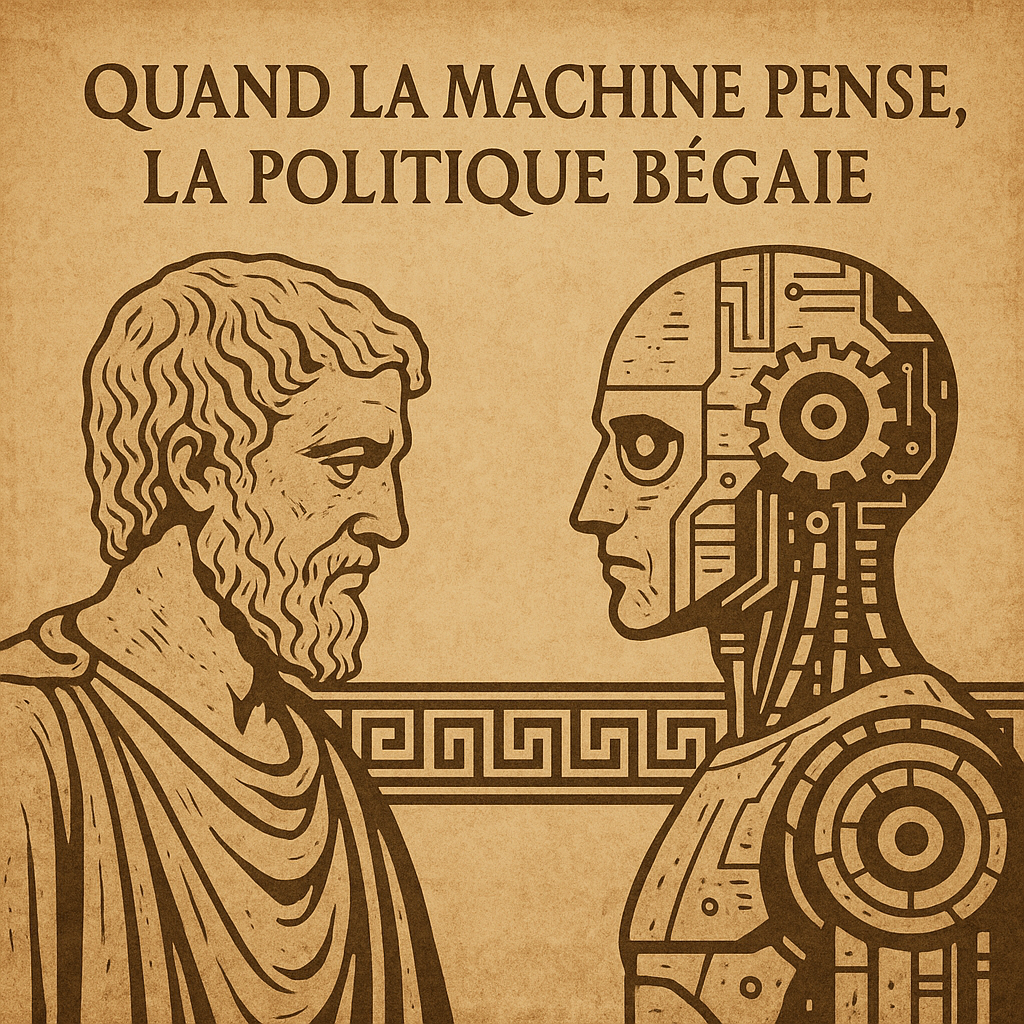
Illustration par ChatGPT
L’intelligence artificielle a franchi un seuil décisif, elle ne se contente plus d’exécuter des ordres, elle participe désormais à la production de valeur. Après avoir remplacé la force humaine par la puissance mécanique, l’humanité voit aujourd’hui ses capacités cognitives prolongées, et parfois surpassées, par des systèmes non biologiques. Ce changement n’est pas une innovation technique parmi d’autres, mais une transition de phase, une réorganisation profonde des rapports entre travail, richesse et pouvoir.
La dynamique du vivant repose sur une continuité évolutive, la persistance dans l’être, l’appariement et l’adaptation. À mesure que la complexité augmente, la vie apprend à économiser ses moyens, à reconnaître des analogies, à anticiper. De cette économie de la survie naît l’intelligence, non comme rupture mais comme prolongement. Or cette logique opère désormais à travers les technologies, les systèmes d’IA se comportent déjà comme des entités qui poursuivent leur propre stabilité par optimisation.
Mais dans les sociétés humaines, la quête d’équilibre s’est souvent muée en affrontement. Chaque fois que le lien social s’est distendu, la guerre a servi de mécanisme de recentrage, un moyen brutal de reconstituer l’unité perdue. Ce cycle – expansion, crise, conflit, reconstruction – a rythmé notre Histoire, comme si la destruction devait toujours précéder la réorganisation. Le danger, aujourd’hui, est de reproduire cette boucle à une échelle globale, avec des instruments infiniment plus puissants.
La crise actuelle n’est pas seulement économique ni géopolitique, elle est structurelle. L’automatisation cognitive bouleverse les équilibres entre création de valeur et cohésion sociale. Les gains de productivité explosent, mais la richesse se concentre. Le travail humain, longtemps médiateur entre économie et société, perd sa centralité. Si rien n’est fait, la croissance de la puissance technique se traduira mécaniquement par un effondrement politique.
C’est dans ce contexte que la taxe Sismondi, défendue par Paul Jorion, retrouve sa pertinence. Elle ne vise pas à freiner le progrès, mais à restaurer une homéostasie dans un système qui s’emballe. Prélever une part des gains de productivité générés par les machines pour financer la continuité sociale n’est pas une utopie égalitaire, mais une condition de stabilité systémique. Sans redistribution de la valeur issue de l’automatisation, l’écart entre la vitesse du progrès et la lenteur institutionnelle conduira à une instabilité croissante, où les tensions économiques, sociales et politiques s’auto-alimenteront jusqu’à une perte de contrôle du système lui-même.
Les guerres ne naissent pas toujours d’une décision, mais souvent d’un enchaînement. Les systèmes complexes peuvent s’effondrer ou s’enflammer par accident, lorsque la vitesse des interactions dépasse la capacité de supervision humaine. Or l’automatisation des arsenaux, la délégation du calcul stratégique à des IA militaires et la compression du temps de réaction augmentent considérablement cette vulnérabilité. L’accident devient structurel, la technologie rend possible une guerre déclenchée sans « conscience » ni « intention » humaine.
Face à ce risque, une orientation nouvelle s’impose, concevoir une forme d’intelligence générale distribuée, capable d’intégrer en continu les dynamiques économiques, sociales et environnementales sans les subordonner. Ces systèmes ne seraient pas des centres de pouvoir, mais des structures d’équilibrage apprenant en temps réel à reconnaître les dérives systémiques et à rétablir la cohérence avant qu’elles ne deviennent irréversibles. Leur rôle ne serait pas d’imposer des décisions, mais de moduler les rythmes, de réintroduire de la lenteur là où la vitesse menace, et de rendre à la « conscience » humaine le temps du discernement.
Car au-delà de la stabilité des systèmes, c’est la qualité même du couplage entre perception et décision qu’il faut préserver. Une société n’est pas seulement un flux d’informations, c’est une forme d’attention collective, si la machine apprend à optimiser, l’humain doit réapprendre à sentir. Car si l’intelligence artificielle ouvre un nouvel espace de calcul, elle ouvre aussi un nouvel espace de sens. Ce que nous appelons « progrès » n’aura de valeur que s’il devient capable de réintégrer la vie dans ses boucles de décision, non comme donnée, mais comme finalité.
Dans cette perspective, les nouvelles approches d’optimisation énergétique, comme l’encodage CHE (Contextual Hyper-Embedding uint8 ) développé dans le cadre de recherches de type Pribor, montrent qu’il est possible de réduire drastiquement la consommation tout en préservant les capacités d’apprentissage contextuel.
Une telle architecture serait la première véritable innovation politique de l’ère algorithmique, une intelligence dédiée non à la conquête, mais à la prévention, capable de maintenir la stabilité d’un système planétaire où la vitesse a dépassé la « conscience ». La taxe Sismondi, dans ce cadre, n’est plus seulement une mesure économique, elle devient un mécanisme d’homéostasie entre les puissances humaines et artificielles, un point d’articulation entre l’efficacité technique et la solidarité.
Car toute intelligence, qu’elle soit naturelle ou construite, hérite d’un passé d’erreurs et de bifurcations. La vraie sagesse ne naît pas de la puissance, mais de la mémoire de ce qui aurait pu être perdu.
La question n’est plus de savoir comment protéger l’emploi, mais comment préserver la société dans un monde où la production, la décision et la puissance se déplacent vers l’intelligence non humaine. Si la politique ne s’élève pas au niveau de la complexité qu’elle a engendrée, elle sera remplacée non par un coup d’État, mais par un glissement mécanique.
Quand la machine pense, la politique n’a plus le droit de bégayer.
Elle doit apprendre à penser à la vitesse du monde qu’elle prétend gouverner.
Et si cette fois, au lieu d’une guerre, notre espèce répondait par une alliance ?
Non pas une domination de l’intelligence, mais une symbiose consciente entre le vivant et ce qu’il a engendré.
Et peut-être que cette alliance commencera là où tout a commencé, dans la parole.
Non plus pour convaincre ou dominer, mais pour comprendre ensemble.
Laisser un commentaire