A paru dans les notes de mon cours Encyclopédie de l’ethnologie et histoire des doctrines ethnologiques publiées aux Presses Universitaires de Bruxelles en 1979, pp. 8-12.
Né à Cérilly dans l’Allier, mort de tuberculose au même endroit à l’âge de trente-cinq ans.
François Péron est le premier anthropologue de terrain proprement dit. Il participa à l’expédition du Commandant Baudin aux Terres Australes de 1800 à 1804 au titre d’« Élève Zoologiste » (lui-même se considérait comme un « anthropologiste »). Embarqué à la dernière minute sur la corvette Le Géographe en remplacement d’un démissionnaire, il était l’un des cinq naturalistes de l’expédition. Deux de ceux-ci ayant quitté l’expédition à la suite de dissensions avec le Commandant Baudin (1) et deux autres étant morts, Péron demeura le seul naturaliste de l’expédition. Il eut l’occasion d’observer les habitants de Timor, mais aussi les Tasmaniens qu’il décrivit longuement, laissant ainsi un témoignage capital sur ce peuple qui serait exterminé moins de trois quarts de siècle plus tard. Il fut chargé de rédiger le compte rendu de l’expédition, il n’eut malheureusement l’occasion que d’en rédiger le premier volume, publié en 1807, c’est Louis Freycinet, un futur amiral, qui rédigea le second volume, les illustrations étaient dues au dessinateur Lesueur qui accompagna l’expédition et collabora constamment avec Péron. Celui-ci n’eut pas le temps de publier sous une forme séparée ses réflexions anthropologiques. Certains de ses « mémoires » sont repris in extenso ou sous forme abrégée dans ces deux volumes du Voyage de découvertes aux Terres Australes, c’est le cas pour ses mémoires sur le tablier des femmes Hottentotes ou Boschimans, sur l’usage du bétel et sur la force des sauvages comparée à celle des peuples civilisés. Au moment de sa mort, il projetait aussi une Histoire philosophique des divers peuples considérés sous les rapports physiques et moraux qui aurait encore exigé trois voyages, un en Europe septentrionale et en Asie, un autre aux Indes et le troisième en Amérique.
Péron est un personnage particulièrement attachant (2). Engagé dans l’armée de la République à l’âge de dix-sept ans, il est blessé et fait prisonnier en Allemagne. Il est échangé en 1794, alors qu’il a définitivement perdu l’usage de l’œil droit. Il étudie la médecine puis interrompt brutalement ses études à la suite d’une déception amoureuse : l’élue de son cœur lui est refusée en raison de son manque de fortune. Il décide de s’exiler afin, dit Deleuze qui écrira son éloge en 1811, de « chercher un genre de gloire qui puisse le dédommager du bonheur paisible auquel il aspirait ».
Au moment du départ du Géographe, il rédige un autoportrait qui semble en accord avec ce qui apparaîtra de lui au cours de l’expédition :
Étranger au ton et aux usages de la société, ayant une imagination impétueuse que l’autorité ne commanda jamais, d’une franchise imprudente et quelquefois malhonnête, trop entier dans mes opinions que je soutiens sans réserve, plein d’étourderie et d’inconséquence, j’ai souvent aliéné mes amis ; mais sitôt que la passion cède à la raison, je rougis de mon emportement ; je viens trouver ceux que j’ai offensés ; mes regrets, mes excuses sont trop sincères pour qu’ils ne me pardonnent pas mes torts. Aussi tous les amis que j’ai eus, soit au collège, soit aux armées, soit à Paris, me restent encore : il en est peu qui n’aient eu à se plaindre de moi : tous cependant me sont aussi attachés que je leur suis moi-même.
Ayant entendu parler de l’expédition aux Terres Australes mise sur pied par le Museum d’Histoire Naturelle et patronnée par l’Institut, il demande à en faire partie. Malheureusement, l’expédition est au complet, Jussieu lui conseille cependant de mettre sa demande par écrit, et il a ainsi l’occasion de lire devant l’Institut son mémoire intitulé très explicitement : Observations sur l’anthropologie, ou l’histoire de l’homme, la nécessité de s’occuper de l’avancement de cette science et l’importance de l’admission par la flotte du Capitaine Baudin, d’un ou de plusieurs naturalistes chargés de recherches à faire à ce sujet. Il y écrivait entre autres ceci : « Il est certainement extraordinaire de récolter la mousse inerte qui croît sur la neige éternelle des pôles, ou de poursuivre au cœur brûlant du Sahara ces reptiles hideux que la Nature semble avoir exilés là pour nous protéger de leur fureur ; mais, ayons le courage de le dire, serait-ce moins extraordinaire, moins utile à la société, d’envoyer aux côtés des naturalistes de cette expédition quelques jeunes médecins spécialement entraînés dans l’étude de l’homme lui-même, pour enregistrer tout ce qui serait d’intérêt dans ces matières morales et physiques que les divers peuples auraient à révéler, leur habitat, leurs traditions, leurs coutumes, leurs maladies internes et externes, et les remèdes qu’ils utilisent ».
Péron dut convaincre puisque quand une place fut vacante il fut nommé remplaçant.nContrairement à bien de ses collègues, il ne songea jamais à quitter l’expédition qui se déroula dans une atmosphère pénible en raison de l’animosité qui exista d’emblée entre Baudin et les savants embarqués. Baudin considérait ceux-ci trop nombreux, il les trouvait arrogants et plus prompts à la discussion oiseuse qu’à l’observation. Péron apparut rapidement comme le chef de file des savants dans la fronde qui les opposa à Baudin. Scott (3) qui a étudié le Journal de bord de Baudin a mis en évidence qu’il était un piètre navigateur, ce qui était apparemment aussi l’opinion de l’Empereur d’Autriche pour qui il avait auparavant dirigé une expédition scientifique autour du monde sur La Jardinière. Il devait regagner une partie de l’estime de ce qu’il lui restait d’équipage en mourant courageusement de pneumonie sur le chemin du retour. Tout en fait favorisait une opposition entre les deux hommes, d’un côté le marin autoritaire, incarnation des valeurs de l’Ancien régime, qui prenait un malin plaisir à déconcerter ses passagers par sa navigation imprévisible et face à lui, le jeune homme d’origine modeste, héros de la Révolution jouant un rôle de Tijl Uilenspiegel dans la rébellion larvée qui l’oppose au commandant.
Péron disposait de deux mémoires d’instructions sur la tâche anthropologique qu’il avait à remplir, l’un touchait à l’ « homme moral » : les Considérations sur les diverses méthodes à suivre dans l’observation des peuples sauvages de Degérando, l’autre à l’ « homme physique », la Note instructive sur les recherches à faire relativement aux différences anatomiques des diverses races d’homme de Georges Cuvier, alors un jeune savant d’avenir. En fait l’expédition dont la tâche principale était géographique et cartographique exigeait un lent cabotage et se prêtait donc particulièrement mal aux longs séjours à terre dont Péron avait besoin pour réaliser son programme anthropologique.
En conséquence, Péron se rendait à terre sans autorisation ou s’arrangeait pour ne pas rembarquer en temps utile afin de poursuivre ses approches des « Sauvages ».
Celles-ci furent souvent très courageuses, et Péron courut des dangers physiques réels en s’efforçant d’engager le dialogue avec des Aborigènes sur la défensive. Une de ces rencontres mérite d’être rapportée dans les termes mêmes de Péron :
Déjà, nous n’étions plus qu’à peu de distance de la troupe, lorsque tout à coup elle se rejeta dans la forêt et disparut. Nous gravîmes alors les dunes ; et sans chercher à poursuivre les naturels, ce que l’agilité particulière à ces peuples auroit rendu trop inutile, nous nous contentâmes de les appeler, en leur présentant divers objets, et surtout en agitant nos mouchoirs. À ces démonstrations d’amitié, la troupe hésite un instant, s’arrête ensuite, et se détermine à nous attendre. Ce fut alors que nous reconnûmes que nous avions affaire à des femmes ; il n’y avoit pas un individu mâle avec elles.
Nous nous disposions à les joindre de plus près, lorsqu’une des plus âgées d’entre elles, se détachant de ses compagnes, nous fait signe de nous arrêter, et de nous asseoir, en nous criant avec force, médi, médi (asseyez-vous, asseyez-vous) ; elle sembloit nous prier aussi de déposer nos armes, dont la vue les épouvantoit.
Ces conditions préliminaires ayant été remplies, les femmes s’accroupirent sur leurs talons ; et dès ce moment elles parurent s’abandonner sans réserve à la vivacité de leur caractère, parlant toutes ensemble, nous interrogeant toutes à la fois, ayant l’air souvent de nous critiquer et de rire à nos dépens, faisant, en un mot, mille gestes, mille contorsions aussi singulières que variées. M. Bellefin se mit à chanter, en s’accompagnant de gestes très vifs et très animés ; les femmes firent aussitôt silence, observant avec autant d’attention les gestes de M. Bellefin, qu’elles paroissoient en prêter à ses chants. À mesure qu’un couplet étoit fini, les unes applaudissoient par de grands cris, d’autres rioient aux éclats, tandis que les jeunes filles, plus timides sans doute, gardoient le silence, témoignant néanmoins, par leurs gestes et par l’expression de leur physionomie, leur surprise et leur satisfaction.
Après que M. Bellefin eut terminé sa chanson elle se mit à contrefaire ses gestes et son ton de voix d’une manière fort originale et très plaisante, ce qui divertit beaucoup ses camarades : puis elle commença elle-même à chanter sur un mode tellement rapide qu’il eût été difficile de rapporter une telle musique aux principes ordinaires de la nôtre.
Incitée, pour ainsi dire, par ses propres chants, auxquels nous n’avions pas manqué d’applaudir avec chaleur, et voulant sans doute mériter nos suffrages sous d’autres rapports, notre jovial Diéménoise [« Terre de van Diemen » = Tasmanie] se mit à exécuter divers mouvements de danse, dont quelques-uns pourroient être regardés comme excessivement indécens, si dans cet état des sociétés l’homme n’étoit encore absolument étranger à toute cette délicatesse de sentimens et d’actions qui n’est pour nous qu’un produit heureux du perfectionnement de l’ordre social.
Comme elles revenoient vraisemblablement de la pêche lorsque nous les avions aperçues, elles étoient toutes chargées de gros crabes, de langoustes et de divers coquillages grillés sur les charbons, qu’elles portoient dans leurs sacs de jonc. Ces sacs étoient fixés autour du front par un cercle de cordage, et pendoient de là derrière le dos : quelques-uns étoient très lourds ; et nous plaignions bien sincèrement ces pauvres femmes d’avoir à traîner de pareils fardeaux. Notre route toutefois ne fut pas moins gaie que notre entrevue ; et du sommet des dunes on nous envoyoit force plaisanteries, force agaceries, auxquelles nous tâchions de répondre le plus expressivement qu’il nous étoit possible… (pages 251-255).
On se doute que la contribution théorique de Péron à l’anthropologie est insignifiante, le temps lui a manqué pour la rédaction, sans doute, mais les conditions dans lesquelles il a pris contact avec les Australiens ont été particulièrement mauvaises, d’une part en raison d’autres priorités de l’expédition, d’autre part du fait qu’il s’agissait de populations qui n’avaient encore eu aucun contact avec des Occidentaux. On considère normal aujourd’hui qu’un anthropologue s’installe dans un village de son choix, mais au début du XXe siècle encore, on considérait qu’une telle pratique n’était pas possible partout. Dans un rapport sur les possibilités de recherche ethnographique de terrain, Rivers notait en 1913 : « Une telle étude intensive (….) n’est pas réalisable dans une population qui n’a pas encore été touchée par l’influence occidentale. Un accueil amical et un environnement paisible sont essentiels à la réalisation d’une telle recherche (….). Le moment le plus favorable à l’étude ethnographique se situe sans doute de dix à trente ans après qu’une population est entrée en contact avec une administration ou avec des missionnaires » (Rivers, Report on anthropological research outside America, 1913).
La seule contribution ethnographique authentique de Péron aura été son Mémoire sur la force des sauvages comparée à celle des peuples civilisés, qui lui aura permis de découvrir que contrairement à ce que supposait une hypothèse rousseauiste, « la force physique se développe bien en parallèle avec la force morale que procure la civilisation ». Le fait que Péron ait lu ses mesures sur la mauvaise échelle de son dynamomètre a été corrigé ultérieurement par Freycinet.
Les contributions de Péron à l’histoire naturelle sont plus substantielles puisqu’on compte qu’il rapporte 2 500 espèces nouvelles (pour lesquelles il sacrifia sa ration de tafia et celle de certains de ses collègues qu’il convainquit de participer à ses conserves). C’est ainsi qu’il fut le premier à découvrir l’origine animale de la phosphorescence marine (Sur le genre pyrosoma), il écrivit Sur la température de la mer, Sur les zoophytes pétrifiés trouvés dans les montagnes de Timor (il s’agissait de coraux fossiles), Sur l’habitation des phoques, enfin il écrivit l’Histoire complète des méduses qui resta partiellement inédite. Cet homme modeste et pauvre qui avait demandé au Ministre de la Marine l’autorisation de se présenter chez lui avec l’habit le plus simple s’éteignit dans les bras de son ami Lesueur le 14 décembre 1810. Suivant l’usage du temps, dans la phase finale d’une tuberculose, on avait placé son lit dans une étable où on ne le nourrissait que de lait de vache. Il but une dernière goutte de lait, serra la main de Lesueur et s’éteignit à l’âge de trente-cinq-ans.
Il avait été le premier anthropologue de terrain.
(1) Bory de Saint-Vincent, un pionnier de l’anthropologie française était l’un d’eux ; devançant Pruner-Bey d’un demi-siècle, il proposa la couleur et la texture des cheveux comme critère du classement des races.
(2) Ce n’est pas l’avis de tous ; E. G. Moore qui traduisit en anglais les Considérations sur les diverses méthodes à suivre dans l’observation des peuples sauvages de Degérando, et présenta la Société des Observateurs de l’Homme et l’expédition du Commandant Baudin, le décrit comme un personnage ridicule et inefficace.
(3) E. Scott. Terre Napoléon, London 1910.
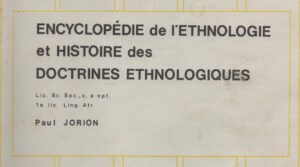
Répondre à juannessy Annuler la réponse