Traduction d’un texte inachevé en anglais de 1986 [Merci DeepL !]. Certains des points esquissés, plus particulièrement ceux qui touchent à l’Intelligence Artificielle, seront développés ultérieurement dans Principes des systèmes intelligents (Masson 1989).
Ce n’est que l’année suivante que Robert Linggard m’offrirait de participer aux travaux du Connex Project qu’il mettait sur pied chez British Telecom. Au moment où j’écris le texte qui suit je ne pense pas encore en termes de programmation, je n’en suis encore qu’à mettre à plat la métapsychologie freudienne pour la reformuler en des termes qui permettront son implémentation en un logiciel d’Intelligence Artificielle. La concrétisation du projet, ce sera ANELLA (Associative Network with Emergent Logical and Learning Abilities = réseau associatif aux propriétés émergentes de logique et d’apprentissage) que je programmerai de 1987 à 1989.
Quoi qu’il en soit, mes efforts de conceptualisation en 1986 dans des textes comme celui-ci ne seront pas vains : c’est sur leur foi que Roger Schank m’invitera l’année suivante à Yale pour exposer mes vues à ses étudiants et chercheurs du « Yale Artificial Intelligence Project ».
Un Modèle Psychanalytique pour l’Intelligence Artificielle
Résumé
Un nouveau paradigme pour l’intelligence artificielle est ici proposé. Il prend sa source dans la psychanalyse conçue comme un art thérapeutique. Ce nouveau paradigme diffère du courant dominant actuel sur deux points :
1) en affirmant que les dispositifs psychiques humains sont de structure simple, éclectique et, bien que résistants, facilement altérés;
2) en affirmant également que la plupart de l’apparente sophistication de l’esprit humain ne résulte pas de sa mécanique interne mais des propriétés d’auto-organisation de l’interaction humaine.
1. Introduction
L’objectif de cet article est de proposer aux experts en IA un paradigme alternatif aux paradigmes existants, basé sur un modèle psychanalytique de l’esprit humain et du fonctionnement de la personne humaine dans un monde essentiellement humain. Mon but n’est pas de défendre une cause, je n’ai pas l’intention de convertir qui que ce soit à une quelconque doctrine existante. J’ai simplement l’intention de proposer à l’expert en IA un modèle opérationnel basé sur les observations et les hypothèses recueillies par les praticiens d’une technique thérapeutique utilisée pour remédier aux dysfonctionnements de la personne humaine dans le monde humain. Par opérationnel, j’entends que je souhaite que mon modèle puisse déboucher directement sur une mise en œuvre dans la sous-discipline de l’informatique appelée Intelligence Artificielle. Ainsi, ce que je tente ici est une expérience de traduction: Je propose à l’expert en intelligence artificielle une représentation de l’esprit humain qui risque de lui être peu familière, dans des termes que j’espère avoir choisis parmi ceux qui lui sont familiers.
Les avantages de cette expérience sont, selon moi, les suivants : fournir à l’IA un paradigme plus sophistiqué que celui ou ceux dont elle dispose actuellement. Par « plus sophistiqué », je n’entends pas nécessairement plus complexe; on verra même que l’IA a déjà mis au point des dispositifs artificiels dont la conception est plus complexe que ce que l’on est susceptible de trouver chez l’être humain (par exemple, le réseau sémantique fonctionnant comme Mémoire de base, est – d’après les données psychanalytiques – plus simple, bien que différent dans son concept, que des modèles tels que HAM ou MEMOD). Ce que j’entends par « plus sophistiqué » est « plus réaliste » en tant que rendu des circonstances humaines réelles. En disant cela, je dois préciser que cela n’impliquera pas de soulever une objection métaphysique à la faisabilité du programme d’IA : la psychanalyse est une théorie résolument matérialiste et ne s’oppose pas à l’élucidation. Je soulignerai toutefois la nature essentiellement interactive (« résonante ») de la personne humaine, qui est le plus souvent occultée dans les études psychologiques par une présomption d’autonomie du sujet humain découlant de l’accent mis sur les tests expérimentaux dans des environnements de laboratoire contrôlés. Une autre différence majeure entre la psychologie et la psychanalyse réside dans le fait que la première considère le sujet humain comme un maître de la parole, un « locuteur », tandis que la seconde le considère comme un être « parlé » quelque peu passif, rendant ainsi directement compte de l’intersubjectivité telle qu’elle est inscrite dans la structure même du langage.
Une faiblesse souvent soulignée de la psychanalyse se révèle en les circonstances être une force. Il est vrai que la psychanalyse n’est pas à considérer comme une science à proprement parler : contrairement à la science, ses modèles ne se sont pas construits par la confrontation d’hypothèses à des dispositifs expérimentaux ; la psychanalyse est plutôt un ensemble cohérent de connaissances construites à partir d’évidences cliniques, c’est-à-dire à partir de l’observation de patients dont l’insertion inadéquate dans le tissu social entraîne des malaises psychiques mineurs ou majeurs dans un contexte qui reste cependant celui de la normalité. La connaissance recueillie par la psychanalyse est celle d’un art empirique : elle est plus proche de l’ingénierie que de la physique mathématique. Elle partage avec l’art de l’ingénieur la contrainte pragmatique que n’importe laquelle de ses applications doit « fonctionner ». La propreté, la netteté de l’explication vient toujours en second lieu, l’efficacité vient en premier.
Pour conclure cette introduction, je vais énumérer ce que je considère comme les principales différences entre le nouveau paradigme que je propose ici et un strawman [une fiction bien pratique] dont j’ai besoin à des fins de comparaison, le « paradigme dominant de l’IA » :
1) L’esprit humain est multicouches, éclectique et opportuniste dans son fonctionnement.
2) L’esprit humain comporte cinq composantes principales : une mémoire en sous-sol (correspondant à l’inconscient), une mémoire au rez-de-chaussée et un dispositif de production de la parole (correspondant au préconscient), un moniteur et une calculatrice (correspondant au conscient).
3) La mémoire en sous-sol est un lieu de stockage des traces mnésiques (TM) de deux types : acoustiques et visuelles. Les TM acoustiques sont des bruits, de la musique et des « mots » en tant que signifiants vocaux (sans signification) ; les TM visuelles sont des images d’objets, de personnes, de paysages et aussi, pour les lettrés, des images de signifiants écrits, de chiffres, de formules, etc. Les TM sont organisées en réseau : entre deux TM quelconques, il existe soit une connexion symétrique non spécifiée, soit aucune connexion. Seuls certains types de mots sont enregistrés dans la mémoire du sous-sol, ceux que les logiciens médiévaux appelaient categoremata (sujets ou prédicats dans les phrases): les substantifs, les adjectifs et les formes substantives ou adjectives des verbes. Certaines connexions sont matérielles: fondées sur une simple similitude matérielle (humilité/humidité); certaines sont lexicales: acquises avec la maîtrise de la langue (baleine/mammifère); certaines sont théoriques et de deux sortes: culturelles (Melville/Moby Dick ; terre/rond) et idiosyncrasiques (père/ivrogne ; terre/plate). Certains signifiants sont directement liés à une image (celle de leur significat [référent] pour les mots concrets, celle d’une allégorie pour certains mots abstraits); certains signifiants ne sont pas directement liés à une image.
4) La mémoire en sous-sol est unique parce que personnelle, elle est historiquement construite par accrétion progressive autour de « germes de croyance » précoces. Les germes de croyance sont en grande partie immuables, ils peuvent cependant être modifiés lors d’une conversion exceptionnelle et douloureuse; les connexions périphériques, constituant la connaissance, sont facilement modifiables par révision.
5) Les Traces mnésiques du sous-sol ont une Valeur d’Affect qui leur est attachée, positive ou négative. Une TM avec une Valeur d’Affect (VA) fortement négative est inaccessible à la remémoration. La VA d’une TM influence les Traces mnésiques voisines selon un gradient d’influence décroissante (alternativement, l’atténuation peut résulter de la présence de cycles dans le réseau). La remémoration ne peut atteindre une TM particulière qu’en fonction de la dernière valeur d’influence positive des TM sur les chemins qui y mènent. Les VA varient en fonction d’événements extérieurs relayés par le Moniteur : la contrariété ou la gratification entraînent des modifications des VA attachées aux TMs ; ainsi l’accès aux TMs varie dynamiquement dans le temps. En ce qui concerne les VA, une Mémoire en sous-sol est dans un état constant de flux ; il est probable qu’il existe à la fois des régimes de stabilité locaux et des zones d’instabilité permanente.
6) La Mémoire du rez-de-chaussée contient les autres types de mots, les syncatégorèmes du logicien médiéval : verbes, adverbes, prépositions, pronoms, etc.
7) Le dispositif de production de la parole (DPP) est un processeur d’entrée/sortie. Les entrées sont de trois types : Mémoire en sous-sol, Mémoire du rez-de-chaussée, Moniteur (ce dernier agissant soit comme un relais des demandes externes résultant de l’interaction humaine, soit pour son propre compte; le Moniteur n’est pour le DPP qu’une des agences constitutives de l’interaction humaine). Afin de répondre aux demandes de l’interaction humaine, le DPP récupère des TM qui précipitent sous forme de discours articulé (ou écrit) par l’interpolation de syncatégorèmes stockés dans la mémoire du rez-de-chaussée et qui agissent uniquement comme des modificateurs modulants entre les catégorèmes récupérés dans la mémoire en sous-sol. Les résultats sont des phrases (pas seulement des « propositions », bien sûr). Lorsque la seule agence interactive impliquée est le Moniteur, un « dialogue intérieur » s’ensuit. Comme la mémoire en sous-sol stocke non seulement des catégories de données isolées mais aussi des chaînes organisées de signifiants (chansons, proverbes, clichés, etc.), la production de la parole n’implique pas nécessairement le recours au matériel stocké dans la mémoire en rez-de-chaussée ; dans ce cas, la production de la parole équivaut simplement à une « régurgitation » de la mémoire en sous-sol, c’est-à-dire à une citation. Les discours novateurs faisant appel à la mémoire de rez-de-chaussée sont l’exception plutôt que la règle. La production de la parole est limitée par l’accessibilité des TM Les distorsions visibles dues à l’inaccessibilité massive des TM se manifestent par un discours névrotique.
8) Le sens émerge dans le Moniteur comme une conséquence de la correspondance des phrases pour la compatibilité avec les modélisations. Les modélisations sont soit préfabriquées (reflétant les connexions de la mémoire en sous-sol), soit produites sur place. En partant du cadre fourni par les syncategoremata neutres (Ryle), il établit peu à peu la signification contextuelle des categoremata, qui s’avèrent dans le contexte être soit des notions présystématiques évolutives (Stegmüller) soit des concepts théoriques à proprement parler (Sneed), c’est-à-dire les éléments indispensables de la modélisation. La signification est abstraite aussi bien du discours autoproduit que du discours produit de l’extérieur. La « modélisation sur le vif » est facilitée par une contrainte imposée par le Moniteur au DPP : la règle de compatibilité entre phrases successives (qui assure la stabilité des concepts théoriques).
9) Les heuristiques combinent des connexions TM non traitées (intuitions) et des commandes enregistrées sous forme de chaînes de signifiants.
10) La calculatrice fonctionne en appliquant des heuristiques soit à des TM récupérés, soit à du matériel obtenu à l’extérieur ; le Moniteur s’interrompt occasionnellement, affiche et vérifie.
11) Ce que la calculatrice fait, c’est du raisonnement; penser peut ou non impliquer du raisonnement, sinon, c’est l’affichage dynamique par le Moniteur de matériel récupéré dans la mémoire en sous-sol; rêver, c’est penser, mais avec le Moniteur éteint.
2. L’esprit humain à plusieurs niveaux
Je prends comme point de départ ce que Freud appelle la première topique de l’inconscient, du préconscient et du conscient, qu’il a entièrement développée dans L’interprétation des rêves (1900). Elle est plus facilement traduisible en un dispositif matériel que la deuxième topique du Ça, du Moi et du Surmoi qu’il a introduite plus tard (1920). La seconde topique était un moyen économique de se débarrasser de certaines des subtilités des processus décrits : une certaine complexité pouvait être considérée comme résultant de l’interaction entre ces trois « agences » anthropomorphes. Le Ça, le Moi et le Surmoi doivent être considérés comme des bases de métaconnaissance ayant chacune ses propres règles qui sont largement incompatibles avec celles des autres. Le Moi agit à partir du matériel qui lui est « filtré » (« linéairement » selon Freud) comme un compromis entre les contraintes imposées par le Ça et le Surmoi et qui lui restent cachées. L’origine du matériel non traité n’est plus très claire dans la deuxième topique.
La première topique est clairement stratifiée, bien que Freud ait insisté sur le fait que les agences ne sont pas des lieux dans l’esprit. Il vaut la peine de le citer à ce sujet :
« … les représentations, les contenus de pensée, les formations psychiques en général, ne doivent pas être localisés à l’intérieur des éléments organiques du système nerveux mais, pour ainsi dire, entre eux, là où peuvent se trouver les résistances et les « facilités » qui leur correspondent. Ce qui peut être un objet de perception interne est virtuel, un peu comme l’image produite par le passage des rayons lumineux dans un télescope. » (Freud 1900)
En gardant à l’esprit l’engagement connexionniste de Freud, je m’en tiendrai cependant, par souci de clarté et de simplicité, à l’idée d’une séparation spatiale des différentes agences psychiques. J’utiliserai l’image d’une maison où l’Inconscient correspondrait au sous-sol, le Préconscient, au rez-de-chaussée, et le Conscient, au premier étage.
Que trouvons-nous au niveau du sous-sol de l’inconscient ? On y trouve les éléments qui, dans les travaux ultérieurs, seront constitutifs du Ça : un certain nombre d’ »instincts » ou de « pulsions », parmi lesquels la pulsion sexuelle dominante ; ils expriment des tensions survenant dans le corps et supposées relayées par le Ça. La libido est l’énergie dissipée lorsque ces tensions sont relâxées. On y trouve aussi les sentiments profonds d’insuffisance qui nous projettent vers d’autres êtres humains dans l’espoir de les apaiser, ainsi que d’autres types de distorsions d’inhibition comme le complexe d’Œdipe. Je laisse tout cela de côté pour l’instant car je pense qu’il sera possible d’en rendre compte en tant que contraintes agissant sur l’organisation des traces mnésiques ; ce faisant, je tiens compte non seulement des indications de Freud mais aussi de l’apport théorique de Jacques Lacan.
3. Mémoire en sous-sol
Le deuxième composant que l’on peut trouver au niveau du sous-sol de l’inconscient est bien sûr la mémoire. Freud a beaucoup travaillé sur ce sujet. Trois de ses livres majeurs peuvent être considérés comme essentiellement consacrés à la mémoire : L’interprétation des rêves (1900), La psychopathologie de la vie quotidienne (1901) et Les plaisanteries et leur relation avec l’inconscient (1905). De ces ouvrages émerge une théorie de la mémoire parfaitement développée, que Freud ne semble cependant pas avoir pris lui-même tout à fait au sérieux, manifestement parce qu’il était incapable d’attribuer un statut précis à ces « mots » (en fait, des signifiants sans signification) qu’il voyait traîner partout dans la structure de la mémoire qu’il démêlait.
La façon dont Freud a obtenu la structure et le contenu de cette mémoire en sous-sol est bien connue : premièrement, par le biais des « associations libres » de ses patients, une méthode moins artificiellement contrainte que les « associations induites » alors très en vogue parmi les psychologues expérimentaux (et chez Jung) ; deuxièmement, par l’interprétation des rêves. D’après les données freudiennes, le contenu d’une mémoire en sous-sol est de deux types : visuel et acoustique. D’une part, il y a des images hallucinées (c’est le terme utilisé par Freud) d’objets tels que des personnes, des objets, des paysages, mais aussi des images de symboles, tels que des mots écrits, des formules chimiques, des figures, etc. D’autre part, il existe des « images vocales » de mots hallucinés ou de chaînes de mots telles que des chansons, des proverbes, etc. Mais pour les mots isolés, pas pour tous les types de mots : on n’en trouve la preuve que pour les substantifs, les adjectifs et les verbes utilisés sous une forme substantivée ou adjectivée (« mort », « savoir »); ce sont précisément les types de mots que les logiciens médiévaux appelaient categoremata : des mots qui apparaissent dans les phrases soit comme sujets, soit comme prédicats. Nous verrons plus loin que les philosophes scolastiques avaient l’intuition de la nature bi-couche de la mémoire. La façon dont ces traces mnésiques sont organisées est très simple : certaines sont connectées à d’autres, et c’est tout. En effet, ces connexions ne sont rien d’autre que précisément cela : une connexion. Il n’y a aucune spécification de la nature de la relation existant entre deux traces mnésiques connectées. En d’autres termes, si la mémoire de base est modélisée comme un graphe dont les nœuds sont des traces mnésiques, les arcs de ce graphe ne sont pas étiquetés.
Les connexions entre les signifiants et les images dans la Mémoire du sous-sol peuvent être classées en trois catégories : 1) entre le signifiant d’un mot concret et l’image de son référent, 2) entre le signifiant d’un mot abstrait et une allégorie de l’idée qu’il représente, 3) entre un signifiant et une image qui a simplement été enregistrée simultanément (un paysage et une chanson, par exemple). Les connexions entre les signifiants peuvent également être classées en trois catégories : 1) matérielles, soit la ressemblance acoustique : homophonie (Bosnia – Botticelli), soit la ressemblance visuelle: homographie (Boltraffio – Trafoi) – celles-ci ne sont bien sûr pas toujours faciles à distinguer; 2) lexicales, elles reflètent la maîtrise d’une langue naturelle et correspondent au savoir analytique de Kant : ils comprennent, les inclusions taxonomiques (arbre – hêtre), les attributions de propriétés (pissenlit – jaune), les traductions d’une langue à l’autre (timbre – stamp); 3) théoriques, ils reflètent une représentation particulière du monde, soit culturellement partagée, soit personnelle, ils correspondent à la connaissance synthétique a posteriori de Kant (culturelle : quotidien – pain, Moby Dick – Melville, terre – ronde ; idiosyncratique: piano – horrible, père – ivre, terre – plate).
La mémoire en sous-sol d’une personne se construit tout au long de sa vie. Elle est vide à la naissance et les premières images et signifiants enregistrés agissent comme des « germes de croyance » qui sont peu à peu « enrobés » par d’autres connexions à de nouvelles traces mnésiques. Une mémoire en sous-sol a donc une histoire : elle a un centre qui est primitif et une périphérie qui est récente. Les connexions entre les traces mnésiques centrales sont difficilement modifiables, les périphériques sont facilement modifiables. Les centrales correspondent à ce qu’une personne appelle ses croyances profondes, les périphériques à ce qu’elle appelle ses connaissances ; ces dernières peuvent être actualisées, améliorées, modifiées en fonction des nouvelles informations obtenues. Les connexions centrales peuvent exceptionnellement être modifiées, mais seulement à prix d’un processus dramatique et douloureux : ce qu’on appelle une conversion (le but de la psychanalyse est que, sous la supervision d’un professionnel, une telle conversion [au cours d’une anamnèse] soit induite chez l’analysant).
Il n’existe donc pas deux mémoires humaines en sous-sol parfaitement similaires. La culture dans laquelle une personne est intégrée offre cependant – en ce qui concerne les signifiants – un choix restreint de traces mnésiques potentielles et de modélisations de la manière dont celles-ci sont légitimement reliées. Certaines TMs potentielles sont liées à la maîtrise d’une langue naturelle particulière, ce que j’ai appelé ci-dessus la connaissance lexicale; d’autres sont obtenues personnellement et « théorisées »; d’autres encore sont disponibles en tant que part du patrimoine intellectuel d’une communauté culturelle, ce que j’ai appelé par conséquent la composante culturelle de la connaissance théorique car elle reflète une représentation spécifique du monde qui a été construite de manière cumulative à travers un processus réflexif. Il existe donc des éléments communs aux membres d’une même communauté culturelle : ceux qui correspondent à la maîtrise d’une langue naturelle et ceux qui correspondent à une représentation du monde partagée. Les personnes diffèrent cependant dans la quantité d’éléments culturels qu’elles enregistrent comme traces mnésiques, cela dépend du degré d’éducation, de culture d’une personne.
Si nous modélisons notre mémoire de base comme un graphe, ses nœuds sont cependant étiquetés : à chaque trace de mémoire est attachée une valeur d’affect, négative ou positive [2022 : Je modifierai cette représentation lorsque j’implémenterai ce modèle à partir de l’année suivante dans le logiciel ANELLA ; j’adopterai alors la représentation duale où un signifiant, démultiplié selon ses divers usages, est représenté dans le graphe par un arc auquel une valeur d’affect (à tout moment révisable) est attachée]. Ces valeurs jouent un rôle dans la remémoration, facilitant la récupération lorsqu’elles sont positives, l’entravant lorsqu’elles sont négatives. Les valeurs fortement négatives agissent comme des creux dans le « paysage de la mémoire », contribuant à neutraliser l’accès à ces valeurs et à leur voisinage (qui devrait être conçu comme un voisinage topologique) ; une trace mnésique avec une valeur d’affect fortement négative est effectivement « taboue » en ce qui concerne sa récupération. Si une métrique est imposée sur le réseau de mémoire où chaque arc se voit assignée une valeur propre, alors, selon la valeur d’affect négatif de l’image ou du signifiant tabou, le réseau sera neutralisé à la récupération dans son entourage, jusqu’à une distance n, dépendant de la valeur négative précise de l’affect attaché à la trace mnésique taboue. Il est intéressant de noter que Freud utilise l’image d’un paysage inondé pour rendre compte d’une telle neutralisation :
« C’est comme lorsqu’une inondation a rendu impraticables les bonnes routes de montagne : on peut encore voyager, mais seulement par ces chemins escarpés et difficiles que les chasseurs seulement utiliseraient dans des circonstances normales » (Freud 1900).
Au contraire, des valeurs légèrement négatives signifient que l’image ou le signifiant auxquels elles sont attachées agissent comme des dépressions dans le paysage mnésique ; c’est ce que nous appelons des inquiétudes : toute pensée est « capturée » tout au long d’un « chemin d’association » par l’attracteur constitué par la trace mnésique négative. Les inquiétudes se trouvant dans l’arborescence de la mémoire en sous-sol s’imposent chaque fois que le Dispositif de Production de la Parole entre en action.
Les psychanalystes ont produit une variété de termes pour désigner la neutralisation de la mémoire en sous-sol : refoulement primitif, refoulement, suppression, forclusion. Je considère le refoulement primal et la refoulement comme la neutralisation proprement dite dont il est question ici ; le refoulement primal correspond à la neutralisation des traces mnésiques précoces constituant le plus souvent des « germes de croyance » ; le refoulement correspond à la neutralisation des traces mnésiques ultérieures. La suppression, je me la représente comme un équivalent du refoulement mais agissant au niveau de la mémoire du rez-de-chaussée ; elle résulte d’un effet de rétroaction du Moniteur sur le Dispositif de Production de la Parole.
La forclusion telle que Lacan l’entend – à laquelle il attribue un rôle causal dans la psychose – correspond à un type particulier de refoulement primitif : celui de ce que Lacan appelle un Signifiant-Maître. Ce qui fait d’un signifiant, un « Signifiant-Maître », c’est son emplacement spécifique dans le réseau de la mémoire en sous-sol en tant que « nœud-passage ». Un nœud-passage est aux nœuds ce qu’un « pont » est aux arcs : un nœud tel que sa suppression déconnecterait le graphe en sous-graphes autonomes. La neutralisation à la remémoration d’un Signifiant-Maître implique que le réseau de la mémoire en sous-sol se désagrège en un certain nombre de « sous-mémoires » distinctes. Le discours psychotique présente une telle déconnexion: l’accès aux traces mnésiques n’est possible à tout moment qu’au sein d’une seule sous-mémoire, ce qui confère au discours son type particulier d’incohérence. Dans la paranoïa, tout se passe comme si la mémoire de base essayait de compenser sa déconnexion par une prolifération de connexions à l’intérieur de chacune des sous-mémoires distinctes : les « intrigues » omniprésentes qui caractérisent le discours paranoïaque résultent de la surconnexion injustifiée opérée par le malade.
Dans La psychopathologie de la vie quotidienne, Freud a montré comment, lorsqu’une trace mnésique ayant une valeur d’affect fortement négative a neutralisé la mémoire en sous-sol dans son voisinage, la remémoration parvient cependant à se rapprocher le plus possible du signifiant tabou : pour s’en tenir au modèle du paysage, la remémoration est capable d’atteindre la rive de la plaine inondée. Ainsi, dans un cas célèbre, « Signorelli » étant inaccessible en raison d’un tabou sur « Herr » (= « Signor »), la remémoration parvient cependant à accéder au « Botticelli » insatisfaisant mais apparenté. Dans un autre exemple, la remémoration hallucine le visage d’un homme qui ressemble à un aigle (= « aquila ») au lieu du signifiant recherché « aliquis ».
Quant au mécanisme même de la neutralisation, on peut supposer que la valeur d’affect d’une trace mnésique particulière se diffuse aux traces mnésiques voisines selon un gradient d’influence décroissante avec la distance. Mais l’existence d’un tel gradient pourrait être une hypothèse inutile : il se pourrait bien que la valeur d’affect d’une trace mnésique reste constante lorsqu’elle se diffuse, mais qu’elle diminue « mécaniquement » en raison de la présence de cycles dans le réseau.
L’approche en termes de « théorie des graphes » que je développe ici pour la psychanalyse est bien sûr étrangère aux travaux de Freud, mais il est intéressant de constater combien les pères fondateurs de la psychanalyse ont développé des intuitions d’une telle nature topologique : J’ai évoqué plus haut l’image d’une plaine inondée chez Freud. Il en va de même pour la notion de « complexe » qui fut précisément utilisée pour la première fois par Jung pour désigner une configuration neutralisée de la mémoire du sous-sol. Dans un article publié en 1913, « Sur la doctrine des complexes », Jung justifie son introduction du concept de la manière suivante :
« Ordinairement, il n’y a que quelques préoccupations personnelles auxquelles se rapportent les interférences de l’expérience (d’association induite). Riklin et moi-même avons introduit pour cette « préoccupation personnelle » le terme complexe, parce qu’une telle « préoccupation personnelle » est toujours une collection d’idées diverses, maintenues ensemble par un ton émotionnel commun à tous. Avec de la pratique et de l’expérience, on peut facilement acquérir la faculté de recueillir les mots-stimuli qui seront le plus susceptibles d’être accompagnés d’interférences, puis de combiner leurs significations et d’en déduire les préoccupations intimes du sujet » (Jung 1973 : 599).
Ce que Jung a appelé un « complexe » est donc précisément une zone neutralisée à la remémoration (« une collection d’idées diverses ») au voisinage d’un signifiant (« préoccupation personnelle ») auquel est attachée une valeur d’affect fortement négative (« un ton émotionnel commun »). Lorsque Freud a emprunté ce terme, il l’a justifié dans les termes suivants :
» Suivons l’exemple de l’école de Zurich (Bleuler, Jung, etc.) et appelons complexe tout groupe d’éléments représentatifs liés entre eux et chargés d’affect » (Freud 1908).
Ainsi compris, il devient plus clair comment un « complexe » contribue à façonner ce qui apparaît à ceux qui nous connaissent comme notre « personnalité » :
« Ce que nous appelons notre personnalité repose sur les traces mnésiques de nos impressions ; et ce sont précisément les impressions qui nous ont le plus frappés, celles de la petite enfance, qui ne deviennent presque jamais conscientes » (Freud 1900).
Le refoulement primaire, dit Freud, caractérise ce que j’ai choisi d’appeler les « germes de croyance » ; d’où leur qualité d’immuables, fermés à l’infirmation, des « croyances profondes ».
[…]
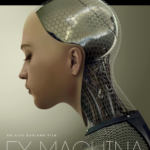
Laisser un commentaire