Mon entretien avec Nicolas Roberti sur Unidivers.
Paul Jorion est chercheur en sciences sociales. Il occupe depuis 2012 la chaire Stewardship of Finance (la finance au service de la communauté) à la Vrije Universiteit de Bruxelles. Ses travaux ont gagné en popularité grâce à son ouvrage intitulé Vers la crise du capitalisme américain qui prévoyait la crise des subprimes de 2007 et le risque de récession mondiale inhérent. Il est l’invité des Champs libres à Rennes le samedi 1er décembre à 15h30. Entretien avec le créateur d’un blog de réflexion dont le slogan est… « Big Brother mangera son chapeau ! »
Unidivers Mag – Élève de l’anthropologue Claude Lévi-Strauss et du mathématicien Georges-Théodule Guilbaud, vous avez été conduit à appliquer des modèles logico-mathématiques à l’anthropologie puis aux sciences cognitives et à l’économie. Il peut sembler dès lors bon de commencer cet entretien en évoquant les travaux issus du groupe que vous avez fondé en 1994, Théorie et clinique des pathologies de la pensée. Après vingt ans de recherche, quelle conception vous faites-vous de la conscience, de son intentionnalité et des possibilités de construire du sens réfléchi ou pré-réfléchi par l’individu dans son rapport à lui-même comme à la communauté ? Pour aller directement au cœur du propos, existe-t-il un libre-arbitre ?
Paul Jorion – Je ne pense pas. À mon sens, la conscience est un office d’entérinement des actions et des pensées que l’individu se constate en train de produire. Il existe une dynamique d’affects qui nous font réagir aux situations au sein desquelles nous nous trouvons, situations qui sont constituées aussi bien des paroles que nous nous entendons prononcer que des interactions qui sont les nôtres avec le reste du monde.
Dans ce cadre, cette fenêtre de la conscience a pour seule finalité la survie. Elle permet d’enregistrer en mémoire les réactions les plus adaptées à des situations potentiellement gratifiantes ou dangereuses. Cette aventure commence avec la naissance et se conclut par la mort. La séquence nous apparaît comme une saga dramatique, relativement passionnante, mais n’est que le fruit d’une reconstruction volontariste leurrée dans son rapport à la réalité. Nous ne sommes pas passifs au sens où nous éprouvons véritablement ces situations, mais notre degré de liberté, étant ce que nous sommes, est nul : il n’y a aucune possibilité de jouer la pièce autrement.
Nicolas Roberti – Votre conception du réel me semble faire écho au perspectivisme de Nietzsche.
Paul Jorion – Oui, dans la mesure où pour lui le sujet est « agi » bien davantage qu’il « n’agit ». Il ne le dit pas le plus souvent sous une forme aussi explicite. Il a ce regard qu’on appelle par tradition « désespéré » mais qui ne l’est pas véritablement, qui est simplement « désenchanté » sur la réalité humaine parce que Nietzsche appartient à la famille des sceptiques.
Nicolas Roberti – Si ce n’est que dans la vision de Nietzsche, une fois le constat arrêté, avec toute sa charge de désenchantement, il s’agit pour l’homme de se fixer un but immanent qui se traduit par son propre dépassement. L’état des lieux de la situation de la conscience que vous formulez autorise-t-il un basculement susceptible de reconstruire une histoire, individuelle ou communautaire, marquée du sceau du sens, de l’espérance et de la réalisation ? Ou bien, la conscience étant intrinsèquement leurre, tout regard projectif sur le monde ne peut être que déceptif ?
Paul Jorion – Non, parce que la présence de l’affect ouvre la voie à une perspective esthétique : ce spectacle de la vie ne nous est offert qu’une seule fois, notre souci intérieur est qu’il soit le plus beau possible. À défaut d’y trouver du sens, qui manque nécessairement, nous pouvons y trouver de la beauté.
Nicolas Roberti – Votre conception de la conscience comme leurre postule que l’intention est un artefact qui n’apparaît à la conscience qu’après avoir posé l’acte dont elle est censée être à l’origine. Sans infirmer votre lecture, ne pourrait-on pas penser que la manifestation a posteriori traduit un ensemble de choix ou, tout au moins, de préchoix, opérés en amont dans une dimension de la vie psychique qui présiderait aux préorientations de l’individu dans son rapport au monde ? Ces préchoix, originés dans un système mémoriel mouvant, permettraient alors, à défaut d’une intention autonome, des possibilités hétéronomiques qui se manifesteraient après coup à la conscience en un contenu de sens doté d’une certitude latitude de variation.
Paul Jorion – Je comprends votre point de vue, mais ne le partage pas. S’il n’y a pas de place pour un projet individuel, il y a cependant place pour un projet de l’espèce, dans cette tâche générale de la production et de la perpétuation de la vie. Il y a deux dimensions : la survie individuelle et la reproduction de l’espèce. La combinaison des deux génère ce que les physiciens appellent « un gradient » : une voie toute tracée qui sera celle de notre comportement et que dessine la ligne de moindre résistance dans ce double système de contraintes. Cette formulation prolonge du reste celle de Freud : nous avons deux « soucis », mais qui ne sont pas de l’ordre de la « cause efficiente », ce qui voudrait dire avec notre conscience dans un rôle directeur, mais au sens de la « cause finale » : nous sommes entraînés dans un processus où nous sommes motivés à survivre en tant qu’individus et, de manière incidente mais liée, à assurer la continuité de l’espèce. Tout cela parce que la vie, le processus biologique, a échoué dans le cas de notre espèce à réaliser ce qui aurait pu être l’une de ses formes, celle qui aurait rencontré les aspirations de l’individu, à savoir que l’immortalité lui soit garantie.
Nicolas Roberti – Ceci, l’individu le sait instinctivement, ce qui renforce sa participation à la main secrète de la nature qui pousse l’espèce à se prolonger dans l’histoire. Dans cette tension où aucun levier de transformation ne semble constituable, une éthique est-elle possible et laquelle ? Une conscientisation spinoziste, une méditation continue sur le non-agir ?…
Paul Jorion – Le donné de l’humain est d’appartenir à une espèce sociale, il y a dans notre cas, existence d’un zoon politikon (« L’homme est par nature un animal politique ») qui a réussi, par le moyen de la technologie, à prolonger la survie de l’individu. Par l’invention de la médecine, et d’autres techniques qui nous ont permis d’améliorer notre confort, nous avons trouvé le moyen de prolonger la vie individuelle au-delà de son donné naturel pur et simple. Cela est possible par la création de la culture qui n’est rien d’autre que l’extension du processus biologique dans le cas d’une espèce comme la nôtre.
Dans ce cadre du zoon politikon comme donné, l’éthique est le moyen, sans aucune transcendance, de nous constituer des environnements qui maximisent la durée possible de notre vie individuelle.

Nicolas Roberti – Votre « sagesse » prescrit donc, notamment au regard de la mort, une acceptation de la finitude humaine au profit d’une amélioration des environnements sociaux et vitaux…
Paul Jorion – Si ce n’est que rien n’exclut à l’avenir une perspective hégélienne du devenir : le processus biologique que nous observons n’est pas nécessairement la forme de ses voies de transformation. Le physique a engendré le chimique qui a, à son tour, engendré le biologique. Le processus biologique n’était pas déductible a priori du processus chimique, de la même manière que le processus chimique n’était pas déductible a priori du processus physique. Nous ignorons s’il n’y aura pas une étape ultérieure, qui succédera au processus biologique. Des cultures, la nôtre en particulier, ont imaginé des personnages démiurgiques comme étant la cause première de notre présence sur terre. Rien n’atteste leur présence mais rien n’interdit non plus de penser que le biologique engendrera un jour à son tour un processus qui se rapprocherait alors de ce que nous avions imaginé comme le divin.
Nicolas Roberti – Suggérez-vous qu’une fois écartée l’acception de Dieu comme cause efficiente, Dieu pourrait se révéler une forme de projection, comme une « post-construction » qui constituerait un nouveau stade de l’humanité ?
Paul Jorion – C’est cela. De la même manière qu’à l’époque où n’existaient encore sur le globe terrestre que des acides aminés, il n’aurait pas été raisonnable de prédire l’apparition d’une espèce telle que l’espèce humaine, capable de prolonger par sa culture les processus naturels bien au-delà de ce que suggère la simple physique. De la même manière, on ne peut pas exclure que ce processus biologique produise lui aussi ultérieurement, par émergence, comme on peut constater celle-ci à différents niveaux, un autre type de phénomènes. Et que ce que nous avons imaginé à tort comme s’étant produit avant nous : un Dieu démiurge, n’apparaisse en fait ultérieurement. Autrement dit, que Dieu se révèle non pas comme la cause première qu’on avait imaginé pour se rassurer, mais comme cause finale.
Nicolas Roberti – Vous convergez alors avec les conceptions transhumaines…
Paul Jorion – Vous faites allusion à la reformulation par Teilhard de Chardin de cette conception hégélienne ?
Nicolas Roberti – Pourquoi pas, mais, au-delà, au mouvement futurologique.
Paul Jorion – Cela ne m’est pas familier. Pouvez-vous m’éclairer ?
Nicolas Roberti – En quelques mots, le transhumanisme prône l’usage des techniques afin d’améliorer les caractéristiques physiques et mentales des êtres humains. Même s’il comprend de nombreuses sensibilités, son principal objectif poursuit la production d’une posthumanité où les êtres humains seraient dotés de pouvoirs nouveaux, voire accéderaient à l’immortalité.
Paul Jorion – Cela paraît très intéressant, je ne manquerai pas de me renseigner.
Nicolas Roberti – Une fois le cadre anthropologique et téléologique posé, nous pouvons converger vers la déclinaison du champ économique. Il y a chez vous une critique de la formulation même de ce qu’est la science économique. Dans Misère de la pensée économique notamment, vous vous élevez contre l’influence conformiste, notamment anglo-saxonne, dans l’élaboration d’une science économique, autrement dit d’un ensemble de moyens d’analyse, prospective ou non, de phénomènes économiques. Comment vos travaux s’emploient-ils à subvertir ce conformisme institutionnalisé et à participer au renouvellement d’une science économique plus adaptée au réel et à l’idée que vous vous en faites ?
Paul Jorion – A mon sens, une science économique a bel et bien existé, il s’agit de l’économie politique. Hélas, elle a été délibérément torpillée à l’instigation des milieux financiers qui n’ont pu tolérer son existence et ont encouragé à sa place la formulation d’un autre type de discours. Cette réaction ne date pas de la Critique de l’économie politique par Marx, mais prend place dès la formulation par David Ricardo d’une théorie de la valeur fondée sur le travail uniquement, impliquant que toute redistribution de la valeur créée qui n’est pas justifiée par un travail produit, suppose une spoliation. Cette proposition est de nature scientifique – quand bien même sa forme m’apparaît insuffisante, car il convient de prendre en compte tous les éléments que Proudhon appelait « d’aubaine » qui font qu’ une catalyse mutuelle s’observe entre l’ensemble des éléments qu’il faut rassembler pour manufacturer une marchandise.
Quoi qu’il en soit, il y avait là chez Ricardo, reprise ensuite par Marx, une hypothèse scientifique dont il convenait de déterminer la validité. À la place, a été produit un discours conçu au simple usage des financiers dans leur dialogue avec les politiques. Ce discours a ainsi pour fonction de masquer la réalité qui serait décrite dans une argumentation de type scientifique.
Dévoyé en discours dogmatique, il est fondé sur des postulats impossibles à tester qui oblitèrent les questions capitales, notamment la redistribution de la richesse créée, les formes de la propriété privée, les rapports de force existant au sein de l’économie, etc. C’est donc bien logiquement que ce discours de substitution n’a pas su anticiper une crise de l’ampleur de celle des subprimes qui a démarré en 2007. Pire, une fois celle-ci éclatée, les outils manquant pour la décrire, aucune directive micro- ou macro-économique n’a pu être formulée pour y remédier.
Nicolas Roberti – Je vous sens d’une fibre plus anarchiste que marxiste. Vous sentez-vous plus proche des marxistes hétérodoxes ou des socialistes utopiques ?
Paul Jorion – Des seconds assurément, notamment Sismondi, Proudhon, Owen en Grande-Bretagne, Thoreau aux États-Unis. S’il fallait absolument choisir entre ces deux termes, ma fibre serait davantage socialiste ou anarchiste dans la mesure où ma réflexion est non-dogmatique alors que le marxisme a sombré bien vite dans le dogmatisme, avec la personne de Marx lui-même d’ailleurs.
Nicolas Roberti – Le monde libéral a, selon vous, produit un discours marchand qui favorise les intérêts du capital au détriment d’une science à vocation universelle de compréhension objective de phénomènes. Alors, que faire pour restaurer la possibilité d’une science économique un tant soit peu objective et réaliste ?
Paul Jorion – Il faut reconstruire une économie politique : il faut produire maintenant les instruments d’analyse qui font encore défaut. Le point de départ consiste à se resituer dans les années 1870 où l’économie politique a été jugulée et poursuivre la réflexion telle qu’elle avait été produite jusque-là afin, car des fondations solides avaient été établies. Produire de nouveaux outils, c’est ce que j’ai essayé de faire, par exemple en proposant un modèle du mécanisme de la formation des prix. La voie à emprunter est celle d’une anthropologie économique qui s’attache à concevoir une économie non coupée ni du politique ni du social, mais sertie à l’intérieur de l’ensemble commun. C’était le projet de Karl Polanyi, l’un des fondateurs avec Marcel Mauss de l’anthropologie économique.
Et, cette tâche n’est pas nécessairement complexe. La complication de la « science » économique dominante n’est pas le reflet de la complexité intrinsèque des questions économiques : la complication des explications participe de la dimension idéologique du discours économique au service d’un obscurcissement volontaire de la réalité. Une véritable science économique doit par exemple être bien davantage qualitative que quantitative.
En parallèle de mes efforts, un certain nombre de physiciens analysent depuis quelques années les questions d’économie en extériorité [non-alignés sur le discours ambiant] et opèrent des progrès constants. Des laboratoires d’intelligence artificielle réalisent ainsi des simulations à partir d’hypothèses variées fondées sur une lecture objective des fonctionnements économiques.
Nicolas Roberti – Permettez-moi d’être un soupçon provocateur. La redéfinition d’un vocabulaire et d’une grammaire simplifiées susceptibles de désigner une pratique du réel qui engloberait l’économie, le politique et le social ne risque-t-elle pas d’endiguer le pluralisme de l’interprétation, la diversité des points de vue, la multiplicité des voies réelles ou prospectives qui président à la création de la valeur (originale) dans le logiciel libéral ? Autrement dit, une description du réel par cette économie politique que vous appeler de vos voeux ne risque-t-elle pas de devenir à son tour doctrinale et attenter aux aspirations de liberté créatrice qui est aussi un fondement du libéralisme ?
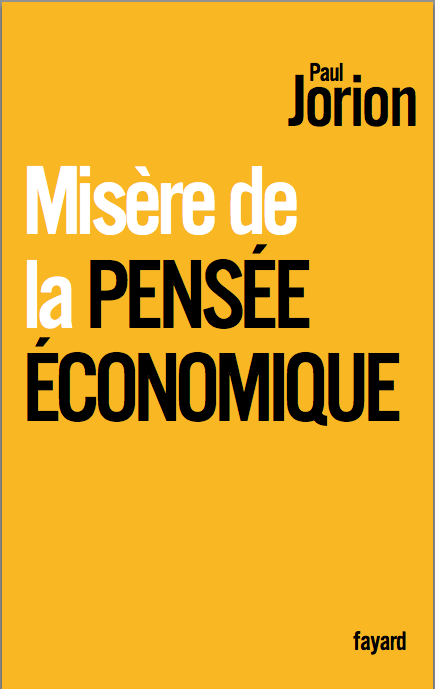
Paul Jorion – J’entends votre question. Mais la réalité, c’est que nous sommes dans une situation économique et financière qui est à ce point désespérée que c’est la survie même de l’espèce qui est désormais en cause : l’émergence que nous avons évoquée précédemment d’un après-le-biologique est peut-être d’ores et déjà exclue, car nous nous sommes enferrés dans des voies de garage quant à la relation entre notre espèce et la planète qui l’accueille, et nous persistons à chercher des solutions à l’intérieur d’un cadre devenu parfaitement inapproprié. Aussi il est un luxe qu’on ne peut plus se permettre dans l’urgence présente : se poser trop de questions sur les implications possibles des approches véritablement neuves.
Certes, il y a des dangers parce que nous savons qu’en situation de crise fleurissent les tentations, notamment l’embrigadement qu’on observe dans le fascisme, qui travaillent à orienter le destin humain vers celui d’autres espèces animales sociales au comportement proprement « machinique », comme la ruche ou la fourmilière, où le sacrifice total de l’individu est le prix à payer. Orwell a décrit cela dans 1984 ou Huxley dans le Meilleur des mondes, quand les impératifs de la machine sociale éliminent toute possibilité pour l’individu d’exister encore en tant que tel. Nous avons eu la malchance d’en voir un échantillonnage au cours du XXe siècle.
Cela étant dit, les conséquences ultimes du libéralisme promettent de conduire également à cet écueil quand bien même son intention était tout autre. Le fait que Hayek ou Friedman en soient venus à soutenir la dictature militaire de Pinochet nous rappelle à quel point l’enfer peut être pavé de bonnes intentions… Ces deux parangons du libéralisme qui prétendaient nous protéger de tout élément de totalitarisme qui pourrait être implicite à une rationalisation plus poussée de nos comportements, ont finalement versé dans ce qu’ils dénonçaient.
Nicolas Roberti – De l’autre côté, notre grand Foucault national a applaudi en 1978 à l’avènement de Khomeyni et de sa « spiritualité politique »…
Paul Jorion – Oui, mais Foucault était au final du même bois qu’Hayek et c’est cela qui l’a conduit à se fourvoyer de la même manière exactement. C’est au nom du libéralisme qu’il s’est retrouvé dans le même type d’impasse, à cautionner ce type de régime.
Dans la revendication absolue de la liberté individuelle pour tous qu’on trouve à l’origine au XIXe chez Stirner et ses épigones, on constate un entérinement de l’ordre social donné. C’est la conséquence logique de ce principe de liberté absolue : cautionnant les rapports de force existants, il confirme in fine la domination exercée par l’aristocratie fondée sur l’argent.
Nicolas Roberti – Comment dès lors distribuer équitablement les richesses créées ?
Paul Jorion – Il y a deux voies possibles. Soit un système qui conjugue dans chaque individu les trois grandes fonctions de la division sociale du travail, à l’image de celui imaginé par la participation gaullienne, où chacun se retrouve à la fois capitaliste, patron et salarié, c’est-à-dire le principe à la base de la coopérative, prôné par socialistes et anarchistes. Le problème de l’antagonisme entre ces fonctions cesse alors de se poser pour avoir été « dilué ». Soit un processus de type marxiste, passant par une prise de conscience des conséquences inévitables de la division sociale du travail, et débouchant sur la nécessité d’abolir l’impact politique des classes qui découlent de cette division. Autrement dit, il convient de briser la machine à concentrer la richesse que nous avons tolérée dans chacune des formes de nos sociétés – que son moteur soit la rente dans le cas des sociétés fondées sur la propriété terrienne ou sur l’intérêt pour celles fondées sur l’argent. Sans cela, il n’est pas de sortie possible de ces systèmes économiques qui se grippent périodiquement.
Nicolas Roberti – Si Marx a vaticiné l’accélération fatale des crises du capitalisme, une essentielle plasticité du capitalisme conjuguée au libéralisme politique retarde depuis des années cette sombre perspective…
Paul Jorion – C’est vrai, mais cela est dû au fait que Marx a voulu abstraire (par distraction ou négligence ?) du cadre historique de la lutte des classes, ces paramètres capitaux que sont la formation des prix et la détermination du niveau des salaires. Il s’est ainsi privé du moyen de prévoir quels seraient les facteurs qui détermineraient véritablement la fin du système capitaliste.
Nicolas Roberti – Certains préconisent la prohibition de l’héritage. Qu’en pensez-vous ?
Paul Jorion – C’est effectivement l’un des moyens. Tout ce qui ossifie les configurations d’avantages acquis favorise bien entendu la concentration du patrimoine. L’interdiction de l’héritage est en effet l’un des premiers moyens prônés par les socialistes utopiques pour prévenir celle-ci. Reste qu’il est impossible d’y avoir recours hors d’une réflexion générale sur la propriété privée.
269 responses to “UNIDIVERS.fr, Paul Jorion : Mettre fin à l’aristocratie de l’argent !”
diffraction… « résonance » / « le spirituel » a de gros soucis de perfection d’égo
Entretien de haute volée,il est recommandé d’attacher sa ceinture.
+1
La pensée jorioniste a franchi depuis quelque temps un saut qualitatif. Les pièces éparpillées du puzzle sont en train de s’assembler et l’on voit clairement émerger un « système » philosophique.
Le jour où la philosophie sera un système , j’éviterai d’être philosophe .
? Une philosophie philosophique?
(et écho à la politique politicienne ?)
Je pense qu’il n’y a de philosophie(s) que plurielle(s) .
Et parmi elles, je choisis avec Diderot plutôt la philosophie expérimentale que la philosophie rationnelle , même si , parfois , par nécessité temporelle de l’histoire , une forme de philosophie apparait comme » la meilleure » pour accompagner ce moment nécessaire là .
@ Piotr
Oui. Entretien intéressant !
Sans doute, encore plus, prenant l’image d’un iceberg, par ce qui ne nous ait pas montré ou dit, que par ce qui nous est dit ou montré dans cet échange. D’où cette sensation peut-être d’apesanteur ou de « prises à forte altitude ». Piotr, auriez-vous peur en avion ?… Nous qui pensions que Mr Jorion était bon pilote… Va-t-il nous faire des cabrioles en l’air ?…
[…] Blog de Paul Jorion » UNIDIVERS.fr, Paul Jorion : Mettre fin à l’aristocratie de l’argent !. […]
Superbe et courageux .Merci et bravo .
Etre ou ne pas etre ;la est la question .
En effet, Piotr.
Paul, je vous lève le chapeau que je ne porte pas, avant que Big Brother ne me le mange !
Je partage globalement votre vision dite désenchantée des choses, sans savoir le dire avec autant de références ni de hauteur de vues. C’est elle qui m’a sauvé d’un catholicisme borné et castrateur reçu dans l’enfance.
Il y a quelque chose d’à la fois paradoxal et inévitable dans le sentiment de liberté que me donne cette conception.
J’ajoute cependant que je n’arrive pas à réellement comprendre la vulgarité et la brutalité, ni celles des incultes, ni celles des instruits ou très instruits, ni celle des gouvernants de nos démocraties.
Pour ce qui est de la possibilité d’un choix esthétique, je ne me suis jamais formulé la chose, et je vous fait assez crédit pour commencer à y réfléchir. 😉
PS: j’adore ceci, entre autres choses à la fois précises et franches :
[élaborer des instruments d’analyse]
un seul mot: « désanchanté ».
Pourquoi ce « désenchanté » ? Le présent est, oui, calamiteux et insupportable; tant de souffrance et d’injustice imposées aux innocents au profit des 1%.
Paul nous dit logiquement : « Tout, ou presque, est à refaire. La bonne nouvelle est que nous en avons la liberté. »
Ce texte, surtout la conclusion est donc un hymne à la volonté et à la liberté.
« Nous nous le devons à nous-même et à notre survie comme espèce » et « Nous le pouvons ».
Les déclarations de Paul porte quelque chose comme une clarté aveuglante qui vous fait dire : » C’est exactement ce que je ressens. ».
Paul est le porte parole de l’Espoir, rigoureux et vigoureux, pour nous tous.
On notera cependant avec une certaine tristesse la pauvreté de l’intervenant s’agissant des choses pratiques, têtues comme il est bien connu: mettre fin a l’héritage !
Tant de science étalée et tant d’empathie pour une proposition si faible…
Rien retenu de la fin de « Misère de la pensée économique » ?
@ Daniel 30 novembre 2012 à 17:28
Seriez-vous partisan de mettre fin à l’héritage ? Même si vous le souhaitiez, votre vœu ne pourrait jamais se réaliser. En effet la vie se transmet par héritage génétique d’abord. L’ADN ne tombe pas du ciel mais résulte d’une réelle transmission matérielle et morale que trop d’inconscients voudraient faire oublier. Ah ! Si l’on pouvait, sous prétexte de folie égalitaire, supprimer cette filiation, qui exige l’existence d’un père et d’une mère pour conserver un sens !
Bien sûr, on pourrait imiter les abeilles, mais franchement, cette vie uniforme et réglée une fois pour toutes doit être bien morne. C’est peut-être ce que souhaitent les égalitaristes inconditionnels.
http://tecfa.unige.ch/tecfa/teaching/UVLibre/0001/bin35/abeilles/societe/societe.html
J’me marre, à fond la caisse, mon cher JduCac de vous voir encore vous planter dans des analogies approximatives.
A vous lire: si on admet l’ « héritage » transmis par l’ ADN, alors défendre l’héritage sonnant et trébuchant est logique, indispensable même.
C’est grotesque.
Ecoutez ! Vraiment, sincèrement, si l’héritage devait être défendu, il vaudrait mieux passer la main et laisser cela à des types vraiment talentueux. L’héritage est indéfendable, socialement néfaste au moins.
C ‘est donc un challenge d’un haut niveau de difficulté. Songez, par exemple, que des révolutionnaires patentés comme ceux du Centre-Droit, représenté par Servan-Schreiber dans les années 1980, préconisaient sa suppression avec de bons arguments.
D’un autre côté, voir dans l’interdiction de l’héritage une contribution à un changement du cadre est une supercherie. Cette contribution vient au mieux en 50.ème position parmi les mesures anti-libérales et anti-capitalistes qui seraient nécessaires, à côté d’autres plus positives.
Je ne voudrais pas vous démoraliser, cependant il faudrait voir que votre combat est d’arrière-garde. Il n’a plus de carburant: notre monde est fini. Faut chercher autre chose, quelque part vers le socialisme.
Sans aucune liaison avec le « socialisme » de droite actuel, naturellement.
Il en est des « héritages » comme des « propriétés » .
Ils sont différents par nature ,par objets , par « bénéficiaires », par durée , par limites .
Les mots sont parfois les traces fossiles de nos » préjugés »approximatifs et paresseux .
PS : Gregory pourrait il nous illustrer la rencontre » morale » d’un spermatozoïde capitaliste avec une ovule pleine d’ADN porteur de folie égalitaire ? J’aimerais bien voir la gueule de ce « tigron » forcément stérile et peu digne de vivre ., et en tous cas déshérité dès sa naissance !
@Daniel :
L’ heritage n’est pas seulement des tunes ou une baraque ….c’est aussi et surtout culturel …et ds ce culturel , il faut ranger le népotisme ….les « relations » de ton milieu dont tu useras pour aider ta progéniture a se faire une place ds le trafic …. de façon consciente ou inconsciente ( ou « naturelle » )…de façon a ce qu’il conserve le meme etage de la pyramide ou qu’il en gagne une ….
C’est de cette façon qu’on multiplie les elites et condamnons nos civilisations ….à 23 ans on ne reprend pas la truelle , mais une caisse de superette ( au pire) si on ne peut accéder au fonctionnariat …
@ kercoz.
Bien sûr. Comment ?
Et surtout,surtout, ne refusons pas de commencer un truc sous prétexte qu’il serait imparfait, que les débiles d’en face le contourneraient facile ou autre argument défaitiste.
@ JduCac:j’avais oublié de dire que la famille – une mère,un père,des enfants- me semble le cadre le moins mauvais pour les enfants.( Un avis personnel, toujours bien de le suivre etc…Mais nous n’avons pas le droit de l’imposer à qui jugerait et ferait autrement.)
Votre analogie est donc boiteuse: approuver l’un et refuser l’autre est possible, nécessaire.
Vous-rendez vous compte que vous utilisez la logique (une logique particulière, spéciale jducaquienne…) pour tenter d’amener l’interlocuteur à approuver vos opinions? opinions elles-aussi spéciales. Une conclusion: le libéralisme est manipulateur, simplisme oblige.
En plus il est en relation étroite avec Alzheimer…
L’Homme s’élève quand il abandonne les oripeaux de sa condition matérielle. Et non quand il donne dans la voie de la facilité sous prétexte de nature. La propriété et sa transmission était peut-être acceptable il y a longtemps. Arrondir son champs n’est plus possible sans injustice. Un monde fini signifie que le jeu social est à somme nulle
Une belle image dans un livre que je suis en train de lire (D. C. Johnston, Perfectly Legal, 2003) : l’héritage, c’est envoyer aux Jeux Olympiques, le fils aîné des médaillés de la génération précédente.
@ jducac
Thom: « Le rôle du génome apparaît finalement comme un dépôt culturel des modes de fabrication des substances nécessaires à la morphogénèse. » Esquisse d’une Sémiophysique p.128
La position de Thom (argumentée dans les pages précédentes) rejoint la citation de Johnson par PJ: l’adaptabilité est bien supérieure lorsqu’on considère le rôle du génome comme un dépôt culturel que comme un héritage. Il me semble que de plus en plus de biologistes (dont, tout récemment sur France Culture, le très darwinien J.C. Ameisen) commencent à se ranger à cette nouvelle position (qui n’est autre que la version moderne de la quasi-lamarckienne théorie des gemmules de Darwin). Perso j’en tire un argument que je considère comme puissant contre le capitalisme néolibéral qui impose en fait une société sclérosante (et la démocratie actuelle du chèque en blanc entretient cette sclérose par une « élite-germen »).
Thom: « On ne pourra que s’étonner -dans un futur pas tellement lointain- du dogmatisme avec lequel on a repoussé toute action du soma sur le germen, tout mécanisme lamarckien. » Je suis convaincu qu’il est possible, en profitant d’analogies biologiques, linguistiques, etc., d’inventer une nouvelle société capable de supplanter l’actuelle société capitaliste et néo-libérale en la prenant à son propre piège: une nouvelle société qui va détrôner durablement l’actuelle car elle sera mieux adaptée à la survie de l’espèce.
@ Daniel 1 décembre 2012 à 19:34
Quand l’accumulation de matière, d’expériences, de connaissances et de possessions, qui constitue l’homme n’est plus alimentée par de l’énergie pour le maintenir en vie, est-il toujours un homme ?
L’homme est-il toujours un homme s’il donne la vie à de futurs hommes, sans se sentir obligé de leur laisser un minimum pour vivre, notamment afin perpétuer l’espèce à leur tour ?
N’est-ce pas naturel, quand on est homme, de penser aux besoins que vont avoir ceux qui nous suivent, en particulier ceux qui nous sont les plus proches, ceux qui héritent de nos gènes et nous permettent de nous survivre au travers eux?
@ BasicRabbit 4 décembre 2012 à 08:16
Si je respecte votre conviction, cela ne m’empêche pas de penser que le processus du capitalisme qui, pour moi, est aussi vieux que l’homme, a été à la base de son évolution et a de fortes chances de vivre aussi longtemps que l’humanité. Je n’ai aucune compétence, ni en médicine, ni en biologie, pour m’engager dans un débat s’appuyant sur les subtilités des découvertes dans ces domaines.
Cependant, je ne vois pas d’où vous pouvez tirez votre conviction. Jusqu’à preuve du contraire, la vie humaine se perpétue à partir de la mise en commun, de la fusion du capital génétique d’un homme et de celui d’une femme. Le capitalisme, selon ma manière de voir, ça n’est rien d’autre que l’exploitation d’un capital pour vivre, comme le machinisme est l’exploitation des machines. Ce capital matériel (les gènes) ce support d’expériences accumulées par les différentes lignées humaines est un trésor inestimable, notre capital. Cela n’implique nullement qu’il faille s’en défaire, pour connaître un monde meilleur dans le domaine du vivant.
Bien au contraire, n’est ce pas l’exploitation objective et courageuse d’expériences douloureuses et d’erreurs qui amène à éviter leur perpétuation et permet de progresser ? Alors pourquoi vouloir se priver de ce capital de connaissance et ne pas en tirer de plus sages règles de vie en évitant de jouer aux apprentis sorciers ?
Mon expérience professionnelle dans l’industrie de systèmes complexes, m’a convaincu que pour être à la pointe du progrès et réussir, il vaut mieux envisager l’introduction continue d’améliorations modestes, que d’envisager des remaniements d’ensemble. On n’a souvent ni les moyens, ni le temps, ni suffisamment d’énergie accumulée (le capital financier) pour identifier tous les défauts et tous les points faibles afin d’en prévenir tous les effets indésirables qui peuvent êtres mortels pour une entreprise comme pour toute communauté humaine.
Le courant anticapitaliste engendré par Marx a conduit à des systèmes tyranniques et à des millions de morts. Cela ne suffit-il pas comme expérience douloureuse ?
Quand on veut oublier d’où l’on vient on risque de ne pas savoir où l’on va.
@ jducac
« Jusqu’à preuve du contraire, la vie humaine se perpétue à partir de la mise en commun, de la fusion du capital génétique d’un homme et de celui d’une femme. »
Je fais sur ce blog du prosélytisme pour l’oeuvre de René Thom pour défendre un autre point de vue. Je le répète: pour Thom le génome est un dépôt culturel et non un capital. Vous me direz (comme Hadrien dans cette file): de quoi se mêle ce matheux?
Son point de vue s’inscrit dans une vision complète et cohérente du monde, comme l’ont eu ama peu de gens avant lui (Aristote, Hegel…). On y croit ou non. Perso j’y adhère. Mais, même si l’on n’y adhère pas, je pense qu’il n’est pas inutile de savoir qu’une autre vision du monde existe. Pour qu’il y ait une alternative au cas où le TINA actuel conduirait à une impasse.
Je parie sur l’ovule !! non mais …
un spermato capitalistique aura beau faire la course en tête, et frétiller de la queue à qui mieux mieux, il va se faire recevoir, et comment ! =) magistral tête à queue …l’ovule au bonnet phrygien, trés motivé ( tous ensemble, tous ensemble, ouai …) ne se laissera pas circonvenir, et encouragera les timides ( les Ranrans, en somme )
no pasaràn !
Ha ben alors ! et l’égalité des chances ? !
Disons, en douceur, qu’il existe des espèces où il n’y a que des femelles, aucune où il n’y a que des mâles. 🙂
Pour réduire le glissement de l’ultra-libéralisme vers ce que j’appelle le libéral-totalitarisme dont l’avatar chilien est significatif, de même que le mélange d’autoritarisme et de business chinois, une « évolution » est-elle utopique? Une évolution progressive vers moins de prédation. Après guerre, en France, le programme du CNR avait commencé la mise en oeuvre d’une économie plurielle, sans la dimension environnementale. Cet voie intéressante a été progressivement oubliée. Votre lien vers les socialistes utopistes du 19è siècle me conforte dans l’idée de relancer un vrai secteur authentiquement coopératif fondé sur l’autonomie locale avec un cahier des charges qui permettrait d’éviter l’apparition d’un autre productivisme. Le secteur d’économie socialisé devrait s’appuyer sur les biens communs à protéger pour les générations à venir: ressources minérales,air, eau… L’instinct de survie de l’espèce à moyen terme devrait nous inciter à aller dans cette voie au lieu des évolutions myopes actuelles.
Dans les détails: l’héritage est aussi un instinct de transfert vers sa progéniture pour lui faciliter un peu la vie. Le supprimer complètement me paraît contraire à cet instinct, mais l’encadrer considérablement et le limiter à une ou deux habitations, par exemple, serait-il une piste acceptable? C’est d’ailleurs aussi cet instinct qui incite à accaparer. Supprimer totalement le secteur libéral serait aussi difficile à accepter pour certains.D’où mon idée de Triptyque Economique, comme première étape pour sortir du monochrome actuel. Je tourne autour de cette idée depuis quelque temps. Elle me semble modérée et de bon sens. Ne vaut-il pas mieux une évolution de ce type plutôt qu’un mouvement de balancier brutal dont l’histoire a montré qu’il ne donne que des feux de paille? Après une période d’observation assez longue… d’autres pistes pourraient alors émerger.
L’héritage…
On pourrait imaginer bien des choses, y compris une expropriation en douceur s’étalant sur un peu moins d’un siècle, mais dans la pratique c’est totalement impossible:
– les frontières ne sont plus ce qu’elles étaient donc sauf accord unanime des états ça ne ferait que renforcer l’attrait des paradis fiscaux pour ceux qui y ont accès
– on peut imaginer à la rigueur qu’il soit possible de contrôler les transferts d’argent mais je vous laisse imaginer une société dans laquelle les dons des parents aux enfants seraient surveillés…
C’est le fait que certaines choses ne puissent plus être possédées par un individu (comme c’était le cas pour les routes et les chemins, comme c’est encore le cas pour l’espace aérien, la bordure littorale et me semble-t’il les cours d’eau) qu’il faut envisager.
Encourageant: que des personnes ne puissent plus être propriétaires d’autres personnes a mis des siècles pour être admis et pourtant cette interdiction ne choque plus grand monde…
Est-ce vraiment TOTALEMENT impossible? Ce qui se passe en Icelande est intéressant.
Les dons des parents sont surveillés et réglementés en France. Un montant est prévu, et je crois qu’il vient d’être réduit.Bien évidemment le système en place fait croire qu’il n’y a plus d’autonomie politique possible. Ce qui a été construit par l’homme peut toujours être modifié… sauf ses prédations lorsqu’elle dépasse le point de non-retour: je pense au climat. Les structures et les déstructurations économiques sont-elles liées à des lois physiques définitives?
Le lien suivant suppose qu’il y a encore des marges d’autonomie:
http://www.youtube.com/watch?v=V28vk6DVE1k
Une transition progressive, de type antilibéral, avec des moments forts de nationalisation partielle : une superbe idée.
Paul,
Mais d’où tirez-vous ceci: « l’objectif du processus biologique spécifiquement humain : l’immortalité » ?
Et ne reformulez-vous pas la tentation théiste sous les oripeaux récents de la connaissance, mais au fond, sans réelle nouveauté, sinon de formulation? Les humains ne seraient-ils pas voués à reformuler pour l’éternité des questions anciennes, à mesure que leur science évolue ? Et donc, au fond, le savoir scientifique ne pourra jamais décider de certains débats indécidables, inhérents à l’émergence de la conscience humaine dans le monde minéral ou géologique.
Par exemple, l’état de la science étaie-t-il votre réflexion:
« À partir de la description du globe terrestre sans acides aminés, il n’aurait pas été raisonnable de prévoir l’apparition d’une espèce humaine capable d’étendre par la culture le processus naturel bien au-delà de ce qui était envisageable d’un point de vue purement physique » ?
J’ai l’impression que non.
Bien à vous !
Guy Leboutte, vous n’avez aucune excuse, mon avertissement était sans équivoque : cette version n’avait pas mon aval, c’était écrit noir sur blanc. Vous l’avez ignoré délibérément.
Voici ce que je dis :
D’accord.
J’ai été trop vite. « Délibérément », c’est à voir. 😉 J’étais loin d’imaginer que pareille liberté avec vos paroles fût possible! À ce point-là, les commentaires auraient pu être provisoirement fermés.
J’attendrai la version certifiée.
Quel trouducdesnob ce Roberti.
L’autre face du petit snobinard néo-anar-catho rennais Roberti : http://www.unidivers.fr/avicenne-rennes-prudhommes-hassel-talibi-chapdelaine-amani/#comments
Du « grand journalisme », assurément. N’est pas un Frédéric Ozanam qui veut…
Sur le transhumanisme , attention !
Il y a aux States des versions dominantes qui sont au tranhumanisme ce que l’anarchisme libertarien est à l’anarchisme .
Et tranhumanisme aussi bien qu’anarchisme ne sont pas Vérité .
Alors ? Ce différent a-t-il été aplani oui ou non ?
Ps : Foucault « du même bois qu’Hayek », nouvelle foucade anti- foucaldienne ou bien ?
marrant…je me disais aussi que ça devait concerner ce passage 😉
Le différend était plus général. On peut s’amuser à comparer la version de ce matin, au texte final, que j’ai reconstitué à partir de l’enregistrement.
@vigneron
Il a dit ça ? Non alors ne l’écrivez pas svp. Qu’est ce que je dois pas lire ici !
Un eclairage sur le rapport Foucault/hayek -néolib:
http://www.franceculture.fr/emission-la-suite-dans-les-idees-michel-foucault-et-le-neoliberalisme-la-derniere-lecon-2012-12-01
@Paul Jorion :
/// En réalité, quelles que soient les latitudes de passivité ou d’activité, les degrés de liberté sont nuls. Il n’y a aucune possibilité de jouer la pièce autrement. ////
Un grec ancien a dit qu’il préferait croire aux dieux qu’ aux « physiciens » , parce qu’avec les dieux il etait possible de négocier grace a des offrandes …… Meme si ces physiciens n’ etaient pas les notres, c’est une vue sympa sur le déterminisme absolu et des plus déprimant ………
Dans « a l’ est d’EDEN, il y est question d’ un terme hébreu qui se traduirait par 2 versions » tu sera sauvé » ou … »Tu peux etre sauvé « …qui a déterminé 2 modèles de protestantismes divergeants .
Pour ma part , je trouve intéressant l’ image des attracteurs , ou les « solutions » sont contraints dans une zone restreinte de possibilités, mais gardent une marge de liberté d’action ( liberté qui serait vertueux d’etre accessible par les variables d’entree)
Je pense par ex aux contre-choix ou autre discipline qui permettrait non d’exister mais de « colorer notre bulle »
( le peu de Conscience que l’ on peut esperer …c’est celle du poids de nos chaines et du peu de « JE » qu’elles nous laissent)
[…] des Champs libres à Rennes le samedi 1er décembre à 15h30. Entretien avec le créateur d’un blog de réflexion dont le slogan est… « Big Brother mangera son chapeau ! […]
Nous sommes 100% déterminés ET 100% libres? Sinon c’est le suicide.
Je vous invite à lire cet article de Benoît Hamon sur ses idées en matière d’économie sociale et solidaire. Pour une fois que l’argent n’est pas le cœur d’une ambition…
J’espère que cela va déboucher sur autre chose que la création d’une commission de 50 « spécialistes » qui vont débattre 6 mois et accoucher d’un rapport de 5600 pages qui finira à caler l’armoire d’un luxueux bureau.
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20121130trib000733898/benoit-hamon-assurer-un-terrain-de-jeu-equitable-entre-economie-classique-et-economie-sociale-et-solidaire-.html
Moi je suggère d’arrêter de parler. Et de faire. Arrêter la division du travail et apprendre à tout faire soi-même. Installer dans toutes les villes des hackerspace pour que les gens apprennent des techniques et faire le maximum soi-même.
Exemple, du plus simple au plus compliqué,
1) réparer un vélo, une machine à laver, une machine à coudre, un moteur, une bagnole, un ordinateur, un évier, de la tuyauterie, apprendre à souder, installer un OS libre sur un ordi de récup, un noyau libre dans une téléphone portable, monter des circuits imprimés, faire un panneau solaire, un four solaire, une éolienne, monter un réseau mesh.
3) puis apprendre à coudre, cuisiner avec des plantes sauvages, reconnaître les plantes comestibles, installer un chiotte sec, installer un système de récupération d’eau de pluie, de refroidissement d’air, une yourte ou une installation légère, ou de bois.
4) Utiliser le compost, jardiner sans eau, analyser un sol, connaître les plantes et échanger les semences.
Auparavant avoir réclamé, EXIGE, dans les communes l’accès aux terrains publics intercommunaux qui existent depuis la révolution dans la Constitution.
Quelqu’un voit autre chose d’utile à apprendre en hackerspace? Appellez-le comme vous voulez, atelier communal DIY, ou toute autre appellation acceptable.
Il est temps de faire des choses ensemble au lieu de discuter, et de chercher à savoir qui va avoir le pouvoir, le fric, etc.. MARRE! Si on veut se passer de l’argent c’est possible. Il suffit de le vouloir et d’agir. Point.
Tout le reste, c’est du blablablablablablabla.
Faîtes .
Il n’ y a qu’ une seule façon de « Faire » ….et ce n’est pas « ensemble » .
Ça fait un moment que je nourris l’envie de créer une sorte de fab lab de ce genre, orienté DIY, conservation de l’énergie, low techs et compagnie !
Mais je vois déjà le temps et l’énergie que prennent la gestion d’un atelier de réparation de vélos associatif et autogéré, il me paraît ambitieux de monter d’un coup une structure couvrant toutes les activités que vous décrivez, même si cela serait effectivement un très chouette truc… Ne serait-ce que pour « collecter » les différentes expérimences sur un même site local.
@Youbati
Il ne s’agit pas de réparer les vélos mais d’apprendre à le faire soi-même. C’est toute la différence d’un atelier de formation au DIY et la mise en route d’une alternative économique au capitalisme. Parce dans le premier cas, on en sort.
« Apprendre ensemble à faire », c’est pas la même chose que « apprendre à faire ensemble ». L’autogestion, l’anarcho-syndicalisme & co, ça restera du capitalisme au final. Le Do it Yourself n’implique aucunement de maîtriser des techniques, ni de s’organiser pour trouver des compétences et du temps, etc…uniquement d’apprendre et de partager ses erreurs et réflexions. Point. Si quelqu’un connaît et peut donner des conseils, tant mieux pour lui, mais apprendre en faisant c’est mieux. Pour les conseils, il y en a des milliards sur internet. Cela reste notre mémoire et notre cerveau.
Pour toute organisation, il suffit d’avoir un besoin. D’avoir un endroit où le dire, pour réunir les gens qui ont le même, au même endroit, au même moment. D’apporter le matos en question ce jour-là.
Ah mais c’est exactement de ça que je parlais ! Désolé j’ai raccourci un peu en donnant l’exemple de l’atelier, mais en pratique des bénévoles calés en mécanique montrent, expliquent, laissent faire ceux qui viennent réparer, puis vérifient. Des bénévoles s’en vont et sont remplacés par certains anciens « clients ».
Je ne crois pas que vous ayez compris ce que j’ai dit. Pas de bénévolat, pas de compétences supérieures, pas de cours, de transmission ni de réappropriation du savoir. Il n’est question que de « bidouillage » dans les hackerspaces. Ce sont des zones d’autonomie temporaires. Des ateliers improvisés. Pas de local à entretenir, à payer, etc… relisez. L’exemple des install-parties ou des « black night linux » ne peuvent pas complètement décrire ce phénomène non plus, bien que cela s’en rapproche.
Oui Blablabla comme les 68 tards qui pouvaient agir sous la houlette des écrits d’Yvan Illich qui déjà détaillait « les mythes des valeurs institutionnalisées, étalonnées, conditionnées même celui du progrès éternel ». 42 ans après le doute prend forme! Pour l’action…
@ Miluz, ok, ok. Mais sans déconner, vous croyez vraiment que tout le monde peut se mettre à ça comme ça en claquant des doigts ? C’est certes bien beau tout ça, mais à un moment faut se calmer sur l’idéalisme pur. Et attention, je connais et fréquente un des squats les plus connus d’Europe (aka les Tanneries à Dijon) et je vois très bien de quoi vous voulez parler. Ils font tout plein de trucs de votre liste et j’en ai fait avec eux, dont notamment l’ouverture d’un potager collectif sur terrain occupé sans demander à personne, etc.
Sauf qu’il ne faut pas oublier que d’une, le souci c’est d’amener d’autres gens à faire pareil, et là je suis désolé, je pense qu’il y a un apprentissage, tout le monde n’a pas la même disposition à franchir ce genre de pas là. Si l’idée est bien de se passer d’argent, ça fonctionnera d’autant mieux qu’il y aura de « participants ». On peut très bien se cantonner à ce genre de réalisations entre nous, avec des exigences élevées, mais rien n’avancera à ce compte là. Faut bien admettre que si on est globalement sur la même galère, y a des marins qui rament à des rythmes différents… Ce que je veux dire, c’est bien beau les idéaux d’entraide et de pureté auto-débrouillarde, mais à un moment si on veut que ça change quelque chose, il faut descendre de sa tour d’ivoire auto-construite et aller voir les autres. Sinon, c’est stérile en terme d’évolution potentielle.
Et ça m’amène à de deux : le mot important ici, c’est transition. Il faut que les éclaireurs acceptent que beaucoup de ceux qu’ils aimeraient voir les suivre, risquent d’avoir besoin de paliers progressifs. J’ai bien vu qu’il y avait des gens plus ouverts vers ceux qui ne sont pas dans les « luttes »(combien d’énergie consacrée à protéger son espace de vie et perdue à faire le reste ?) et qu’il y a ceux qui s’enferment dans leur truc, ça en devient la lutte pour la lutte, sans envie de partager et inviter de nouvelles personnes à créer. Les chemins doivent se créer tout seuls, sinon on tourne en rond.
Je pense avoir saisi que vous me parlez d’un truc totalement apolitique. Mais alors justement, comment aller choper des gens et leur proposer d’apprendre la phytothérapie de but en blanc, sans même leur refaire tout le cheminement intellectuel sur l’autonomie, et donc plus ou moins l’anarchie ? Vous me feriez des propositions du genre, je suis entièrement partant, mais pour réunir mettons 50 personnes avec un objectif d’éclairer et d’apporter du neuf à au moins la moitié ? Vous vous y prenez comment ? Les hackerspaces, c’est sûrement de la balle, mais c’est toujours pareil, on peut pas amener n’importe qui là dedans. Y a des chances que ce genre de choses se mettent en place spontanément et ça commence doucement, mais par des initiatives moins radicales. Le pur DIY, c’est quand même hardcore pour beaucoup de gens, pour une entrée en matière directe.
Ben déjà, les 50 personnes tu les as devant les restaus du coeur ou au secours pop pendant les distributions 2x par semaine en hiver. Le nombre de gens dans le besoin ne fait qu’augmenter.
Mais ce n’est pas le but de « choper » les gens. Tu commences à deux ou trois. Dans un bled, tout se sait très vite. Pas besoin de faire de la pub, ni de mettre des annonces.
Et il y a des terres dans chaque commune, qu’il est possible de réclamer auprès des instances intercommunales. Elles sont pour l’instant entre les mains des assoc du secours pop ou catholique, ou des restaus du coeur, des retraités bénévoles qui n’ont pas à se les approprier. Ils n’ont rien à faire là. Ils ne savent pas s’en occuper, ni organiser quoi que ce soit sans discipline militaire, avec mépris et ségrégation. Ils ne savent que faire travailler des « emplois aidés » et bientôt les CaFards sur ces terres.
Sinon, ils font appel à l’Union européenne pour distribuer des surplus de l’industrie agro et aux gendarmes au moindre problème. L’important pour eux c’est de se croire utile en faisant la charité, tout en profitant du fric pour faire des voyages, et en se servant les premiers de la nourriture récupérée à la sortie des supermarchés. Ca suffit!
Il ne s’agit pas d’organiser des réunions mais de répondre à des besoins. D’apprendre à se débrouiller sans payer.
Et tu trouves ça surtout chez les femmes.
Qui en ont marre de dépendre du bon vouloir des hommes pour réparer les machines, qu’elles payent une fortune pour un service minable et méprisant. Elles ont aussi soif de s’occuper de la terre pour nourrir leurs familles. Kokopelli est au courant de ce besoin, et fait une campagne dans ce sens en ce moment.
Celles et ceux qu’on nommait « sorcières », ou « sorciers » ne connaissaient pas les jouxtes verbales d’un Proudhon, Trostky ou Bakounine, ni même le Cadastre perpétuel d’un Gracchus Babeuf, et pourtant… ils savaient déjà tout.
Si on arrivait à récupérer quelques recettes, on pourrait même parler de révolution.
Connaissez-vous l’open source ecology ?
« We have the power, So, inspire the people to. Go out, and build yourself » 😉
A propos des dieux ascendants ou descendant , du non-sens vain selon moi de « recherche d’immortalité » ( quelle cauchemar !) , mes propres références :
http://www.pauljorion.com/blog/?p=43728#comment-382029
Je ne recherche que le sens , en essayant d’abord d’éviter les non-sens , dont celui de l’aristocratie , dont celui de l’argent .
Pour » l’affect » , je suis encore dans une relative incompréhension .
Aïe , l’orthographe !
Terriens, encore un effort pour sortir de la préhistoire !
Note : aucun cyborg n’est l’avenir de l’humanité, quoique puisse vouloir en faire accroire certains délirants.
Cf plus haut : arrêter de parler et faire ensemble. Parce que sinon, on finit par dire n’importe quoi. (Relisez le manifeste cyborg svp, cela n’a strictement rien à voir avec le transhumanisme http://www.cyberfeminisme.org/txt/cyborgmanifesto.htm).
La science-fiction ne serait-elle pas dépassée par la réalité ?
@P.J. (sis au quai des Orfèvres)
/// Nicolas Roberti – Suggérez-vous qu’une fois écartée l’acception de Dieu comme cause efficiente, Dieu pourrait se révéler une forme de projection, comme une « post-construction » qui constituerait un nouveau stade de l’humanité ?
Paul Jorion – C’est cela. De la même manière qu’à l’époque où n’existaient encore sur le globe terrestre que des acides aminés, il n’aurait pas été raisonnable de prédire l’apparition d’une espèce telle que l’espèce humaine, capable de prolonger par sa culture les processus naturels bien au-delà de ce que suggère la simple physique. ////
Le mot important est « CULTURE » .
C’est la Thèse Organiciste … qui voit l’ évolution d’ une espece sociale vers une entité de stade supérieur …ou l’ individu n’est qu’ un constituant de l’ organisme évolué ( Societe) .
Le problème ( enfin le notre !) c’est que cette évolution s’effectue au detriment de l’individu (comme la cellule en se spécialisant elle perd son « eternité » et sa liberté-independance-spécificité)
Je Crois que Durkheim avait posé la thèse que la recherche de « dieu » etait en fait cette recherche d’ une entité parfaite issue de la société .
Il est vrai que c’est la civilisation qui évolue-progresse et non l’ individu dont le cognitif n’ a pas bougé depuis le paléo …. Un petit grec pourrait faire science po sans problème !
Pour moi qui voit Dieu (ou plutot le concept « religion » comme la continuation « raisonnée » des rites anciens ( expliqués aux Blaireaux) ..) ….ce modèle pose problème car il rapproche l’ organisme « global » du modèle utilisé par l’ instinct ..la fourmi ..ou l’ individu n’ a plus , in finé , qu’un role « neutralisé » desafecté. ….. Je persigne a voir ds ce modèle une impasse comme la nature en a essayé des millions .
Ah merde. Si Dieu descendra de l’Homme, ce que je suis porté à croire depuis toujours, et que l’horreur héritière sera un jour abolie, ce que je pense inévitable, que va-t-on laisser à nos divins descendants ? Le royaume des dieux ? 🙂
« Si Dieu descendra de l’Homme »
A mon avis, ils surmonteront le biologique. L’Homme c’est peanuts, au mieux on ne peut que générer des singes évolués.
Mieux vaut lire ça qu’être aveugle, sans doute…
Par contre la relation entre l’homme , ce « singe nu » , et les nuts est intéressante .
Mais on ne va pas se chercher des poux dans la tête !
@Marc Peltier: bravo, vous avez réussi à sortir trois mots d’une réponse qui ne faisait pourtant que deux phrases. Le contexte est important. Je répondais bien sûr à vigneron sur la fabrication de Dieu, et donc l’Homme est peanuts face à Dieu, impossible que sa génération vienne de là.
Si je vous réponds, c’est uniquement pour vous dire à quel point votre méthode intellectuellement malhonnête m’a fâché. Pour le reste, allez vous faire cuire un oeuf.
Eux .
Bravo pour cette formule que n’aurait pas désavoué Laplace, à propos du libre-arbitre:
« Nous ne sommes pas passifs au sens où nous éprouvons véritablement ces situations, mais notre degré de liberté, étant ce que nous sommes, est nul : il n’y a aucune possibilité de jouer la pièce autrement. »
De même, sur le sens du « gradient » qu’a imposé, jusqu’à présent, la pression sélective:
« …nous sommes entraînés dans un processus où nous sommes motivés à survivre en tant qu’individus et, de manière incidente mais liée, à assurer la continuité de l’espèce. »
Mais pourquoi donc, paradoxalement, regretter:
» que la vie, le processus biologique, a échoué dans le cas de notre espèce à réaliser ce qui aurait pu être l’une de ses formes, celle qui aurait rencontré les aspirations de l’individu, à savoir que l’immortalité lui soit garantie. »
Tout d’abord, cette perspective n’est pas si inaccessible, au vu de l’avancée inéluctable des manipulations génétiques en biologie moléculaire. Ensuite, cela pourrait malheureusement annoncer la véritable apocalypse finale redoutée de temps immémoriaux par toutes les civilisations !
Pas si inaccessible, si l’on en croit la biologie: Depuis que la théorie Darwinienne s’est imposée et vérifiée expérimentalement en laboratoire, on sait avec certitude que, chez toutes les espèces sexuées, l’individu (phénotype) n’est là que pour transmettre son génotype à sa descendance croisée. Seule sa période de vie reproductrice entre en jeu dans le phénomène de sélection naturelle qui entretient ces espèces, voire les améliore en profitant des rares mutations favorables à l’échelle des temps longs.
Passé sa période de reproduction, l’individu ne sert biologiquement plus à rien dans le schéma Darwinien. Mourir est la chose la plus utile qu’il puisse accomplir dans les communautés aux rudes conditions de survie, ce que l’homme ne manquait pas de faire jusqu’à une époque récente au regard des temps biologiques: aux temps pré-néolithiques, on mourait à la trentaine. Il est clair pour nombre de biologistes que la vie au-delà est une continuation en roue-libre, et que notre potentiel biologique diminue, l’information génétique dans nos cellules étant de moins en moins performante pour l’entretien et la réparation physiologiques (résistance aux infections, cancers, accidents cardiaques, etc.). La nature a pu ainsi, chez les êtres sexués, relacher le programmme génétique virtuellement immortel des êtres monocellulaires (amibes) ou de certains êtres pluricellulaires très anciens (méduses). D’une certaine manière, la mort est chez nous génétiquement programmée, par inutilité de l’entretien: l’espèce sexuée se perpétue, voire se fortifie, par le croisement et non la durée de vie individuelle.
Seuls les progrès de l’alimentation, de l’hygiène, et des conditions de vie nous ont menés à la longévité que nous connaissons. Plus que la médecine, contrairement à la croyance répandue, puisqu’il y a deux mille cinq cent ans, sous des cieux cléments, Platon mourait à 84 ans, Pythagore à quelque 90, et Démocrite, dit-on, fut centenaire !
Mais l’homme est parvenu depuis peu à déchiffrer le code génétique.
Certes, l’apocalypse n’est pas pour ce 21 Décembre 2012,… mais on discute déjà du clonage de l’embryon au Parlement. Qu’en sera-t-il lorsque l’on saura réparer le relachement génétique du vieillissement pour vivre aussi longtemps que certaines méduses ?
On préfère ne pas y penser…
L’homme immortel à portée de main, voilà une transcendance bien embêtante à laquelle Teilhard de Chardin n’avait certainement pas songé !
A côté de cela, les 2° tant redoutés d’augmentation de la température, peut être 4 selon les plus alarmistes… d’ici la fin du siècle, nous apparaîtront comme le dernier de nos soucis !
On aura alors tout le temps de méditer ce message qui nous est parvenu par la tradition orale de nos ancêtres africains:
« Lorsque les dieux veulent nous punir, ils exaucent nos prières… »
Ce n’est pas la génétique qui réduira l’auto-encombrement du cerveau avec l’âge.
La plus grande adaptabilité des individus jeunes, en phase d’apprentissage, constitue aussi en principe un autre frein à la prolifération du « vieux cerveau ».
Maintenant, le point qu’atteint l’héritage en fait une prolongation intergénérationnelle de la vie plus que de la seule propriété, donc la survie d’un « méta-humain » qu’est une lignée semble accomplir la forme d’immortalité que vise l’homme. A l’appui de cette crainte, malgré l’accélération des évolutions techniques qui effacent la valeur d’usage des possessions elles-mêmes (j’ai des pierres taillées et des arbalètes chez moi, ça ne me rend pas plus « fit » dans la société de 2012) , il y a un conservatisme croissant intra classe-sociale.
Donc autant dire que la « colonne vertébrale » du « méta-humain », c’est l’héritage (de biens et de culture), contre lequel le welfare state est allé buter, entre autres .
Votre « auto-encombrement du cerveau » est une vision toute personnelle qu’aucune théorie scientifique ne corrobore:
Au contraire, ce qu’on sait de la neurologie tend à conclure que les idées se structurent au cours du temps dans le cerveau, par reconfiguration des synapses avec l’apprentissage.
Et ne confondez pas à ce sujet la rapidité d’apprentissage d’un jeune cerveau vierge, avec la qualité du résultat : à preuve, l’enfant-loup qui n’était capable que de reproduire les grognements et la marche à quatre pattes de son environnement vécu.
Il n’y a ni « prolifération » ni « auto-encombrement » du « vieux cerveau », comme en témoignent les exemples donnés par Platon, Pythagore et Démocrite.
Un exemple plus proche: Newton écrivit son oeuvre célèbre ( » Philosophae naturalis principia mathematica ») qui fonda les lois la mécanique, à l’âge de 66 ans !
Le seul obstacle actuel au bon fonctionnement du cerveau, au-delà d’un certain âge, est bien la dégénérescence, par mort des neurones, et non son « auto-encombrement »:
Il faut croire que la maturité des idées d’un « vieux cerveau » a du bon, au vu des exemples ci-dessus, puisqu’elle s’avère compenser largement la diminution du nombre de neurones (qui commence dès l’âge adulte).
Merci, c’est constructif … Je rebondis : Est-ce contradictoire ?
Le processus intellectuel avec l’âge n’est pas bloqué en tout ou rien et pour tous uniformément par les mécanismes adverses.
Tous accumulent une sagesse et une expérience, que la dégénérescence seule fait disparaitre (Hessel aussi).
Mais il est patent que l’outillage d’une nouvelle génération, qui fait tout un humus pour les suivants, est surtout bricolé par des cerveaux jeunes.
La créativité qui subsiste, un peu comme les nombre premiers passent le crible d’Erathostène sans borne supérieure (leur densité diminue en quelque chose comme 1/xLn(x) de mémoire), du fait qu’elle s’articule sur une riche expérience, nous donne de belles étincelles, ceux que vous citez, des Jorion, des Szilard, des autres « marvelous mavericks ».
J’admets que même dans une vision darwinienne, ils ont un rôle par les ruptures qu’ils peuvent enclencher, mais le gros de l »opérateur d’évolution », ce qui travaille l’humus et fait pousser les tiges de toute le sous-bois, ça reste du cerveau « moins encombré ».
JE suis donc d’accord au final que la notion d’encombrement est inapproprié, il faudrait que je trouve plutôt une analogie type crible d’erathostène (qui laisse un ensemble de mesure décroissante , voir « vanishing » (tendant vers zéro en proportion du tout) avec l’âge, mais dont les « vols de Levy intellectuels » sont.. hauts ).
@ Hadrien
« Depuis que la théorie Darwinienne s’est imposée et vérifiée expérimentalement en laboratoire, on sait avec certitude que, chez toutes les espèces sexuées, l’individu (phénotype) n’est là que pour transmettre son génotype à sa descendance croisée. Seule sa période de vie reproductrice entre en jeu dans le phénomène de sélection naturelle qui entretient ces espèces, voire les améliore en profitant des rares mutations favorables à l’échelle des temps longs. »
PJ se bat contre des affirmations semblables en « science » économique: c’est l’objet de « Misère de la pensée économique ». Je fais sur ce blog du prosélytisme pour l’oeuvre de René Thom en particulier pour lutter contre de telles affirmations en biologie, contre la misère de la pensée biologique (voir mon commentaire 5).
Connaissant les travaux de René Thom et étant moi-même mathematicien-physicien, je suis de ceux qui ont un certain scepticisme sur les extrapolations hatives hors de son propre domaine de spécialité. Thom l’a fait également pour la physique des particules, dont il ne connait manifestement que des bribes rudimentaires, et a commis un petit livre à ce sujet qui n’a même pas été considéré par ses pairs physiciens, sinon d’un sourire…
René thom n’étant pas biologiste, mais mathématicien pur, son évocation d’un Lamarckisme renouvelé à la faveur de ce qu’il sait de la stabilité structurelle en « théorie des catastrophes », laisse plutôt songeur…
Mieux: Le Darwinisme, qui l’a supplanté, a trouvé sa confirmation en mathématiques elles-mêmes: les méthodes « génétiques » ou « particulaires » permettent de résoudre des problèmes d’optimisation directe qu’aucune autre méthode systématique ne sait aborder. Elles procèdent par « mutations » ou « bruit » qui servent d’exploration aléatoire des possibilités d’amélioration, sanctionnées ensuite par leur adéquation, puis sélection reproductive par un processus de branchement: en somme, c’est faire de « l’élevage sélectif » de solutions par l’algorithmique…
Mais la nature nous avait précédé !
@Hadrien
Merci Hadrien… D’ailleurs le plus grand avocat de R. Thom était Salvafor Dali, c’est dire.
Merci d’introduire de la rationalité ici parce que je me sens bien seul parfois à la défendre, Rabbit bénéficiant d’une quasi-impunité en la matière. Il a un passe-droit pour publier des posts où le rêve le dispute à la réalité, en guise de thérapie.
@ Hadrien
Vous semblez bien sûr de vous…
@ Lisztfr
Thom a au moins un autre discret avocat sur ce blog…
@BasicRabbit
Je sais…
http://www.flickr.com/photos/37445094@N07/3683988557/in/set-72157623066454410
Même du chaos sur la Ti 86
http://www.flickr.com/photos/37445094@N07/4550993713/in/photostream/
@ Hadrien
« Bravo pour cette formule que n’aurait pas désavoué Laplace, à propos du libre-arbitre:
« Nous ne sommes pas passifs au sens où nous éprouvons véritablement ces situations, mais notre degré de liberté, étant ce que nous sommes, est nul : il n’y a aucune possibilité de jouer la pièce autrement. » »
Je suis certain que Paul Jorion ne pense pas à Laplace quand il écrit cela. Il s’agit pour lui non pas du déterminisme quantitatif, laplacien, mais du déterminisme qualitatif qui prend sens dans le cadre de la stabilité structurelle initiée par Henri Poincaré, développée par Stephen Smale et d’autres dont René Thom. Ce dernier a étudié en détail les dynamiques les plus simples, les dynamiques de gradient, les plus simples parmi les plus simples étant les 7 catastrophes élémentaires (c’est ama -et pas qu’ama!- pour cette raison qu’on les retrouve dans quantité de phénomènes naturels).
Si vous relisez le texte de l’interview de ce billet vous y trouverez les mots-clés: dynamique, gradient, [davantage] qualitative [que] quantitative. Il est très clair pour moi que ce n’est pas un hasard mais a, au contraire, un rapport direct avec ce qui précède.
La suppression du droit d’héritage est directement lié à celui de la propriété privée. Et la propriété privée est un droit fondamental inscrit dans la déclaration des droits de l’homme. Mais pas seulement : il est aussi considéré par l’Église comme un droit naturel. Ainsi toute tentative visant à supprimer la propriété privée rencontrera devant elle tous les conservatismes mais aussi une foule de petits propriétaires pris de panique à l’idée de perdre leur petit lopin de terre ou leur maison. Par ailleurs les défenseurs du capitalisme comme univers indépassable évoque la suppression de la propriété privée et la possibilité de s’enrichir comme la cause principale de l’échec de la révolution bolchevique.
Ainsi si l’on veut faire avancer l’idée d’une société ou la propriété privée ne devra pas être un moyen d’exploitation sans pour cela la supprimée totalement, il conviendra dans donner un cadre dans lequel elle peut s’inscrire. Le passage d’une société ou règne la propriété privée comme fondement à une autre société visant à sa disparition ne se fera pas sans problème et sans risque et certainement pas brutalement. IL convient à mon avis d’apporter des explications sur la propriété privée et de faire une distinction entre la possession d’un bien sans pour autant faire de celui-ci un moyen d’exploitation et d’enrichissement personnel .
« une foule de petits propriétaires pris de panique à l’idée de perdre leur petit lopin de terre ou leur maison »
S’ils sont assurés d’avoir de quoi se nourrir et se loger ces petits propriétaires ne verront plus les choses de la même façon: ça suppose bien sur d’avoir une grande confiance en ce qui pourra les remplacer et d’autres aspects que la sécurité que confère ces possessions entrent en jeux mais ça n’est pas négligeable. Le fait que les générations successives ne vivent plus ensemble dans un même lieu a déjà modifié le sens qu’avait ce type de propriété: l’eau ne vient plus du puits, l’électricité et les soins médicaux sont obligatoirement fournis par l’extérieur, etc…
@Mephisto:
Lénine disait (?) que la révolution tient à 9 repas …
Un autre a dit que la difference entre la misère et la pauvreté , c’est un mulet et 1000 m2 .
Je pense comme cet iranien (?) que ce point de repli devrait etre inaliénable …qu’on ne peut remplacer un moyen de subsistance par de la monnaie .
Entre la permission et l’accumulation inégale d’un côté , et la suppression et les pires excès de la collectivisation de l’autre , c’est le chemin que la démocratie doit trouver en sortant du tabou de la propriété sacralisée et idéalisée .
droit d’usage ou usage du droit ? voir les reflexions de giorgio agamben sur ce sujet et son homo sacer qui sont tres interressantes
Ah oui et cela s’annonce vraiment très passionnant ! (de quoi en faire, au moins, tout un bouquin)
Peut-être, est-ce le véritable défi de ce siècle, (avec un ou deux autres), que nous devrons affronter : la propriété privée.
« Mon existence dans la propriété est un rapport à d’autres personnes, c’est de là que provient la reconnaissance réciproque, le libre est pour le libre. Me sachant libre, je me sais être universel, je sais les autres libres, et sachant les autres libres, je me sais libre. Voilà pourquoi le principe du droit est le suivant : respecte-toi ainsi que les autres dans leur propriété comme des personnes » .
(Hegel – dans, les Leçons sur le Droit naturel et la Science de l’Etat)
-Et si nous faisions de la Terre, une personne, pourrait-elle être aussi propriétaire et ainsi nous devrions être dans le devoir de la respecter, comme toute autre personne libre et propriétaire… Utopie ?
Concernant le transhumanisme :
voir le documentaire de Philippe Borrel diffusé récemment sur Arte, ( déjà mis en avant par intervenant du Blog )
présentation : http://www.arte.tv/fr/un-monde-sans-humains/6968786.html
un lien : http://www.tux-planet.fr/un-monde-sans-humains/
Merci de l’avoir retrouvé .
C’est bien à ça que je faisais allusion, en écrivant » Attention ! » .
Sur la « RATIONNALITÉ » de la « SCIENCE » économique
dans « MISÈRE DE LA PENSÉE ÉCONOMIQUE »
Je profite de ma lecture récente de l’ouvrage pour exprimer ici un petit regret, celui de ne pas y avoir trouvé le renfort d’une argumentation pourtant développée sur ce site, et qui fut remarquée au point d’être sélectionnée comme article invité: http://www.pauljorion.com/blog/?p=33654
Nul doute qu’elle avait été fort bien comprise puisque le « sélectionneur » lui donna le titre:
L’ÉQUILIBRE DE MARCHÉ NE GARANTIT AUCUN OPTIMUM COLLECTIF, titre que je n’aurais pas pu mieux choisir !
Cette argumentation, en effet, constituait une critique de la théorie néoclassique, non pas « en extériorité » comme il est dit ici, mais de l’intérieur en démontant mathématiquement la « fausse rationnalité » de ses conclusions. Les mathématiques servent justement à ne pas se laisser berner par les économistes lorsqu’ils en font… à leur façon.
De quoi est-il question ?
De la revendication la plus importante de l’économie dominante depuis la dernière guerre:
Le (frauduleusement nommé) « OPTIMUM DE PARETO »
dont la définition mathématique n’est pas celle d’un optimum, mais d’un simple équilibre de forces conflictuelles, à peine plus satisfaisant que celui de Nash (i.e. débarassé du paradoxe des deux prisonniers) !
L’utilisation optimale du “potentiel” humain est en effet un problème largement irrésolu de l’organisation des sociétés, pour peu que l’on affecte à ce terme sa signification globale (Quel est le critère global ultime à “optimiser”, incluant dans les justes proportions tous les intérêts conflictuels individuels ?).
En économie, la théorie néoclassique enseignée partout en est restée au libéralisme le plus primitif, dans sa formulation de base, quoiqu’on dise:
Ainsi, le schéma de “l’équilibre général” formulé originellement par Walras, formalisé ensuite par Arrow et Debreu, pour aboutir in fine aux théorèmes sur la société du “bien-être” n’est jamais qu’un équilibre de forces conflictuelles, tout comme dans la société primitive.
Non seulement il faut, pour démontrer sa simple existence (au sens de Pareto), enlever toutes les situations de blocage (dilemme du prisonnier, bien communs, etc.), mais surtout il “n’optimise” rien du tout de global puisqu’aucun critère de ce type n’y figure: l’équilibre obtenu est la simple expression que chacun y maximise son propre critère, dans les limites que lui imposent les intérêts de tous les autres… qui font la même chose.
On l’a pourtant appelé “optimum de Pareto”, dès l’instant où aucun participant ne peut améliorer son intérêt propre sans nuire à celui d’un autre !
Ce résultat est vide de tout enseignement pour ce qui est recherché ici:
Ainsi, prenez un gateau coupé en huit, dont vous avez sept parts et votre convive une seule… C’est un équilibre de Pareto ! (il suffit de vérifier la définition)
En réalité, ce “théorème du grand équilibre” ne garantit qu’une chose: le non-gaspillage de la ressource (i.e. personne ne va jeter une part). C’est pour cela que les plus honnêtes lui donnent le nom d’ “efficient” plutôt qu’ “optimal”… La belle jambe !
Pour tous ceux qui ont entendu prononcer (et même rabacher) “l’efficience des marchés”, ou leur “allocation optimale des ressources”… C’est tout simplement ça !
Il y a là une escroquerie sémantique évidente:
Personne ne garantit en quoi que ce soit qu’un critère global est optimisé, et donc a fortiori que c’est bien un fonctionnement optimal de la société (Optimisant quoi?).
RAPPEL: pour ceux qui douteraient d’une telle évidence, il n’y a d’ “optimum” (en latin, “meilleur”) que dans un ensemble complétement ordonné (cf. Bourbaki: Eléments de mathématiques, Théorie des ensembles), donc avec un seul critère d’ordre.
Pour résumer ici http://www.pauljorion.com/blog/?p=33654, que pourrait (et devrait) être un tel critère ?
Dans une collectivité citoyenne, chaque agent i (individu ou ménage) a une fonction d’utilité qui lui est propre u(i,xj,dij), où :
– l’argument vectoriel xj décrit tous les biens et services échangeables en économie, y compris le travail et le numéraire. (Revenu, pouvoir d’achat, etc. ne sont que des aspects de cette fonction u(i,x) qui est elle-même un agrégat).
– l’argument vectoriel dij représente chaque décision de l’agent i d’échanger un bien ou service j.
PARETO lui-même a été conduit à définir comme critère d’optimalité sociale l’utilité globale agrégée :
U(x) = Somme sur i de a(i).u(i,x,d).
C’est une combinaison linéaire convexe des utilités élémentaires des citoyens, comme fonction d’utilité agrégée de la société. À un facteur multiplicatif près, sans incidence sur l’optimisation, cela n’est rien d’autre que l’espérance mathématique de la fonction d’utilité individuelle, sous la forme plus concise:
U(x) = Somme des Pi.Ui(x,d), avec Somme des Pi = 1, i étant l’aléa individuel,
Pi représentant la probabilité d’occurence de la fonction d’utilité Ui(x,d) dans la population.
Dès l’instant où ce point est acquis, tout le reste découle comme conséquence logique:
On admet, en effet, en économie, que tous les agents sociaux ont une fonction d’utilité constructible vis à vis de tous ses arguments, pour peu que l’on interroge les dits agents convenablement (la théorie des substitutions et des préférences y pourvoie, si nécessaire, au plan méthodologique).
Dès lors, la formulation univoque du problème d’optimisation de l’économie politique, telle qu’énoncée par les utilitaristes, ainsi que Pareto, s’obtient en remarquant que:
Pi = Ni/N
où Ni est le nombre de citoyens ayant la même fonction d’utilité Ui(x,d),
N le nombre total de citoyens.
On voit là tout l’intérêt de la formulation fréquentielle en Ni/N par les probabilités: lorsque la population est en nombre N élevé, il est impossible d’interroger un à un les citoyens pour connaître leur fonction d’utilité. Cela devient, en revanche, plus envisageable si l’on peut disposer d’un échantillon réduit de n citoyens, où les rapports réduits ni/n=pi sont les mêmes que les rapports Ni/N, c’est à dire les probabilités Pi.
Dans ce cas seulement, on peut parler d’une démarche “démocratique” car elle préserve fidèlement la représentation du peuple par la représentativité de l’échantillon.
Deux sortes d’une telle démarche ont été appliquées dans l’histoire:
– la démocratie directe par tirage au sort : c’est celle de la démocratie athénienne dans la Grèce antique, qui dura prés de deux siècles (-507 / -322). Elle possède la propriété essentielle, dite “sans biais”, que l’espérance mathématique de u(x)=somme des pj.uj(x), sur l’échantillon réduit, est la même que celle de la population totale, même si la cardinalité de j est inférieure à celle de i (autrement dit, même si toutes les fonctions d’utilité ne sont pas représentées). C’est si vrai que cela s’applique en particulier au tirage au sort d’un seul représentant, dont l’espérance reste non biaisée. C’était là tout le sens de la “Stochocratie”.
– la démocratie indirecte par délégation élective : c’est celle appliquée de nos jours par les “démocraties occidentales”. Elle consiste théoriquement à regrouper les citoyens qui se reconnaissent tous la même fonction d’utilité Ui(x,d) qu’un des leurs, qu’ils élisent comme représentant dans l’échantillon réduit des uj(x,d). Elle nécessiterait i=j, donc la même cardinalité, d’où l’adverbe “théoriquement” ci-dessus, car ce n’est jamais le cas en pratique. Dans tous les cas, le citoyen doit se prononcer pour celui des représentants qui lui paraît “proche” avec tous les inconvénients biens connus qu’évitaient les grecs: démagogie, influence de l’éducation, de la position sociale, de la fortune, etc.
CONCLUSION:1/ Les inégalités obtenues dans une société ne peuvent être jugées en “soi”, mais en vertu du critère global ultime auquel on se réfère. Quelle expression a-t-il ?
2/ Le problème se complique lorsqu’on inclue le temps, en considèrant l’optimisation globale d’une société sur un horizon pluri-générationnel… Quelle pondération entre présent et futur ?
A y réfléchir, les problèmes d’héritage des biens parentaux,… ou des biens de la planète, sont les mêmes !
Je peux apporter de l’eau au moulin d’Hadrien, en complétant sa CONCLUSION 2 par un argument rigoureux sur la dynamique temporelle du capitalisme, que j’ai évoquée dans un commentaire terminal de http://www.pauljorion.com/blog/?p=33654, et qui rejoint curieusement les conclusions anciennes de Marx sur l’accumulation du capital:
Il faut d’abord insister sur ce que la théorie économique néoclassique exprime sur le fonctionnement libéral des marchés, pour comprendre le phénomène de croissance du capital et des inégalités:
Ainsi, le schéma de “l’équilibre général” formulé originellement par Walras, formalisé ensuite par Arrow et Debreu, pour aboutir in fine aux théorèmes sur la société du “bien-être” au sens de Pareto, n’est jamais qu’un équilibre de forces conflictuelles, tout comme dans la société primitive: l’équilibre obtenu est la simple expression que chacun y maximise son propre critère, dans les limites que lui imposent les intérêts de tous les autres… qui font la même chose.
(On l’a appelé faussement “optimum de Pareto”, dès l’instant où aucun participant ne peut améliorer son intérêt propre sans nuire à celui d’un autre… La belle affaire!)
Le problème s’enrichit (sans jeu de mots) lorsqu’on le rend réaliste en incluant le temps. Quand on poursuit alors l’analyse, au moyen de ce qu’on sait en théorie des jeux, on s’aperçoit que le système dynamique résultant est instable: tout avantage ou désavantage d’un des agents à un instant t, s’amplifie exponentiellement ultérieurement avec le temps.
L’interprétation économique est trés simple:
Il s’agit tout simplement de l’accumulation capitaliste par le profit telle que décrite initialement par Marx, et que la financiarisation n’a fait qu’accentuer:
– le taux d’accumulation nourrit l’accumulation
Tout comme, inversement, pour les débiteurs:
– le service de la dette nourrit la dette
Ceci existait déjà, on l’a dit, dans « l’économie réelle » chez Marx. Mais le taux d’accumulation par le biais du profit y représentait encore une créativité et un travail organisationnel de l’investisseur-exploiteur dont la rétribution n’était pas forcément illégitime (il le dit lui-même dans « Le Capital ») mais simplement arbitraire.
Tout a changé avec la financiarisation, aidée par l’informatique, où la superstructure « finance » fait de l’argent avec de l’argent sur un simple clic, à des montants démesurés, pendant que le producteur se coltine tous les problèmes, à une échelle sans rapport. A ce jeu, tout ce qu’accumule l’un se fait au détriment de l’autre, et diverge en valeur,… jusqu’à l’explosion.
Ça met en lumière, mathématiquement, pourquoi le « Théorème de l’équilibre général », qui est statique, ne permet en rien de revendiquer une quelconque « politique optimale » de gestion des sociétés et surtout de leur avenir !
Pour être juste, beaucoup d’économistes (ex: J. Sapir dans « Les trous noirs de l’économie ») le savent plus ou moins confusément, et disent « Pareto-efficient » au lieu de « Pareto-optimal »)
Mais c’est encore trop… Car « efficient », en bon français, ne signifie pas seulement que toute les ressources sont utilisées (la seule chose garantie), mais qu’elles le sont au mieux (au sens de quel critère global?) !
N.B. Comme on sait, depuis Clémenceau, que « la guerre est une chose trop sérieuse pour être laissée aux mains des militaires », de même il faut bel et bien débarrasser l’économie et la finance de ces «pseudo-économistes» du libéralisme, car ils sont devenus une «arme de destruction massive» au service d’une idéologie délétère !
Je me permet moi-même d’ajouter un petit complément d’explication à ce
« petit regret, celui de ne pas y avoir trouvé le renfort d’une argumentation pourtant développée sur ce site… comme article invité: http://www.pauljorion.com/blog/?p=33654« ,
dans cette critique par l’intérieur de la « fausse rationnalité » dans l’ »Optimum de Pareto ».
En effet, on peut trouver sur la « Rationnalité » économique, au chapitre III de « Misère de la pensée économique », la phrase suivante (p. 187):
« L’individu « rationnel » correspondant à cette représentation baptisée homo oeconomicus, a pour particularité de maximiser son utilité subjective dans une ignorance totale de ses concitoyens… la justification… étant qu’il contribue ainsi à maximiser l’utilité pour l’ensemble des gens comme lui, les homines oeconomici. »
Or, « maximiser l’utilité pour l’ensemble des… homines oeconomici » signifierait une utilité globale agrégée, telle que celle indiquée ci-dessus, ce que ne fait pas précisément le prétendu « optimum » de Pareto qui n’en est pas un : c’est un simple équilibre entre maximisations concurrentes, ce qui n’est pas du tout la même chose!
Le fameux dilemme des prisonniers, cité par Marianne, est là pour rappeler qu’en se donnant pour objectif d’optimiser la somme des critères de chacun d’eux, on sort du bloquage conflictuel par une formule qui n’a rien de magique, mais tout du rationnel. C’est en réalité ce que fait l’homme depuis la nuit des temps dans sa cellule familiale: que serait cette cellule si chacun y disputait son intérêt personnel pour la moindre des tâches, sans égard pour l’objectif commun?
La civilisation a certes permis de faire un pas en ce sens, dans le domaine du droit (cf “Le contrat social” de Rousseau), mais pas encore dans le domaine économique où la théorie libérale ne conçoit ce domaine que comme un équilibre qui transpose celui de la lutte pour la vie chez le primitif (du Adam Smith mal assimilé)…
Dans le vaste ensemble anonyme que constitue la société, on ne peut donc se contenter d’en appeler à la confiance ou la bonne volonté de chacun, sauf pour des enjeux minimes.
Aussi, seul un coordonnateur au dessus de la mélée (l’Etat) peut assurer d’optimiser le critère global de l’intérêt général.
C’est pour cette raison que “l’ardente obligation du plan” ainsi que « la participation », toutes deux célébrées par De Gaulle, ne sont pas des lubies de forcenés collectivistes. Sur ce point, en fait, il n’y a jamais eu encore d’expérience véritablement “communiste” dans l’histoire, sauf peut-être chez les grecs de l’antiquité, tant dans leur pratique (démocratie directe) que dans leurs aspirations (Aristophane: “Le gouvernement des femmes”).
Beaucoup de matière à réflexion, mais il y a une référence à Marx
dont je ne saisis pas bien le sens:
Je ne suis pas sûr de comprendre l’enchainement.
Par ailleurs, je ne pense pas que quiconque puisse prendre en compte
les paramètes permettant de prévoir « la véritable fin du système capitaliste ».
Les uns prêtent trop à Marx, d’autres lui demandent l’impossible.
Mieux vaut, comme lui, enquêter sur le monde contemporain,
armé de la méthode matérialiste.
ce passage m’a remis en tête de vieilles lectures qui abondent dans le sens de paul, et de certains philosophes allemands:
Les termes utilisés dans le Vedanta sont adaptés à la perspective d’une recherche spirituelle. Le terme Maya provient du radical ‘Ma’ qui signifie « mesurer », « délimiter ». La Maya est le synonyme du voile de l’Ignorance qui « délimite » la Conscience Pure, lui donne une « dimension » individuelle sous forme d’ego et des divers attributs de l’ego. Le terme Maya signifie aussi l’Illusion, en ce sens que l’existence de la Conscience Pure est constatée sous forme d’ego, lequel est oeuvre illusoire de la Maya.
[La cause substantielle des phénomènes est celle qui se transforme réellement en un effet et apparaît sous un aspect différent de son aspect originel. Exemple : le lait se transforme en yaourt. Une motte d’argile se transforme en cruche. Le Voile de l’Ignorance, Maya, se transforme en ego. Ainsi, une cause substantielle peut être successivement transformée en plusieurs effets.
En ce qui concerne la cause substantielle primordiale, l’origine matérielle de l’univers, elle est éternelle, tout en subissant plusieurs transformations ou des transformations successives (Parinami Nitya). Elle est appelée Maya ou Avidya dans le Vedanta et Prakrti dans le Samkhya (voir l’ouvrage Samkhya Karika.). Elle n’a pas d’existence indépendante. Elle existe grâce à l’existence éternelle de son substratum (Asrya), la Conscience Pure, Brahman.]
lexique vedanta
Pour l’hindou, quand nous nous approchons de Dieu, en lui attribuant des qualités d’omnipotence, d’omniscience, d’amour, de compassion, etc…, nous l’abaissons à notre niveau de conscience, en le rendant personnel. Le dieu personnel ainsi qualifié est dit du nom générique d’Ishvara.
ISHVARA peut être abordé de toutes les manières possibles de notre fantai-sie et inclinations. Ce peut être par ses fonctions, par ses pouvoirs, par ses manifestations, etc… Il en découle qu’il est alors possible de le représenter par toute une multi-tude de formes, d’aspects ou d’images. Chaque Ishvara est personnifié par un nom, des allégories, des légendes, des symboles à formes humaines ou animales.
le concept de dieu
Sur la propriété privée ( mais pas que ) , je verrais bien que ce soit le sujet ( forcément moins abouti ) de la prochaine BD en suite de » la survie de l’espèce » .
Le blog avait entamé ( surtout avec le support de Jean Luce Morlie ,il me semble ) un début de brain storming sur ce thème central .
Les angles d’attaque sont multiples . Les enjeux à décrypter tout autant . « Les » propriétés » , « les gratuités » , de même .
La contrainte lourde , c’est la terre qui sera stérile , aux conditions actuelles , dans moins d’un siècle .
J’espère que l’utopie démocratique fera de » la propriété » son chantier premier pour donner une chance au « réel » de continuer à nous accueillir et y trouver du sens .
Il est de tradition de schématiser que l’on est :
– de gauche , quand on favorise plutôt nos aptitudes à l’empathie , au partage , à la joie et aux » divertissements culturels « , la rebellion
– de droite quand on favorise plutôt nos aptitudes à l’ordre , la règle ,l’obéissance , le droit et le » mérite » .
Si , dans ces conditions , réunir en soi toutes ces aptitudes, c’ était être » du centre » , je serais centriste .Mais pour réunir toutes ces aptitudes , la propriété comme elle va est une contre-indication majeure , par nature .
Si l’on a pu parler d’UMPS , c’est que selon moi , le vrai clivage entre forces conservatrices et forces progressistes se fait et se fera de plus en plus violemmment là :
sur la propriété, sa définition , son rôle , ses interactions , ses limites , ses natures .
Progressistes de tous les pays , unissez vous .
Bien tentant, Juan Nessy.
On peut penser à la coopérative, avec une base locale (style kercoz). On n’a plus un sèche linge chacun, mais un pour N, on ne cuit plus chacun 100g de pâtes dans son coin, on a des canellonis ou des diots qui sont faits dans une sorte de tour de rôle, et on peut travailler l’efficacité énergétique of course (ta lampe 20 W qui est trop forte dans ton couloir est bien pour ma chambre où je n’ai qu’une 10 W).
On peut aussi penser à grande échelle, et ce serait style Linux, grands projets partagés/distribués. Sur ce même plan des techniques numériques « sociales » , des formes hybrides de propriétés et d’utilités collectives se dégagent des ci-devant « App » des smartJoujoux, de quoi faire vomir un Linuxien, mais aussi de quoi préparer un cerveau de 2012 à virer sa cuti dans 5 10 ou 15 ans, il faut donner du temps au temps pour ces choses là.
@Timiota :
Vous m’ avez mal compris …. Les petits producteurs qui actuellement s’ en sortent sont ceux qui sortent des coop… et qui se bougent pour négocier et livrer leur production a l’intermarché du coin …
Il est certain qu’il est possible d’avoir une laverie pour un quartier avec un contrat entretien , autogéré …mais je suis persuadé que l’idéal c’est de laver son linge sale en famille ……un jardin se travaille seul ou en famille et encore …faire participer un gamin c’est a coup de pied au cul … les « jardins partagés , j’ y crois pas trop ….c’est l’ agressivité et la frime qui fait tourner le monde et le « jardins ouvriers de mon enfance »…avaient de la gueule ds le 9..3 …. chacun ses 500m2 , pas trop bien alignés , des haies , des cabanes pas du tout standard qui reflètent la perso /face du proprio …les gens s’y promenaient le dimanche au temps des lilas …ca n’empechait pas la convivialité ..mais elle n’etait pas pré-fabriquée .
Ceux qui veulent decroitre avant que d’etre décrus ont compris que les seuls luxes qui vaillent sont le temps et l’espace .
PS: A mes yeux , la seule forme de communautarisme ( si l’ on excepte le village traditionnel ) c’est le modèle parsonnier …qui a l’avantage de ne pas etre issu d’ un calcul constructiviste , mais qui s’est forgé « naturellement » meme si son origine premiere est une astuce qui évitait la reprise des terres par la noblesse ….
OK, kercoz, je prêche le faux pour savoir le vrai.
Mais votre message laisse souvent l’impression que j’ai donné hâtivement, pour ceux qui font l’erreur de ne pas fouiller.
Vous battre contre ça, c’est un peu Sisyphe…
Suite du commentaire en réponse à Hadrien dont on peut donner une illustration imagée:
On connaît le dilemme des deux prisonniers, qui est si classique pour démontrer l’absurdité conflictuelle des intérêts particuliers que je me contente d’en rappeler les conclusions: soumis par leurs géoliers à un marché de dénonciation et d’argent, dont ils pourraient sortir libres, les deux prisonniers restent en prison en appliquant pourtant chacun la stratégie optimale dictée par la théorie des jeux (rappelons que la théorie des jeux fut originellement développée pour décrire l’économie).
L’explication de ce paradoxe est que chacun des deux prisonniers, n’obéit qu’à l’intérêt individuel: il y a bien une situation où chacun d’eux y gagnerait, mais celui qui se placerait dans cette situation verrait l’autre choisir alors la décision qui lui donne un avantage supplémentaire (pécuniaire). En se fondant sur cette anticipation parfaitement rationnelle, les deux prisonniers restent à la fois pauvres et en prison…
Maintenant, comment on le résout ce pb? D’ailleurs peut-il être résolu… Et surtout qui peut le résoudre?
Pour résoudre ce paradoxe, il n’y a qu’une issue: il suffit que chacun veuille bien optimiser un critère comprenant une part de l’intérêt de l’autre ! (par exemple la somme des deux) Qui peut en prendre l’initiative? Un avocat commun aux deux prisonniers, par exemple…
Impossible, direz-vous, en économie: il faudrait une armée d’avocats médiateurs pour coordonner toutes les transactions !
Pas du tout: il suffit à l’Etat d’édicter des règles adéquates à respecter impérativement (comme en matière de droit).
Prenons le parallèle du droit: à l’époque primitive (avant le néolithique), l’individu isolé n’avait d’autre contrainte que les limites de sa force ou sa ruse. Rien ne lui interdisait de voler son voisin ou même de le tuer, si le butin en valait la peine.
Imaginons un visionnaire de l’époque lui promettant un monde où des règles interdiront un jour aux plus forts ou aux plus malins de se comporter ainsi, mais où ils y gagneront au change par un peuple collaborant à l’agricuture, l’élevage, etc.
L’individu en question lui aurait sans doute rit au nez:
– Non, définitivement, je penche en faveur d’un équilibre (surement pas optimal, on est d’accord, et instable qui plus est) d’intérêts particuliers… Bref, un peuple libre quoi !
C’est exactement la situation du libéral sur tout ce qui lui est proposé… de non-libéral !
« A l’époque primitive (avant le néolithique), l’individu isolé n’avait d’autre contrainte que les limites de sa force ou sa ruse. Rien ne lui interdisait de voler son voisin ou même de le tuer, si le butin en valait la peine. »
Surement pas l’individu, au minimum la famille et rien ne dit que le « grand singe » dont nous descendrions ne vivait pas en groupes plus larges ni que ces groupes n’avaient d’autres rapports que ceux fondés sur la concurrence. Le triomphe du plus fort aux dépend des autres est-il réellement la règle qui favorise le mieux possible le développement d’une espèce?
Je n’y étais pas donc je ne me prononce pas mais conclure sans preuves me semble hasardeux!
Pourquoi ne pas imaginer que c’est une espèce de dinosaures particulièrement douée pour se développer aux dépend des autres qui a causé leur disparition en même temps que la sienne en dévastant la planète 🙂
J’ai dit « l’individu isolé », sous-entendu sans famille, pour simplifier le propos. Il va de soi que ce qui est dit là se transpose à la cellule familiale. Mais n’interprétez pas mes propos à l’envers, et relisez Hadrien, plus haut:
« Le fameux dilemme des prisonniers, cité par Marianne, est là pour rappeler qu’en se donnant pour objectif d’optimiser la somme des critères de chacun d’eux, on sort du bloquage conflictuel par une formule qui n’a rien de magique, mais tout du rationnel. C’est en réalité ce que fait l’homme depuis la nuit des temps dans sa cellule familiale: que serait cette cellule si chacun y disputait son intérêt personnel pour la moindre des tâches, sans égard pour l’objectif commun? »
(C’est aussi le cas dans le règne animal.)
À la question que vous posez: « Le triomphe du plus fort aux dépend des autres est-il réellement la règle qui favorise le mieux possible le développement d’une espèce? », nous n’avons pas eu besoin d’être là pour répondre. Les anthropologues, paléantologues et naturalistes ont répondu depuis longtemps: c’est avec la coopération dans l’agriculture et l’élevage au néolithique que les civilisations sont nées, et que la démographie ainsi sécurisée s’est formidablement accrue jusqu’à nos jours…
Je crains que interprétiez mes propos à l’envers:
« l’individu isolé n’avait d’autre contrainte que les limites de sa force ou sa ruse. Rien ne lui interdisait… » est un constat, et non une garantie de succès, bien au contraire !
Quant à « isolé », cela sous-entend sans famille afin de simplifier le propos.
Relisez donc Hadrien:
« Le fameux dilemme des prisonniers, cité par Marianne, est là pour rappeler qu’en se donnant pour objectif d’optimiser la somme des critères de chacun d’eux, on sort du bloquage conflictuel par une formule qui n’a rien de magique, mais tout du rationnel. C’est en réalité ce que fait l’homme depuis la nuit des temps dans sa cellule familiale: que serait cette cellule si chacun y disputait son intérêt personnel pour la moindre des tâches, sans égard pour l’objectif commun? »
vraiment du grand jorion, merci.
nous avons l’inestimable ‘chance’ de vivre une situation paroxystique. sur cette base libérale mais concrète le bon discours, donc le moins dangereux, sera le plus simplifié. produisons une constitution économique, tout ce qui en dépasse on élague, tous les 30 ans on retouche. à terme, empiriquement les sociétés devraient trouver un équilibre laissant le champs libre à d’autres interprétations.
Nicolas Roberti – Certains préconisent la prohibition de l’héritage. Qu’en pensez-vous ?
De l’autre côté, Anissa Delarue peut compter sur un appartement rue Bonaparte à Paris estimé à 6 millions d’euros (370 m2 à 16 000 euros le m2), une maison à Belle-Île-en-Mer qui vaudrait un peu moins d’un million et demi, et 500 000 euros environ sous forme d’oeuvres d’art, soit un legs qui dépasserait à peine les 8 millions d’euros, bien loin en tout cas des sommes que pourrait toucher Jean. En l’état, Anissa Delarue se retrouverait donc lésée.
Héritage Delarue : son fils mieux servi que sa veuve
en rsa , çà fait combien ?
attends, attends, ça dépend, tu vis en concubinage? elle gagne combien? l’état va pas t’aider comme ça, grand… et encore moins si tu comptes rester avec elle.
heureusement il y a les génies de science po 😉
Au final, l’un des plus beaux échanges qu’on puisse sur le net avoir entre un intellectuel et un journaliste philosophe. Bravo à tous deux pour cette leçon magistrale en quelques paragraphes.
Merci. Tout simplement merci. pour l’intelligence de ce dont vous parlez. Et pour la beauté d’échange pour la vérité d’élégance que vous Paul et Nicolas avaient pu tissé. c’est un grand souffle de liberté. la possibilité de croire encore dans le fruit entre deux personnes qui échangent. Merci
supprimons les avantages acquis, par exemple confisquons le capital
et achetons plein de bonbons
Pour le « gérer » ou pour le détruire ?
Pour ma part, je choisis la destruction….
Bonjour à tous,
Sur la partie de Paul du texte qui mentionne « Autrement dit, que Dieu se révèle non pas comme la cause première qu’on avait imaginé pour se rassurer, mais comme cause finale. », j’avoue être perplexe.
Quels sont les éléments actuels qui nous permettraient de penser que nous évoluons vers une immortalité au sens où l’on pourrait considérer se révéler comme espèce de Dieu, comme cause finale ?
J’ai plutôt l’impression, surtout considérant la situation actuelle de notre espèce, que nous nous en éloignons sur beaucoup de plans.
Merci de votre attention.
C’est ce que je dis plus loin dans l’entretien : comme ça se présente en ce moment, c’est probablement râpé !
Même pas une divinité mineure ???
Mince , la vie ne vaut plus la peine d’être vécue ;
Si j’aurais su , j’aurais ….
Oui, en tant que chrétien, ce genre de théorie me choque. Je trouve ça assez fantaisiste et beaucoup de théologiens auraient sans doute la même réaction que moi. Tout cela n’est pas sérieux.
ça ne l’est effectivement , à mon goût, pas plus que la proposition symétrique , selon laquelle nous » descendons » des dieux .
Les hommes ont créé des dieux
L’inverse reste à prouver
La thèse et l’anti-thèse restent à » prouver » .
@Planchon .
Je pense que P.J. suit la route de Durkheim sur un organicisme de plus en plus évident qui voit se développer la »société » au detriment de l’ individu …meme si le processus semble s’etre emballé :
//// »Entre Dieu et la Société, il faut choisir. […] Ce choix me laisse assez indifférent, car je ne vois dans la divinité que la société transfigurée et pensée symboliquement ».
(Emile Durkheim / 1858 – 1917 / Les formes élémentaires de la vie religieuse) /////
Il est évident qu’en reme de « progres » c’est la société qui évolue ( civilisation et non l’ individu dont les capacités propres ne dépassent pas ceux du paléo ) ….
Les hommes ont créé les dieux et leurs créations se sont retournées contre eux.
Je pense bien évidemment à la religion du Capital (Paul Lafargue).
L’homme, celui qui aurait pu être le dieu vivant et qui est devenu obsolescent par la faute des machines * qu’il a créées.
* Les différentes formes d’ingénierie financière sont de ces machines.
« J’avoue être perplexe… »
Mais non, mais non. Intéressez-vous au principe anthropique en cosmologie et vous comprendrez enfin que lorsque vous faites cuire un œuf, cela a un sens. Autrement dit, ce n’est pas sans raison, même si elle vous échappe. Car on considère généralement, à tort, les choses par le petit bout de la lorgnette, la nôtre. Mais il y a un grand dessein universel qui a voulu que dans la cuisine les couteaux côtoient nécessairement les fourchettes, et les torchons pas les serviettes, qu’il faut plutôt mettre dans la salle de bain. Et si la vie semble ne pas avoir de sens, que tout paraît absurde et illusoire, c’est parce que le vrai sens est ailleurs, derrière les apparences, trompeuses forcément pour le quidam qui confond facilement les vessies et les lanternes. Lorsqu’on sait lire, forcément entre les lignes où il n’y a rien d’écrit, on se rend compte que « Dieu se révèle non pas comme la cause première qu’on avait imaginé pour se rassurer, mais comme cause finale ». C’est tout de suite moins rassurant mais ça tombe au moins sous le sens, même si la réalisation de cette cause finale se fera à la fin des temps, moment où, comme le notait Keynes, tout le monde sera mort pour pouvoir le constater. On se rassure comme on peut.
Cette recherche de la beauté n’est elle pas pleine de signification ?
Ô toi asservi au froid de l’hiver
comme le corbeau
Tu es privé du rossignol,
de la roseraie et du jardin
Écoute ! Si par négligence
tu laisses échapper cet instant
Tu feras bien des recherches,
avec cent yeux et cent flambeaux.
Djalâl ad-Dîn Rûmî
Sur la beauté je n’ai pas encore de certitude .
J’ai longtemps pensé ( et pense encore ) que ce que nous trouvons « spontanément » beau , est en fait sous tendu par le fait que le réel s’identifie soudainement au sens , une sorte d’identification entre le sens enfoui en nous et le sens de l’univers , et que c’est ce qui nous » émeut » ,
A contrario, je trouve spontanément » moche » ce qui ne fait pas « sens » .
Exemple : je peux trouver « beau » un bâtiment agricole , fait de pierres et de tôle ondulée, au milieu d’un pré , car il a un lien avec son support . Alors qu’au même endroit du massif central , une « magnifique » maison normande me hérisse et consterne .
Le beau comme le bon , résulteraient d’ un apprentissage …..aucun vin n’ est « bon » spontanément ….un archaique va le resracher spontanément …pour le beau …un excellent cours sur la notion de paysage , récemment sur Fr Cult.
Sur la beauté et le paysage , Bernard Laget pourrait nous en dire davantage .
Sur » l’apprentisssage » du beau, je suis plus circonspect , et je rapproche pour le dire deux faits :
– la lecture d’Oscar Wilde dont j’ai souvent cité une » pensée » : » la beauté Révèle tout parce qu’elle n’Exprime rien « .
– une promenade déjà ancienne avec l’un de mes petits fils ( 5 ans ) , en montagne , et qui au flanc du chemin s’est tout un coup arrêté en se tournant vers moi pour me dire » c’est beau » …à la seconde où j’allais lui dire » arrêtes toi pour regarder ça ! » .
Pour rester cohérent , j’en conclus que le « sens » ne se « révèle » que dans la beauté .
Oscar Wilde complètait en affirmant ,pour moi trop rapidement :
» La beauté , comme la sagesse , aime l’adorateur solitaire ».
Pourtant , ce jour là , nous étions au moins deux qui , à défaut d’être sages ou d’adorer , nous sommes arrêtés un instant . Au même instant .
@ Juan :
J’ai appris pas mal en écoutant ces 9 cours de Descola ..je les recommande ….ça désenchante un peu notre vision du monde et surtout la vision que l’ on a de sois meme .( Apres un apéro , ça passe) !
http://www.franceculture.fr/emission-l-eloge-du-savoir-les-formes-du-paysage-79-2012-11-21
« Un soir, j’ai assis la Beauté sur mes genoux. – Et je l’ai trouvée amère. – Et je l’ai injuriée. »
Je trouve cette façon de traiter du beau un peu pesante et laide .
Il semble ne s’agir d’ailleurs ici que du » beau » au travers du paysage , qui est effectivement un sujet passionnant , et qui peut désigner le tableau , le site , la vue , voire l’aspect général et le PAF .
Je reste sur l’idée que la beauté , celle qui vous « enivre » moins de dix fois dans une vie, celle qui n’a pas de sexe , d’âge ,de temps , de culture , de lieux , de langue … est celle qui révèle le « sens » ….et le reprend vite , en nous laissant sur notre faim .
@Juan :
Vous pensez réellement qu’il y a du beau et du bon ( dubonnet ?) , objectifs ? , …non culturels ?
Le bon , je ne sais pas , et ça n’était pas mon propos .
Le beau , j’en suis sur .
La culture » c’est le sens critique et rien d’autre » . Et c’est énorme .
Mais pas tant que le beau .
Mr Jorion, je ne sais pas si ça a déjà été mentionné dans les commentaires avant (je réagis avant de les avoir lus pour une fois), mais si vous voulez vous documenter sur les tendances transhumanistes, l’édition de décembre de Pour la Science est un numéro spécial intitulé « l’Homme 2.0 – L’être humain réparé, transformé, augmenté… jusqu’où ? ».
Je ne l’ai pas encore lu en détail, juste survolé dans le train. Suffisamment sérieux pour faire un tour d’horizon rapide je pense !
Ce jour sur le site médiapart.fr, un article de Martine Orange au titre éclairant :
ArcelorMittal : l’échec du modèle Goldman Sachs
Très bon article, qui remet enfin les choses en place. Sur un autre sujet (quoique) voir aussi pour ceux qui ne l’ont raté sur Arte jeudi soir 740 Park Avenue
Oui, super article.
Les journalistes économiques dormaient et omettaient de nous raconter ça… Argh !
http://endehors.net/
« Comment le gouvernement peut-il faire confiance à Mittal, l’homme-lige de Goldman Sachs ? »
Conclusion :
« Aujourd’hui Mittal » doit rembourser plus de 6 milliards d’euros entre 2013 et 2014. Sa dette est désormais classée en junk bonds : les refinancements vont coûter de plus en plus chers. Certaines émissions obligataires sont déjà au-dessus de 9 %. Il a les plus mauvaises performances et la plus mauvaise notation des groupes sidérurgiques mondiaux. »*
C’est avec un pareil crocodile de la finance que le gouvernement « socialiste » conclut un accord. Au pays des aveugles les borgnes sont rois. »
En fait c’est la crise qui cause des problèmes, pas la financiarisation, ou plutôt le cocktail des deux…
==================
London Metal Exchange :
http://www.lme.com/copper_graphs.asp
En des temps plus logiques la question à (se) poser aurait été celle de la mondialisation par et pour le profit et de savoir si une autre mondialisation est possible.
De nos jours, même certains critiques officiels évitent de poser la question ou bottent en touche en expliquant qu’il faudrait, pour résoudre les problèmes économiques et écologiques, une gouvernance mondiale.
Cette gouvernance mondiale existe déjà.
On la reconnaît partout à ses opérations.
Ceux qui font mine de ne pas la reconnaître pour ce qu’elle est sont complices.
Note : les passages en italiques indiquent une certaine forme d’ironie.
P.S. Internet m’apprend ce matin que JLM pourrait être premier ministre d’une coalition « écolosocialiste »
A mon sens, la trame neurolinguistique amène soit à éteindre (ou du moins mettre en sommeil) certains processus biologiques, comme il a été fait avec l’inhibition de la sexualité, soit à en amplifier d’autres comme la violence.
Des considérations naturalistes qui valent ce qu’elles valent, mais au moins ne dépareillent-elles pas trop avec le fond de l’air du temps, réductionnisme oblige. On retrouve la vieille alternative entre les processus en première et ceux en troisième personne. Certes, on essaie de la dépasser de manière à ne pas être réduit à devoir choisir entre s’écouter parler ou s’entendre parler, deux formes par ailleurs possibles du délire.
Néanmoins, si « la conscience est un office d’entérinement des actions et des pensées que l’individu se constate en train de produire », pourquoi faudrait-il qu’il y ait un témoin de tout cela ? De même, pourquoi parler d’un individu, donc d’un agent, si on laisse en même temps entendre qu’il serait le spectateur de choses sur lesquelles il n’a aucune prise puisque « notre degré de liberté (…) est nul ».
Et si « nous ne sommes pas passifs au sens où nous éprouvons véritablement ces situations », où situer le discours qui l’affirme, s’il ne prétend pas être qu’une opinion ? L’ordre du vrai fait-il partie de ces choses qui s’éprouvent et dont nous ignorerions le mode de production ? Mais dans ce cas-là, comment le différencier d’un fantasme, si la distinction a ici un sens ?
Vous avez plein de bonnes questions ( pourriez vous cependant définir le terme » agent » que vous énoncez) .
A défaut de m’être fait une conviction , et sans prétendre que l’argument est démonstratif , j’ai fait moi même une petite prise de tête ( on a le temps en prenant de l’âge) qui tendrait à me faire reconnaitre qu’il m’a bien fallu une quinzaine d’années de recul , pour mes » décisions les plus importantes » , pour comprendre de façon pas trop biaisées les forces et « motivations » qui me les avaient fait prendre , de façon plus « vraisemblable » .
Heureusement , ça n’a pas trop « dévalorisé » mes « choix » de mariage , d’enfants , de vie professionnelle .
En principe , je saurai donc en 2027 la vraie raison pour laquelle j’ai cru bon de vous racontez ça aujourd’hui . Comme je ne serai plus là , il faudra vous passez des mes corrections éventuelles .
« Pourriez vous cependant définir le terme » agent » que vous énoncez »
Un agent est ce ou celui qui agit, et non pas qui subit ou est agi. Dans ce dernier cas, n’étant pas le principe ou l’origine de ses propres actions, il n’y a aucune raison de parler d’agent ou d’individu.
« Il m’a bien fallu une quinzaine d’années de recul »
Le temps ne fait malheureusement rien à l’affaire car, à en croire l’ami Jorion, même si avec le recul « la séquence nous apparaît comme une saga dramatique, relativement passionnante, [elle] n’est que le fruit d’une reconstruction volontariste leurrée dans son rapport à la réalité ». La réflexion vient toujours trop tard et elle est essentiellement illusion de soi. Si nous pouvions nous départir de ce sens trompeur, nous verrions la vraie réalité telle qu’elle est, à savoir la chose en soi.
Merci !
Je m’étais déjà fait à l’idée que je n’étais pas aussi » agent » que je le croyais .
Je vais garder , pour ne pas être trop angoissé , l’illusion que mes 15 ans de recul me donnent cependant une image » moins fausse » de la réalité ….d’il y a 15 ans .
Si par contre , » être agent » est le signe de la citoyenneté , et que ‘ l’agir » est une forme d’illusion , ça donne un sacré chantier pour redéfinir la Démocratie .
La politique devient l’art de marier les « affects » ?
En vue de …?
« Je vais garder , pour ne pas être trop angoissé , l’illusion que mes 15 ans de recul me donnent cependant une image » moins fausse » de la réalité ….d’il y a 15 ans »
C’est là le paradoxe: la réalité telle qu’elle était il y a 15 ans n’est que celle que vous voyez avec vos yeux d’aujourd’hui. Or si vous avez changé depuis ce temps, il est bien évident que vous ne pouvez pas la voir de la même manière. Car pour comparer deux moments de sa vie, il faudrait encore être celui qu’on a été. D’où le perspectivisme, si reposant pour l’esprit. L’existence ne serait qu’une collection illusoirement plus ou moins ordonnée de points de vue sur « soi ». Argument sophistique qui a permis à certains d’affirmer qu’ils n’étaient plus eux-mêmes, tentative pour faire oublier les âneries qu’ils avaient dites la veille.
Mais tout n’est pas perdu, rassurez-vous, car comme le note l’ami Jorion, si toute existence est essentiellement mensonge à « soi » (affirmation par ailleurs contradictoire de tout perspectivisme), il n’empêche que « la présence de l’affect ouvre la voie à une perspective esthétique ». S’il est devenu de nos jours un peu ringard de se juger par rapport aux catégories du vrai et du faux (« je me suis trompé en disant cela »), voire du juste et de l’injuste (« j’ai mal agi en telle occasion »), la perspective promise se place sous le signe du Beau, occasion de moins d’arguties. Ainsi pourra-t-on justifier le fait d’avoir fait quelque chose en disant, selon la situation, qu’on a eu le bon ou le mauvais goût de la faire. Et comme tout le monde sait, « les goûts et les couleurs… ».
@ juan nessy
« La politique devient l’art de marier les « affects » ? »
Vous avez raison de poser la question politique, car une certaine forme de sophistique, contemporaine ou pas, ne l’a jamais considérée différemment, comme art de jouer sur les affects, puisque la question du meilleur régime n’aurait pas de sens. Et si tout est question de goût, il n’y a pas de meilleure raison de préférer la démocratie à la tyrannie.
Surtout, tout relativisme extrapole deux ou trois choses admises par beaucoup, pour en faire une thèse universelle, qui outre son caractère apparemment auto-contradictoire, est par ailleurs inconséquente. On peut sauver le relativisme de la contradiction en reprenant l’idée de Pascal (« il est donc vrai de dire que tout le monde est dans l’illusion », donc même celui qui l’affirme). Mais peut-on le sauver de son inconséquence? Je ne suis pas sûr, car on a vu peu de nos libres penseurs relativistes choisir d’aller vivre en Corée du Nord.
@Boudzi :
Merci de vos repères .
J’espère que l’affect est beau .
Je reste un peu sur ma faim cncernant ce que devrait être la politique ( les Sciences PO ?) selon votre opinion , par » nature » , ou selon vos propres goûts et couleurs .
Il n’y aurait de gouvernement « viable » que « révélé » ? L’histoire en donne déjà de terribles exemples .
Si la démocratie reste , comme je le crois , la seule voie supportable , par quelle qualité propre , dans la marmite des incertitudes dont nous parlons , nous donne -t-elle selon vous , plus d echance de rester sur le chemin de l’accès au beau ?
PS 1 : il faut que je me replonge de façon plus ciblée sur la notion d’affect pour éviter de la « comprendre de travers » . Paul Jorion , un conseil ?
PS 2 : Boudzi comme …. ce que j’imagine ?
Quid des historiens et de leurs traductions des « faits » ?
L’historien est souvent dépeint comme situé à la croisée du narratif , du scientifique et du poltique . Les deux derniers termes sont suspects .
L’algorithmique est-il dans le scientifique ?
En tous cas , j’ai le sentiment de faire oeuvre d’historien, quand je reconstitue » ma vérité » d’il y a 15 ans .
@ juan nessy
La politique n’est pas une science, d’autant qu’elle se définit avant tout par rapport à des valeurs. La remarque sur les goûts et les couleurs était ironique, vu qu’elle visait une forme de relativisme. Les incertitudes dont vous parlez ne sont que l’envers de la certitude que vous désirez ou dues à l’inconsistance de tout système symbolique. Dissonance fait remarquer que toute vérité est relative: mais je crois que l’humanité le sait depuis toujours, sauf qu’elle essaie de se le dissimuler.
L’affirmation de Paul Jorion sur le seul rapport concevable au monde qui pourrait se faire sur un mode esthétique n’a pas beaucoup de sens. D’abord parce qu’un tel rapport présupposerait un minimum d’éducation, sauf à le supposer déjà chez les moules, donc que la question politique soit partiellement résolue: d’autre part, comme pour tout relativisme, elle fait de la question de la vérité une question seconde, voire sans aucun sens, ce qui fait que je ne vois pas comment il serait possible, de son point de vue, de la réfuter, ni quel intérêt elle a, d’ailleurs, de proclamer une assertion qui n’est vraie que pour celui qui l’énonce.
De ce point de vue, comme je ne sais plus qui l’a écrit récemment, si un assassin décide de considérer ses crimes comme beaux, qui en jugera? Et selon quels critères? Surtout si le vrai et le faux, ou le juste et l’injuste, sont comme les goûts et les couleurs…
D’autre part, il me semble qu’il y a bien en histoire, comme dans toute science morale, une dimension narrative, scientifique et politique. Comme il n’y a pas de lois en histoire, on fait le plus souvent usage du récit. C’est une science car c’est une discipline objective. Et elle est politique, car elle n’est pas seulement descriptive/explicative mais normative/prescriptive. Un historien ne se contente jamais de dire ce qui a été mais dit ce qui aurait pu être ou ce qui dû être (si…). Si l’histoire était strictement déterminée, il n’y aurait rien à y comprendre: c’est inversement parce que l’histoire est en partie contingente qu’elle est intelligible.
« En tous cas , j’ai le sentiment de faire oeuvre d’historien, quand je reconstitue » ma vérité » d’il y a 15 ans… » Ne croyez pas tout ce qui s’écrit sur ce blog… 🙂
Quand on est (presque ) d’accord avec moi , il me semble que j’ai tort .
Mais vous n’êtes pas obligé de me croire !
La vérité est une opinion propre à chacun, tandis que la réalité est un principe fondamentalement indiscernable. L’humain raisonnable tente de faire coïncider sa vérité avec la réalité, autant que faire se peut. L’humain déraisonnable quant à lui tente d’imposer sa vérité à la réalité, moyennant toutes sortes de contorsions.
Le vrai n’existe pas fondamentalement: Il n’est qu’une production sociale plus ou moins collective. Par exemple, des dirigeants mondiaux tiennent pour vraies les théories du néolibéralisme. Et ils sont majoritaires. Et pourtant ils se trompent (gravement).
« La vérité est une opinion propre à chacun »
C’est vrai, car « l’homme est la mesure de toute chose ». C’est pourquoi j’ai toujours pensé que 2 + 2 faisait 5, que la révolution de 1789 n’avait jamais eu lieu et que les filles naissaient dans les roses et les garçons dans les choux.
@Boudzi
Et vous pouvez tout à fait le croire, car rien ne vous en empêche, si ce n’est l’opinion contraire de milliards de personnes. Cela dit toutes ces personnes peuvent aussi se tromper… Ce qui résume bien l’idée de réel indiscernable.
Quoi qu’il en soit pour la plupart 2+2=4 est vrai, mais néanmoins quelques matheux ergoterons sur le fait qu’il faille préciser « dans le système décimal », car dans le système booléen le 2 n’a simplement pas le moindre sens, tandis que dans le système hexadécimal, si 2+2 continue d’être égal à 4, en revanche 9+1=A. Bref, votre 2+2=4 est relatif au système dans lequel il est considéré… Comme tout le reste. Ou plus généralement, la vérité est relative au système dans lequel elle est considérée.
@Boudzi :
/// Des considérations naturalistes qui valent ce qu’elles valent, mais au moins ne dépareillent-elles pas trop avec le fond de l’air du temps, réductionnisme oblige. ///
Il me parait curieux d’ accoler le terme « réductionnisme » a « Naturalisme » .
Le naturalisme s’ oppose , a mon sens , a la « raison » et au constructivisme …..a qui reviennent plutot ce qualificatif .
Rechercher le modele Naturaliste c’est , toujours a mon sens , justement refuser le réductionnisme de la « raison » et vouloir retrouver la « vertu » de la modélisation complexe ( au sens math/equa diff) des outils naturels en usage ds ts les systèmes naturels .
Ceci dit cette modélisation » naturaliste » se revendique de la th. du Chaos …qui , a mon sens, est déterministe tout en laissant un certain degré de liberté ( sur l’ attracteur) …..ce qui évite le desespoir .
( ps , au modo : plusieurs de mes interventions ont ete supprimées ….ni insultante , ni agressives ?,mauvaises manip de ma part ? )
Le naturalisme est généralement un réductionnisme, vu qu’il affirme qu’il n’existe que des faits ou des êtres « naturels ». C’est pourquoi les faits sociaux ou moraux doivent-ils, en principe, pouvoir être réduits à des faits biologiques.
En un sens, comme vous le notez, il s’oppose au rationalisme, puisque pour le naturalisme il y a « continuité entre psychologie cognitive et épistémologie » (Nef) alors qu’il y a autonomie de l’épistémologie pour le second du fait de son caractère normatif, et au constructivisme ou constructionnisme, pour lequel la « réalité » est une institution, à savoir une convention, ou une construction sociale.
D’autre part, « réductionnisme » s’emploie généralement pour qualifier, d’un point de vue ontologique, les doctrines pour lesquelles il n’existe qu’un type d’êtres, auxquels en principe tout est réductible, les êtres naturels pour le naturalisme, la « matière » pour le matérialisme. On pourrait en effet aussi l’employer, s’il est pris au sens de « réducteur », pour qualifier des doctrines de type idéaliste, en faisant valoir qu’elle réduise la réalité à n’être qu’une représentation.
@Boudzi :
/// On pourrait en effet aussi l’employer, s’il est pris au sens de « réducteur », pour qualifier des doctrines de type idéaliste, en faisant valoir qu’elle réduise la réalité à n’être qu’une représentation. ///
Je n’ ai pas votre science, mais réducteur me va , …et je dirai que j’emploie reducteur dans le sens mathématique…… Un peu comme le fait Prigogine qd il défend les systèmes chaotiques dont il ne faut pas refuser la complexité en simplifiant la modélisation ( en refusant les equa diff) .
L’ avantage des systèmes complexes (naturels ) c’est que leurs solutions , meme si elles ne sont pas analysables , aboutissent a des situations stables ( attracteurs).
L’ homme , jusqu’ici , infoutu de gérer des modèles complexes les a élagués, simplifiés et transformé en equa linéaires qui lui sont accessibles mais qui divergent au premier courrant d’ air …les rétroations improvisées ne faisant qu’induire la prochaine sortie de route …
Le « naturalisme » est pour moi , respecter les variables majeures du système naturel humain …du moins essayer d’en copier les outils …….Une des variables essentielles etant l’ affect qui est sensé gérer la hierarchisation du groupe ( en inhibant l’ agressivité intra-spé de Lorenz) ……..ce processus a mis des millions d’années a formater ET l’ individu ET son groupe et l’ on peut présumer une certaine rigidité comportementale transhitorique si l’ on ne veut pas trop s’écarter de l’ optimisation de l’ individu ….
Cet axiome etant posé la taille du groupe conditionne les possibilités d’affect ….la centaine d’individus selon les antropo etant un maximum ……J’ en déduis logiquement , comme le fait l’ ensemble des systèmes vivants , que la structure des groupes doit etre morcelée …groupe de groupes et jamais centralisée , hypertrophiée comme on le fait actuellement …ce qui revient a isoler l’ individu , quiessaie de reformer des groupes par affinité et non par unité de lieu ..processus dangereux car l’ agressivité qui peut se reguler localement va etre boostée ds ce modèle stratifié………. Notre problème est structurel et non ideologique …c’est le constructivisme qu’il faut éviter ……..Tout gain de productivité est une perte d’ humanité ( Jhonny Halliday)
Pardonnez la longueur …j’espere avoir eclairé mon point de vue sur l’ oxymore naturalisme reductionnisme .
« Dans ce cadre, cette fenêtre de la conscience a pour seule finalité la survie… »
Soit la conscience est prise au sens de conscience de soi, et n’apparaissant qu’assez tard, il serait assez paradoxal d’affirmer qu’elle a pour finalité d’assurer la survie de l’individu. Soit la conscience est prise au sens plus général de psyché, et dans ce cas-là, il faudrait encore expliquer les cas d’anorexie du nouveau-né, le suicide, la dépression, la mélancolie, le fanatisme, etc., toute ces choses qui contrarient toutes les vues reposantes concernant l’humanité.
Définir la conscience par la conscience est un peu insuffisant , même si nous y sommes sans doute misérablement réduits .
Pour la psyché , je croyais qu’elle recouvrait aussi bien la conscience que l’inconscient et que cette » création » arrangeait bien Freud et Young . Artifice systémique ?
J’ai un peu rajeuni Jung !
La fatigue à l’approche de minuit .
« Définir la conscience par la conscience est un peu insuffisant »
C’est surtout un peu tautologique. C’est pourquoi je l’ai d’abord définie comme conscience de soi, connaissance ou intuition de l’esprit par lui-même. Je l’ai ensuite définie comme psyché, entendant par là aussi bien la conscience au sens étroit que l’inconscient, raison pour laquelle j’ai donné comme exemple le cas de l’anorexie chez certains nouveau-nés.
L’argument de l’artefact a comme présupposé métaphysique un idéalisme absolu. Mais on ne peut pas donner forme à quelque chose qui n’aurait absolument aucune forme. Autrement dit, qu’on pense ce qu’on veut de la théorie de Freud, si le délire est la théorie d’un seul, la théorie n’est certainement pas le délire de plusieurs.
///// Autrement dit, qu’on pense ce qu’on veut de la théorie de Freud, si le délire est la théorie d’un seul, la théorie n’est certainement pas le délire de plusieurs. /////
Toujours Bourdieu , qui l’ aurait piqué a Marx : …. théoriser serait manipuler ….au sens de l’ onanisme …… « » »La philosophie est a la réalité ce que l’onanisme est a l’ amour physique » »
Je crains bien être un idéaliste absolu .
Sur votre dernière phrase , au delà de son balancement séduisant , je n’en ferais pas une vérité à défaut d’une réalité . En tous cas , pas une « évidence » .
« [La conscience] permet d’enregistrer en mémoire les réactions les plus adaptées à des situations potentiellement gratifiantes ou dangereuses… »
Je ne sais pas, pour ma part, s’il y a des situations gratifiantes pour les mouches à merde ou si un âne est heureux d’être reconnu par les siens. Étonnamment, les vaches, pourtant vouées à l’abattoir, ou à une mort certaine depuis des centaines d’années, n’ont développé aucun conscience de leur condition qui leur aurait peut-être permis d’y échapper.
Naturalisme, tu es si beau et tes signifiants sont tellement absurdes ! pour paraphraser l’ami Castoriadis.
J’ai tapé » conscience d’un âne » et j’ai trouvé ça , d’un certain Norbert Crouton :
http://books.google.fr/books?id=4Ye_RwMPqHsC&pg=PA38&lpg=PA38&dq=conscience+d'un+%C3%A2ne&source=bl&ots=5UaNaB_z6p&sig=0oRdL4RHKYtY4c_U1sm4t9WTMbk&hl=fr&sa=X&ei=9Yu6UKKfLsO80QXL7YDADQ&sqi=2&ved=0CE4Q6AEwBg#v=onepage&q=conscience%20d'un%20%C3%A2ne&f=false
Mais , à mon petit niveau , il me semble que j’ai bel et bien pu constater chez les animaux quelque chose qui ressemble à la mémoire ( le plus souvent « innée » , mais parfois localement adaptée ) de faits agréables ( l’odeur de la merde pour les mouches , la silhouette d’un fermier violent ou qui au contraire apporte la bouffe pour un âne , le jappement d’un chien redouté non visible -à un kilomètre pour des vaches qui ne manisfestent d’inquiètude que pour ce jappement là ).Ils n’ont par contre pas manifesté assez de conscience pour m’en faire part eux mêmes .
Il m’a fallu une analyse participante pour le distinguer , et je crois que l’on peut extrapoler au monde animal , au moins .
» agréables …ou désagréables … »
J’ai pris « gratifiant » au sens de valorisant, et pas seulement au sens d’agréable ou qui satisfait. J’ai voulu signifier qu’il y a nombre de choses qui sont pour l’espèce humaine gratifiantes mais qui n’ont aucun sens d’un point de vue biologique: être un bon chrétien, le respect dû aux anciens, accumuler des richesses, se sacrifier pour la patrie, etc.
Après je ne doute pas qu’il existe très vraisemblablement quelque chose comme la mémoire chez nombre d’animaux, voire une forme de proto-conscience chez certains. Cependant, il n’y a pas chez l’homme de mémoire, ni de conscience, sans mots, donc sans langage.
Je comprends .
Je me suis de mon côté mouillé d’assèner que le langage humain était de la même nature que tous les langages , et que tous étaient sous tendus par le » langage » de la matière ( du plus petit au plus « complexe » et inter-relations entre les « constructions « successives) .
Dans mon mécano , il n’y a pas de mots et de mémoire distincts par » essence » : ils sont faits des mêmes « constituants » de base . Ce n’est pas la mémoire et le langage qui différencient l’homme des autres organismes plus ou moins vivants . C’est la capacité de son cerveau ( neocortex) de mettre en relation des images , elles mêmes filles de plusieurs langages , et d’en « créer » de nouvelles .
Qu’il exprime par le langage qu’il peut .
« Norbert Croûton, l’auteur de l’essai « Incroyants, encore un effort…» est ingénieur de profession et philosophe d’inclination… »
Personne n’est parfait, surtout lorsqu’on suit son instinct ou son inclination. Car affirmer que « le monde physique est logique », c’est oublier que lorsqu’on s’est rendu compte que la lumière était et ondulatoire et corpusculaire, cela est apparu contradictoire. Il faut donc croire que s’il a une logique, ce n’est pas la nôtre.
Cependant, pour répondre à votre remarque, et à supposer que « le langage humain [soit] de la même nature que tous les langages », il n’en reste pas moins que tous les autres langages seront toujours dits dans ou par le moyen du langage humain, langage qui a ses propres catégories, ses structures grammaticales, ses significations instituées, etc. De plus, on ne s’exprime jamais dans un langage humain en général, mais dans et par tel langage particulier.
Quant aux « explications » de Norbert Croûton, elles sont proprement délirantes. Comme il n’en sait rien ou ne sait pas de quoi il parle, il brode. Car si vous ouvrez un cerveau, vous trouverez peut-être des neurones, mais certainement pas des concepts. Un concept ou une idée ne s’observent pas au microscope, comme le savait déjà Descartes, raison pour laquelle la substance pensante est selon lui inétendue.
Rassurez vous , je ne connaissais pas Norbert Crouton et n’en fais pas la promotion ; Il n’est que le résultat d’une recherche » conscience d’un âne » et vous avez eu plus de patience que moi à le lire !
Sur le langage humain qui a ses propres …. (jusqu’à significations exclus ) , je conteste le » propre » , car les » architectures » d’ensemble ( y compris celle des langages) répondent selon moi aux mêmes règles générales de construction que l’architecture de la matière.
Pour la « signification » , par contre, je sèche : pour le moment je m’abrite derrière le beau et le néocortex !
« La séquence nous apparaît comme une saga dramatique, relativement passionnante, mais n’est que le fruit d’une reconstruction volontariste leurrée dans son rapport à la réalité… »
Il faudrait déjà, pour tenir ce genre de propos, pouvoir se situer hors la réalité et ainsi, si cela a un sens, la considérer en la comparant à ce qui est dit d’elle. Dit autrement, il aurait fallu dire au préalable ce qu’était la réalité avant de dire qu’il existerait une « reconstruction » de celle-ci. Il ne peut y avoir de reconstruction imaginaire de la réalité que si elle est déjà donnée. Mais à qui et comment ? A l’archetypus intellectus qui la verrait telle qu’elle est et sur laquelle chacun projetterait ses désirs, ses fantasmes ou son idéologie ? Or comme on n’y a pas accès, on n’est pas plus avancé. Le problème est donc insoluble, surtout parce qu’il est mal posé.
Comme le disait déjà Pascal, « il est donc vrai de dire que tout le monde est dans l’illusion car, encore que les opinions du peuple soient saines, elles ne sont pas dans sa tête, car il pense que la vérité est où elle n’est pas. La vérité est bien dans leurs opinions, mais non pas au point où ils se figurent. Ainsi il est vrai qu’il faut honorer les gentilshommes, mais non pas parce que la naissance est un avantage effectif, etc. ». Est-ce à dire qu’il y aurait des degré dans l’illusion et que certains en seraient sortis ? Ou est-ce plutôt à dire, comme le souligne l’ami Descombes, que « quelques-uns sont deux fois dans l’erreur puisqu’ils y sont comme tout le monde et qu’ils se flattent de n’y être point ? ».
On résout le problème en affirmant qu’il y a une différence de nature, sans jamais nous expliquer comment x ou y est sorti de la caverne. Et serait-on sorti de la caverne, que ce sera toujours ses pseudo-évidences qu’il faudra expliquer. Autrement dit, on ne sort jamais de la caverne, malgré les dénégations, et toutes choses égales par ailleurs.
C’est y pas Bourdieu qui dit qu’il y a de l’objectivité dans la subjectivité…qui participerait a la subjectivation de l’ objectivité ?
//// « La séquence nous apparaît comme une saga dramatique, relativement passionnante, mais n’est que le fruit d’une reconstruction volontariste leurrée dans son rapport à la réalité… »
Il faudrait déjà, pour tenir ce genre de propos, pouvoir se situer hors la réalité /////
Comme on ne peut sortir d’ une aliénation que pour entrer dans une autre, …il n’est pas besoin de se placer en position de « vérité » pour douter de la réalité .
/// Autrement dit, on ne sort jamais de la caverne, malgré les dénégations, et toutes choses égales par ailleurs. ///
Le fait est qu’on ne sort de la caverne que pour constater qu’on entre dans une autre …plus grande … Le problème n’etant pas l’ accès aux vérités acquises , mais le désenchantement du monde que cette acquisition vous fait payer.
« C’est y pas Bourdieu qui dit qu’il y a de l’objectivité dans la subjectivité…qui participerait a la subjectivation de l’ objectivité ? »
Possible, mais un autre avant lui avait déjà dit que « le bon sens est la chose du monde la mieux partagée ». Quant à la subjectivation de l’objectivité, il ne faut pas qu’elle soit trop poussée, au risque de perdre toute son objectivité.
Par contre, on la creuse !
On n’a encore pas fait mieux que Blaise Pascal .
Qui n’a pas eu le temps de vivre assez vieux pour trahir ses propres fulgurances .
La caverne est peut être une fausse bonne simplification .
Lors de l’émission 3D de Stéphane Paoli , sur France Inter aujourd’hui , deux parties en échos directs des sujets qui agitent ce Blog ( c’est très rassurant de sentir monter un bouillonnement autour des questions qui en sont vraiment ) :
– en première partie Misha Gromov » Introduction aux mystères » . (presque un écho aux billets sur l’intelligence artificielle , la conscience , l’absurde , les mathématiques…
– en deuxième partie Marie Pierre de Surville et Johann Chapoutot autour de la question de désir de savoir(s) .( presque un écho aux débats générés par le billet sur Scinces Po , sur la culture et l’esprit critique ) .
L’espoir renaît .
Oui d’ailleurs j’ai lu quelque chose sur le désir de savoir, en psychanalyse, probablement de Dorey (prof) … mais je n’en ai gardé aucun souvenir, probablement à cause du désir d’oubli.
Ecrire suppose … euh, peindre, avec des mots, si l’on pouvait, comme Debussy avec des notes. Le peintre a d’emblée l’idée d’un accord de couleurs, suppose donc que le détail reflète la totalité ;
Je crains que cette crise ne déclenche une apoptose générale parce qu’elle écrase la possibilité de penser : Chacun ne fait que bander son arc pour viser le centre d’une cible, sans égard au contexte…. Il faut étudier la philosophie zen du tir à l’arc, le seul guerrier qui soit aussi un artiste.
Je ne sais pas si la paranoia est une muse recommandable. Ne pas faire de sa vie une oeuvre d’art comme le pensaient les surréalistes (les dandy ?), mais de la société.
Le sujet était plutôt la façon de répondre à cette « appétence » , que les français placeraient tout de suite après la famille et bien avant le travail .
Au début de l’interview, on en revient encore à cette découverte paradoxale qui veut que l’acte précède la conscience et dont on avait longuement parlé dans le billet NOTRE CERVEAU CONSCIENCE ET VOLONTÉ du 7 avril 2012.
Après réflexion cela m’apparaît comme tout à fait normal que l’acte soit exécuté par notre corps et apparaît ensuite à notre conscience, 5 dixièmes de secondes plus tard. Autrement dit, ce n’est pas notre conscience, notre volonté, qui décide mais notre corps.
En effet, dans l’histoire de la vie, le système nerveux est apparu bien avant la conscience ou le langage. Or le cerveau a toujours dirigé, donc il peut, et doit être capable de diriger sans la conscience. Ce qu’apporte la conscience, le langage (peut-on avoir de conscience sans langage ?), c’est que l’acte en plus de s’exécuter dans le monde réel s’exécute aussi dans notre imagination, un monde simplifié, codifié par le langage. Comme le langage est structuré par la grammaire avec ses sujets, objets, verbes,… c’est un monde où domine la causalité et la finalité. C’est pourquoi l’homme cherche toujours une finalité et une causalité à ce qui lui apparaît. Ce monde de notre imagination influe ensuite sur notre inconscient car il est pour lui un second monde, simplifié, formalisé dans lequel il doit aussi survivre.
On retrouve le fait que notre conscience est spectatrice et non pas actrice de nos décisions, dans les IRM du cerveaux où l’on voit que ce sont les mêmes zones qui s’activent quand on fait un geste ou quand on voit ce même geste fait par un autre. Puisqu’elle est spectatrice, il n’y a donc en fait aucune différence pour elle entre un acte d’autrui et un acte de nous-même.
Comme notre conscience doit être un reflet le plus fidèle possible de la réalité (pour que nous puissions survivre, car l’homme est un animal chétif), alors ce reflet est d’autant meilleur que la conscience de l’évènement se produit en même temps que l’évènement-même. En fait 5 dixième de seconde plus tard, mais on a l’illusion de la simultanéité, ou plutôt de la causalité de la conscience sur l’acte.
Pour reprendre l’anecdote d’un médecin suisse qui en mesurant le poids d’un mourant juste avant et juste après le trépas en déduisit la masse de l’âme, je dirais que ces 5 dixièmes de seconde sont la preuve scientifique de l’inconscient freudien, où l’inconscient freudien est cette partie du cerveau qui décide avant et à la place de la conscience.
Sur le thème « l’homme entre libre arbitre et déterminisme », voici quelques textes :
http://www.cci.fr/web/universite-des-cci/libre-arbitre-et-determinisme
J’ai, bien sur, suivi avec pas mal d’autres les passionnantes émissions de JC Ameisen sur France Inter qui » partenarise » un de ses bouquins actuellement .
Ce qui m’agite est en accord avec ses écrits .
Pour répondre à la question, « existe-t-il un libre arbitre ? » Paul Jorion s’appuie ce que serait la conscience, c’est-à-dire un simple « office d’entérinement des actions et des pensées que l’individu se constate en train de produire ». Si en effet la conscience ne se limitait qu’à ce seul office et n’incluait rien d’autre, il faudrait nécessairement en conclure avec lui que le libre arbitre est un leurre.
Reste à vérifier toutefois s’il existe au sein même de la conscience, une activité qui ne se limiterait pas à être une simple chambre d’entérinement d’actions constatées, fruits d’un déterminisme implacable, mais s’il pourrait y exister, ne serait-ce que par moments, une activité AUTO-déterminée, c’est-à-dire une activité entièrement fondée sur elle-même (qui serait en elle-même sa PROPRE CAUSE).
Pour répondre à cette question et effectuer cette vérification, il serait nécessaire d’entreprendre une observation très rigoureuse et sans a priori des phénomènes apparaissant dans la conscience.
Or, celui qui entreprend une telle recherche, commence à différencier entre différents types de pensées, qui s’échelonnent notamment de la pensée « automatique-associative-mécanique » à un extrême, jusqu’au « penser pur » à l’autre extrême. Cette dernière activité n’apparaît jamais comme le résultat d’un quelconque déterminisme extérieur; le contenu auquel elle accède n’est pas non plus tributaire de l’hérédité, de la culture, de la formation ni même de l’histoire personnelle du penseur. Par le « penser pur » nous accédons aux « concepts purs » de toute chose (les concepts purement abstraits – par exemple le concept pur de chaise, de tuyau, de baleine, etc.). Le contenu conceptuel (totalement abstrait) auquel l’être humain accède par le « penser pur » ne le détermine en rien (par exemple, penser « purement » le concept de colère ne provoque pas de colère en moi et ne me détermine pas (au contraire, ce concept n’a pu apparaître dans ma conscience sous sa forme la plus abstraite que dans la mesure où je l’ai d’abord très activement pensé) ; il en est autrement si j’éprouve de la colère ou que je me représente de manière imagée une scène qui suscite de la colère en moi ; cette colère me détermine ensuite dans une certaine direction quant à mon comportement, quant à ce que je ressens et ce qui vit dans ma conscience).
Je ne fais qu’esquisser ici très très grossièrement une direction de recherche.
J’ajoute qu’il est complètement faux de prétendre que le cerveau produit la pensée à la manière avec laquelle le foie produit la bile… car pour étayer une telle affirmation il faudrait tout d’abord non seulement observer le cerveau et son activité (ce que réalise la science actuelle) mais AUSSI l’activité du penser lui-même et ENSUITE SEULEMENT il serait possible d’établir un éventuel lien de cause à effet. Or, cette dernière observation n’est jamais réalisée par les scientifiques (pour diverses raisons que je ne développerai pas ici) à l’exception relativement récente d’une équipe du CNRS en France, notamment ; on ne fait qu’inférer des processus cognitifs chez des personnes dont on observe le comportement extérieur sans jamais vraiment porter son observation et s’intéresser à l’activité pensante elle-même telle qu’elle peut être directement observée. Celle-ci ne peut d’ailleurs jamais n’être que la sienne propre.
Bref, on a jamais « vu » un cerveau produire une quelconque pensée ! (ce que Jean-Pierre Changeux, un des papes du matérialisme moderne a lui-même publiquement reconnu lors d’un colloque à la Sorbonne en 1996 – Ceci étant à mettre à l’honneur de son honnêteté intellectuelle).
Les écrits et conceptions de Jorion, dont j’apprécie énormément bien des aspects (de même que l’homme), lorsqu’ils portent sur des questions relatives à la conscience, en restent hélas à la mythologie ultra-répandue du « cerveau qui produit la pensée ». Cette mythologie répétée partout et toujours n’a aucun fondement empirique !!!!!
Tant qu’on en reste à ce stade de préjugé, tant que n’est pas entreprise une OBSERVATION du PHÉNOMÈNE que constitue le penser (et non pas un discours exprimant les représentations que nous nous forgeons au sujet de la pensée), il est impossible de se prononcer sur sa nature, notamment sur son caractère d’activité soit déterminée par une cause extérieure à elle-même, soit déterminée par elle-même. Il faut cesser de bavarder… mais passer à une observation SÉRIEUSE… tel est le discours que je voudrais tenir à Paul Jorion (et à des dizaines ou centaines de millions d’êtres humains qui « pensent » comme lui, ou plutôt qui ne pensent pas et n’observent pas suffisamment activement le penser lui-même). Après il sera possible pour ces personnes de se prononcer sur la possibilité d’existence ou non du libre arbitre.
Les morts pensent ils ? Ont ils un libre arbitre ?
Sur déterminisme et libre arbitre , je préfère écouter des neuro biologistes et des physiciens .
Ils me disent ( et je m’y retrouve ) que les lois de la physique laissent la place au hasard ou aux réponses non « prédéterminées » .
@ Juan Nessy
Thom: « Les situations dynamiques qui régissent les phénomènes naturels sont fondamentalement les mêmes que celles qui régissent l’évolution de l’homme et des sociétés; ainsi l’usage de vocables anthropomorphes en Physique est foncièrement justifié. »
En clair, pour Thom, on ne commencera à comprendre la Physique que le jour où l’on commencera à comprendre le vivant…
@juan nessy et BasicRabbit
Voici un très bon article de Joëlle Proust, philosophe cognitiviste : « Les mécanismes de la volonté »
http://www.scienceshumaines.com/les-mecanismes-de-la-volonte_fr_14822.html
« Des recherches récentes sur les mécanismes psychologiques de la décision montrent que la volonté d’agir n’est pas ce qui donne l’impulsion à une action, mais qu’elle intervient au niveau de son contrôle, de son orientation et de sa correction. »
Ce qui remet en cause la théorie de Benjamin Libet, reprise par Paul Jorion.
@Sardon :
Merci du lien très intéressant .
La « remise en cause » me semble plutôt corriger et pousser le mystère un cran plus loin .
Mais toujours dans le néocortex .
Ma vague intution est que la pensée et le libre arbitre, ont quelque chose à voir avec la masse et surtout le temps de qui l’on pense .
Pour la « responsabilité » , c’est la sanction des échecs dans les multiples options du possible. La refuser c’est condamner soi et autrui à mort .
@ Sardon
Merci également mais ce n’est pas ma partie: ma (dé)formation initiale est mathématique.
Parle-t-on parce qu’on pense ou pense-t-on parce que l’on parle? Il me semble avoir compris de « Principes des systèmes intelligents » que PJ est plutôt pour la deuxième solution.
Agit-on avant de penser ou pense-t-on avant d’agir? Il y a bien entendu des cas réflexes ou l’on agit avant de penser (et même sans doute sans penser). Matheux oblige ça me fait penser à la correspondance preuve/programme (Curry/Howard) en logique formelle/informatique. Exécute-ton un programme avant de le justifier par une preuve ou l’inverse?
Dans cette correspondance le premier théorème d’incomplétude de Gödel correspond à un programme de réparation de fichier, programme de réparation qui fait penser aux processus biologiques de réparation de l’ADN. L’analogie est ama trop belle pour être fausse!
Pour rester à la fois dans le créneau matheux et dans l’opposition liberté/déterminisme, je me suis éloigné des modèles formels en logique (Boole, Tarski, Gödel, etc.), modèles déterministes qui respectent le principe de raison suffisante de Leibniz, et des modèles quantitatifs des physiciens qui, eux, respectent le principe voisin de Curie, également déterministe, où les symétries des causes se retrouvent dans les effets), pour les modèles topologiques de Thom qui, eux, ne sont pas déterministes (ces modèles acceptent des brisures de symétrie grâce auxquelles l’homme peut glisser sa liberté).
Pour terminer je reviens sur le (deuxième cette fois) théorème d’incomplétude de Gödel. Est-ce parce qu’il y a incomplétude (donc indéterminisme) que PJ s’applique à le dézinguer? Thom est plus positif à ce sujet: « Les axiomes de l’arithmétique forment, c’est bien connu, un système incomplet. C’est là un fait heureux car il permet d’espérer qu’un grand nombre de phénomènes structurellement indéterminés et informalisables pourront néanmoins admettre un modèle mathématique. »
Nicolas Roberti: « Pour aller directement au cœur du propos, existe-t-il un libre-arbitre? »
Paul Jorion: « Je ne pense pas. »
Thom: « On doit donc en principe postuler le déterminisme mais garder présente à l’esprit sa nature essentiellement multiforme et scindée. Ce qui finalement importe c’est d’élucider cette structure car il en dérive des lacunes dans l’écoulement causal des processus où l’homme peut glisser sa liberté. » Actualité du déterminisme, Apologie du logos.
Nicolas Roberti: « Suggérez-vous qu’une fois écartée l’acception de Dieu comme cause efficiente, Dieu pourrait se révéler une forme de projection, comme une « post-construction » qui constituerait un nouveau stade de l’humanité? »
Paul Jorion: « C’est cela ».
Thom: « Mais la formule d’Aristote [premier selon la nature, dernier selon la génération] suggère une réponse théologiquement étrange: peut-être Dieu n’existera-t-il pleinement qu’une fois Sa création achevée. » Esquisse d’une sémiophysique.
Suite
Pour Thom l’aporie fondamentale des mathématiques est l’aporie discret/continu. Et, rajoute-t-il, cette aporie domine en même temps toute la pensée.
Pour lui c’est le continu qui précède ontologiquement le discret. Il le justifie en particulier par le fait que c’est par le continu que l’on arrive à résoudre le paradoxe des Eléates (Achille et la tortue).
Toujours selon lui l’aporie fondamentale de la psychologie est l’aporie déterminisme/libre arbitre, dont il est question dans ce billet. PJ semble donc faire en psychologie un choix analogue (en plus radical) à celui que Thom fait en math. Au pif je vois le déterminisme du côté du continu et le libre-arbitre du côté du discret (les algébristes parlent de monoïde libre, de groupe libre, les matheux ont le concept de variable à laquelle ils peuvent attribuer une valeur suivant leur libre choix, etc.). Je pensais naïvement que l’aporie fondamentale de la linguistique était l’aporie signifiant/signifié (ce qui m’aurait gêné dans ma compréhension des « Principes des systèmes intelligents » car pour moi le signifiant est du côté du discret et le signifié du côté du continu). Mais pour Thom « la linguistique est aporétique car elle rencontre une difficulté liée à l’auto-référence: le langage ne peut exprimer son propre fondement. C’est la même difficulté qui mine la psychologie: le Moi ne peut se prendre pour objet d’un savoir. »
Ah, c’est passionnant !
Dommage que je n’ai guère plus de temps pour lire tout ça, sérieusement.
Mais, toujours autour de l’aporie, ce que je ressens aussi :
C’est Quid de l’aporie du politique dans sa fuite dans le tout social ?
Soit, la politique actuelle dans son embarras et face aux difficultés croissantes de pouvoir «agir» dans un monde de plus en plus complexe… semble se contraindre et de plus en plus, à ne plus mener que des combats à caractère social, se heurtant ainsi aux contractions et autres significations sociétales en développement, du «don» dans nos sociétés occidentales.
En effet, le don est en contraction par son mode d’action avec celui de nos sociétés qui ne se consolent et ne veulent se consolider de plus en plus, que sur un « mur d’argent » (le don obligeant celui qui reçoit, de ne pouvoir se « libérer » que par un autre don en échange – Selon Mauss, le don est essentiel dans la société humaine et comporte trois phases : l’obligation de donner, l’obligation de recevoir et l’obligation de rendre.) – Cet éclairage sur cette aporie politique croissante devrait nous mettre en garde, comme signe révélateur, d’une fin de civilisation (bourgeoise) ne sachant plus comment gérer cette autre et étrange pratique humaine montrée comme « primitive», qu’est le don. Le fait social du don, de sa créativité croissante, via la générosité et autres faits solidaires, serait-il devenu trop complexe aussi à anticiper pour notre civilisation marchande vieillissante ? Un autre saut qualitatif civilisationnel serait-il en marche ? Irions-nous vers une autre réalité plus nette, plus complète, plus consciente, plus totale, d’homme total en devenir ?…Aporie contre Utopie ?
@Mennon , mais non !
Le « Don » ne fonctionne que lorsque les acteurs se reconnaissent et pout etre reconnu , il faut etre « connu » , donc ça ne fonctionne que ds un groupe restreint societalement contraint a de fortes interactions ( sans échapatoirs ou chagement de pseudo…) ces « feed back » régulateurs et inhibiteurs de l’ Ubris doivent se faire au plus pres des cellules de bases et non comme les constructivismes le souhaiteraient a des stades plus élevés de la société ….
Bain en tous cas, vous, Kercoôôz –
vous êtes unique et / ou méritez à être « connu »,
(pseudo ou pas pseudo). Sincères Salutations !
@ MEMNOM et Kercoz
A propos du don chez Thom.
il y a une hiérarchie dans les sept catastrophes élémentaires. Métaphoriquement cela donne ceci:
0: Parabole y=x2 associée au verbe être: Basic dans le ventre de sa mère.
1: Catastrophe Pli: naissance de Basic.
2: Catastrophe Fronce: Basic mange des feuilles de salade (alias struggle for life).
3: Catastrophe Queue d’aronde: Basic fait son terrier.
4: Catastrophe Papillon: Basic donne une carotte à une jolie lapine.
5, 6, 7: Catastrophes ombilics: interdites aux moins de 16 ans.
Pour Thom il y a analogie entre différentiation des fonctions (qui conduit à la classification ci-dessus) et la différenciation cellulaire en biologie. Et plus généralement il y a analogies entre les situations dynamiques qui régissent les différentes morphogénèses, qu’elles soient biologique, linguistique, psychique, sociétale, physique.
Selon cette classification nous vivons sous le joug anglo-saxon du Struggle for life: 2.
Quelques progrès à faire avant d’atteindre la note 4 ama minimale pour une vie en société supportable… En attendant le fédéralisme qui, peut-être, nécessitera de comprendre la signification des ombilics (on ne fait pas si facilement que ça un petit Merkozy ou un petit Merkollande).
Tout ça métaphoriquement bien sûr. Mais je suis près d’y trouver un fond de bon sens…
@ B.R., vous oubliez…
8 : Thom est mort, mais apparemment (vous) a fait don de son œuvre, pour en parler ici.
Tout ça, bien sûr, dans le fond, où il ne pourrait y avoir de « bons sens » sans transmissions plus profondes, passant ainsi grâce à vous, pour un moment, de l’ombre à la lumière.
@ Crypteuses
Peut-être pour les génies comme Thom. Chez les lapins la mort est un retour au centre organisateur (expression chère à Thom): on régresse (d’abord abandon de la sexualité, dur-dur chez les lapins) jusqu’à la réintrégration dans le ventre de Mère Nature.
Si vous voulez voir Thom vivant, JL Godard a fait un film sur lui: « René(e)s ». Dispo sur le net.
@ MEMNON
L’article de Thom est: « Thèmes de Holton et apories fondatrices » dans Apologie du logos.
« Tous ces themata apparaissent par couples d’opposés, comme si une sorte de structuralisme binaire à la Roman Jakobson en dirigeait l’ordonnance. […] Nous allons nous efforcer de donner des themata holtoniens un mode d’engendrement que l’on pourrait qualifier de « dialectique », si le précédent hégélien, redoutable à la fois par son ambition et son imprécision intrinsèque, ne nous l’interdisait… »
@ BasicRabbit
« Je ne pense pas que Thom succombe aux illusions que vous mentionnez »
Ce n’était pas du tout mon propos. C’était une réflexion plus générale, qui ne visait pas du tout Thom. D’ailleurs, les précisions que vous apportez vont dans le même sens que les distinctions que j’avais introduites. Thom ne pouvait pas succomber aux illusions que je mentionne, car il ne confondait pas les deux points de vue, ce que certains tentent parfois à faire. C’est pourquoi aussi il est vrai de dire que « le problème métaphysique global (la position de Paul Jorion?) est probablement indécidable. » On ne peut pas s’appuyer sur un déterminisme scientifique local pour extrapoler un déterminisme métaphysique global.
@ Boudzi
« On ne peut pas s’appuyer sur un déterminisme scientifique local pour extrapoler un déterminisme métaphysique global. »
Le problème du passage du local au global est étudié en maths, typiquement pour le problème évoqué par Paul Jorion. Métaphoriquement (à peine) le problème est: si la trajectoire locale d’une goutte d’eau dévalant une pente est localement déterminée (déterminisme local) par la plus grande pente (le gradient), peut-on en déduire que la trajectoire est globalement déterminée (déterminisme global)? Sous des hypothèses générales la réponse est quantitativement oui (déterminisme laplacien). Mais ce résultat ne s’exporte pas hors des maths car dans la « réalité » il y a toujours un bruitage des données. Ceci a amené les matheux à remplacer la notion de déterminisme quantitatif par un déterminisme qualitatif: l’unicité laplacienne de la solution globale fait place à la notion plus souple (et philosophiquement plus acceptable) de solution structurellement stable. Mais le problème mathématique se complique considérablement car les conditions locales à la fois mathématiquement simples et générales qui assurent le déterminisme quantitatif global n’impliquent pas le déterminisme qualitatif global. Les difficultés apparaissent lorsqu’il y a des plateaux horizontaux éventuellement réduits à des points (le modèle hydraulique montre qu’il n’est pas nécessaire d’être scientifique pour comprendre le problème!). C’est l’objet de la théorie des catastrophes. Dans ces cas le bruit devient constituant du signal (ça devrait faire plaisir à Kercoz 🙂 ) et c’est là, à mon avis (et, si j’ai bien compris, à celui de Thom), que l’homme peut glisser son libre arbitre en modifiant le comportement qualitatif du système dynamique.
Ce qui précède détaille donc le dernier paragraphe de mon commentaire 49.
@Basic et Boudzi.:
Sur ce point :
//// « On ne peut pas s’appuyer sur un déterminisme scientifique local pour extrapoler un déterminisme métaphysique global. » ////
Vous etes en contradiction avec les découvertes sur la » th.du Chaos et son euphémisation « Complexité » « »……qui démontre grace a la puissance de calcul des ordis , les travaux de Poincarré………a savoir que les systèmes naturels développent des modélisations structurelles a caractere fractal …..c’est a dire qu’ il existe un invariant d’échelle sur la gestion des structure et que c’est ce type de gestion qui lui donne sa stabilité …..Ce caractere d’invariant n’ impliquant pas une identité mais une similitude .
On peut illustrer pour l’espece humaine ( ou d’autres especes) cette structure idealisée , « naturelle » ( qui intègre culture a nature) :
-l’ affect gère les interactions ds le groupe ( hierarchisation par inhibition de l’ agressivité intra-spé)
-cette nécessité d’ affect comme variable d’entrée , limite le groupe a un nombre restreint ( quantité formaté durant des millions d’années en fonction des possibilité d’appro d’un territoire de qqs jours de marche .
-L’ agressivité intra-spé inhibée et réutilisé en rites structurant ds le groupe est reporté intact a l’exterieur du groupe contre les autres groupes …..
– La gestion de cette agressivité exterieure peut este , A SON TOUR inhibée de façon a créer une gestion moins agressive des interactions entre groupes …par la mise en place de rites .
On voit bien que cette modélisation fractale va utiliser une dynamique structurelle semblable a la gestion des interactions entre individus , …sans etre identique …..car les variables d’entrées ne sont pas identiques( ni meme souvent , similaires) …..
Cet exemple peut etre multiplié par ceux de la TOTALITE des systèmes vivants ( ou naturels ) ainsi que les modélisations des boucles trophiques d’interactions ….
L’ étude des systèmes complexes montre que les vertus de ces système ( dont la principale : L’ Hyperstabilité des attracteurs) , ne fonctionne que si la modélisation n’ occulte pas les stades minimums du modèle ( d’ ou l’ arnaque de la « main invisible ») …..Les feed-back ou rétroactions doivent etre efficientes des le début des structures
Suivant ma tentative de démo , on peut meme soutenir que non seulement « le determinisme local peut etre similaire au déterminisme global « …………mais que le premier est indispensable au second .
J’ ajoute que cet aspect mathématique de la structure des groupe contredit toute pertinence aux thèses de centralisation , globalisation, meme partielle (gouvernances).
@ Kercoz
» on peut meme soutenir que non seulement « le determinisme local peut etre similaire au déterminisme global « …………mais que le premier est indispensable au second . »
Que le déterminisme local soit indispensable au déterminisme global me semble de bon sens selon l’adage populaire: « qui peut le plus peut le moins ». Ceci dit je ne vois pas le rapport entre le reste de votre commentaire et le déterminisme. Pour moi le ménage chaos/déterminisme sent l’oxymore.
Comme de coutume vous considérez que les attracteurs ont une stabilité structurelle d’autant plus grande qu’ils sont compliqués (trajectoires nouées -cf. le travail de Pierre Dehornoy à ce sujet-, apparition de figures fractales, etc.), et que c’est pour cette raison que ce sont eux qui comptent pour expliquer les phénomènes biologiques ou sociologiques. Je maintiens, à la suite de Thom, que pour expliquer ces phénomènes, ce sont d’abord les attracteurs ponctuels les plus simples, donc ceux liés aux 7 catastrophes élémentaires qui interviennent selon le principe (conjecture BR) que la nature a horreur de se fatiguer les méninges plus que nécessaire (vérification expérimentale tous les jours par BR).
@Basic :
Vous ne m’ avez pas compris ( ou je ne me suis pas bien exprimé) …..
////Que le déterminisme local soit indispensable au déterminisme global me semble de bon sens selon l’adage populaire: « qui peut le plus peut le moins ». /////
Le phénomène fractal sur les superbes images d’ attracteurs , se constatent par focalisation de l’ image sur des détails de l’ image principale …si j’ ai bien compris , cette focalisation consiste a faire glisser des décimales pour augmenter les précisions des variables d’entrée …
En gros , les liberaux se servent de la notion de complexité stabilisatrice ( main invisible) pour justifier une auto-régulation réelle ds la th. des systèmes complexes …..sauf que si l’ on « fausse » le système ou le modèle au départ , ds les premiers groupes économiques , ça fausse tout !
en pratiquant la rupture des groupes originaux , la spécialisation pour augmenter le gain de productivité , on » linéarise -rationalise » le modèle de départ ……
Il n’est pas certain qu ‘ un « laissez-faire » ultérieur puisse récupérer un modèle chaotique …et s’ il le fait , il risque de voir son « temps caracteristique » tres loin , ainsi que la perspective d’une position stable (attracteur )….
Je ne sais si j’eclaire mieux mon point de vue qd je dis que le déterminisme local st indispensable au déterminisme global ? ……..Par déterminisme j’entend surtout etat stable ( attracteur ) ……..Le chaos n’ est « deterministe » que si l’ on considére l’ attracteur comme une zone déterminée ……alors que dans cette zone, ou les solutions se baladent en permanence, il semble que les variables d’entrée récupèrent une certaine liberté d’action.
Pour les attracteurs , je considère ( intuitivement) que leur stabilité est liée non a leur degré de complexité , mais plutot aux nombres d’acteurs interactifs …….par ex , les boucles trophiques de la pedogenèse forestiere ou agraires sont tres nombreuses et tres stables ( POur perturber la stabilité d’ une foret primaire , il faut une ere glaciaire …ou qqs Sapiens dans le coin ……..)…….Il n’ empeche qu’en supprimant les 2/3 de ces acteurs , on arrive a faire pousser des plantes …Malades et qu’on soigne … mais on y arrive ! ….la suppression de la pédofaune , pédoflore , des butineurs etc … rend la stabilité tres faible mais elle n’est pas supprimée ……
Si on visualise un attracteur ,on peut , par ex imaginer que la notion de stabilité -attraction réside ds la pente du trou et que cette pente se renforce par le nb d’acteurs associés au système .( boucles trophiques)
@ kercoz
Merci pour vos explications. Mais j’ai beaucoup de mal à comprendre ce que vous voulez dire. Essentiellement par mon manque de connaissances mathématiques sur la théorie générale des systèmes dynamiques (la lecture de l’article d’Alain Chenciner dans EU rend humble!). Votre emploi récurrent de termes comme chaos et fractale me fait croire que les systèmes dynamiques auxquels vous pensez sont hyperboliques.
BasicRabbit
« Le problème du passage du local au global est étudié en maths »
Sans doute. Mais, si je comprends bien, existe-t-il une trajectoire globale d’une goutte d’eau, hors les conditions effectives de la trajectoire d’une goutte d’eau particulière? Y a-t-il beaucoup de gouttes d’eau qui traversent tout l’univers ? Savez-vous qu’un dispositif expérimental est un artefact ? Il crée des conditions qui n’existent pas et qui ne peuvent pas exister. Connaissez-vous beaucoup de corps dans l’univers qui, « dans un référentiel galiléen (…,) est soumis à une force résultante nulle est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme » ? (Wikipédia). Il n’en existe aucun. Pour faire tenir une galaxie, sans l’adjonction d’une matière obscure, il faut changer la valeur d’une constante considérée jusqu’à présent comme fondamentale, donc invariable. L’univers cosmologique einsteinien est d’abord et avant tout une « solution » mathématique à un problème qui n’a peut-être aucun sens, car il est extrapolation d’une courbure seulement locale de l’espace à tout l’univers. On passe ici, et l’air de rien, de choses qu’on connaît, telles qu’on les connaît, d’où on les connaît, et très partiellement, aux choses telles qu’elles seraient. Laplace n’avait pas besoin de Dieu : mais il est et sera, sans doute, toujours là. Car extrapoler, c’est se mettre à une place qu’on ne peut pas occuper. Si l’on veut : la place de l’Autre:-)
Mais même l’argument du déterminisme local est faux. Car il est une question d’échelle ou de strate ontologique. A un niveau quantique, je laisse ouverte la question du déterminisme, car d’autres semblent mieux renseignés que moi. Mais si le monde était déterminé, on ne pourrait pas y agir, ce qui est contredit tous les jours dès qu’on fait cuire un œuf. De fait, le monde est assez indéterminé pour que l’action y soit possible. C’est pourquoi la liberté n’a besoin ni de la dernière théorie physique pour exister, ni d’une solution mathématique séduisante, mais peut se contenter, parfois, de simplement lever le petit doigt en guise de « preuve ».
« Vous etes en contradiction avec les découvertes sur la » th.du Chaos… »
Je peux bien être en contradiction, ça ne change rien au problème. Les apories de Zénon ne sont ni physiques, ni mathématiques, elles sont métaphysiques. Ce qui signifie, comme cela a été noté par BasicRabbit, qu’elles sont indécidables, et surtout de ces points de vue-là. Compte tenu des limites de Planck et de la vitesse de la lumière, la nature fait des sauts. Elle est discontinue. On peut trouver la solution mathématique que l’on veut au problème, elle reste mathématique. Et même, la question du continu en mathématique est ouverte.
« les systèmes naturels développent des modélisations structurelles a caractere fractal »
Pour le reste, on est à cent lieux. Je dirais que vous êtes d’un réalisme naïf, sans méchanceté. La science élabore des modèles. Mais des modèles de quoi ? Il faudrait, pour savoir si le modèle correspond bien à ce dont il est le modèle, avoir ce « ce » sous les « yeux ». Mais si j’ai ce « ce » sous les yeux, il n’est pas la peine que j’en fasse le modèle, je n’ai qu’à dire ce qu’il est. C’est pourquoi, inversement, et souvent, on commence par faire un modèle pour s’étonner ensuite qu’il correspond bien à ce qu’on « découvre ». C’est la vielle querelle de l’idéalisme et du réalisme. C’est pourquoi le réalisme comme adéquation de la représentation et de la chose est absurde, mais l’idéalisme tout autant, sans quoi il ne serait pas différentiable d’un délire paranoïaque.
« il existe un invariant d’échelle sur la gestion des structure »
Si c’était le cas, et si je comprends bien, physique quantique et théorie générale de la relativité seraient déjà unifiées. Or comme ce n’est pas le cas, l’espace et le temps sont plurivoques.
« L’ agressivité intra-spé inhibée »
Il y a plein d’espèces où elle n’existe pas, il n’y a donc aucune raison de la croire inhibée chez d’autres. Et laisser entendre qu’elle serait la « cause » des formes sociales qu’on trouve chez l’homme est contredit par l’étude des différentes espèces de singes supérieurs, où on remarque une très grande variété de formes « sociales ».
« Les feed-back ou rétroactions doivent etre efficientes des le début des structures »
Ils doivent avoir agi avant d’être effectifs, comme le vivant doit déjà être là pour se constituer, à savoir qu’il se présuppose lui-même. Il n’y a pas de meilleure définition de l’anti-réductionnisme:-) Merci.
BasicRabbit
« Selon l’adage populaire: « qui peut le plus peut le moins » »
Sauf que de celui qui est capable de soulever 100 kg, rien ne permet d’affirmer qu’il sera ensuite capable d’en soulever 50, surtout s’il est fatigué. Une science qui ne se serait construite que sur les évidences premières n’aurait pas été beaucoup plus loin que la « physique » d’un enfant de 5 ans, à en croire Léon Brunschvicg.
@ Boudzi
« Le problème du passage du local au global est étudié en maths »
Il s’agit d’une métaphore hydraulique. Dans le cadre de la mécanique aristotélicienne dans lequel je me place (changement quantitatif, changement qualitatif, génération, corruption) la force est proportionnelle à la vitesse (d’où l’équation différentielle considérée); la masse de la goutte (et donc son inertie) est négligée.
« Mais même l’argument du déterminisme local est faux. Car il est une question […] de strate ontologique. »
L’essentiel de l’article « Actualité du déterminisme » de Thom concerne ce point. Point qui concerne la « méthode » expérimentale en Science. Thom va dans votre sens: pour expérimenter « scientifiquement » il est pour lui nécessaire de postuler la liberté de l’expérimentateur (comment se servir d’une balance si l’on n’a pas le choix des poids à mettre pour l’équilibrer).
@Boudzi :
Je ne peux répondre sur tout …et vos certitudes sont un peu trop arrogantes pour un débat . Juste :
//// « il existe un invariant d’échelle sur la gestion des structure »
Si c’était le cas, et si je comprends bien, physique quantique et théorie générale de la relativité seraient déjà unifiées. Or comme ce n’est pas le cas, l’espace et le temps sont plurivoques. /////
Je vois mal le rapport …..Ces théories sont fausses ou incomplètes du fait meme que leurs définitions utilisent des equations symétriques au temps …… réversibles ….ce qui est contraire aux démos de bifurcations , et d’ irréversibilité ( fleche du temps ) clairement démontrées par Prigogine
Dans l’ » homme ds le fleuve du vivant « , K.Lorenz revient sur sa démo de l’ agressivité intra-spé ….effectivement il nuance en montrant des exceptions rassemblées curieusement sur des especes amphibies ….
@ Boudzi
« enfant de 5 ans »
Thom: « Je verrais volontiers le mathématicien comme un perpétuel nouveau-né qui babille devant la nature. Seuls ceux qui savent écouter sa réponse arriveront plus tard à engager le dialogue avec elle. Les autres bourdonneront dans le vide. »
@ kercoz
« et vos certitudes sont un peu trop arrogantes pour un débat… »
Il ne faut pas en prendre ombrage. C’est ma manière un peu dogmatique et définitive de discuter 🙂 Après tout, quand Paul Jorion affirme que le libre arbitre n’existe pas, il n’en est pas moins dogmatique.
Si le libre-arbitre n’existe pas, c’est qu’on est déterminé à agir ou à penser. Or Paul Jorion est réputé avoir écrit un livre, donc avoir été déterminé à le faire, dans lequel il « prédisait » un évènement qui n’avait pas encore eu lieu et qui pourtant a été la cause/raison de ce livre.
On pourrait invoquer l’idée de cause finale. Mais une des difficultés ici est qu’il paraît difficile de comprendre pourquoi cet évènement a eu besoin de se dire avant de se réaliser, un peu comme si la fleur apparaissait avant le bourgeon, la santé avant même d’avoir posé un pied par terre. On pourrait, néanmoins, interpréter la voyance ou la divination comme une propension qu’auraient les évènements à vouloir se signifier par la bouche de quelqu’un avant qu’ils n’arrivent. L’augure serait ainsi la personne par le truchement de laquelle l’être se dirait ou trouverait l’occasion de s’exprimer, un peu comme le printemps essaie tous les ans de le faire avec les hirondelles.
Cependant, on sait qu’une voyante ne prédit jamais que le réveil de monsieur X sonnera demain matin à 6 heures avant qu’il aille travailler ou que les pâtes seront peut-être trop cuites à la cantine de son entreprise. Pour comprendre cela, c’est sans doute parce que l’être se confierait seulement avec parcimonie: il y aurait des choses qu’il ferait dire ou pré-dire, une crise, l’effondrement d’un pays, une guerre, à savoir les évènements importants, et d’autres qu’il préfèrerait taire, le gâteau trop cuit, la tâche sur le pantalon, le verre renversé, toutes ces choses insignifiantes.
Pour autant, surgit une autre difficulté. Qu’avait donc l’être à raconter avant que l’homme n’apparût, puisque le langage n’existait pas? N’avait-il donc rien à dire? Ou est-ce à dire qu’avant l’apparition de l’homme, tout n’était qu’insignifiance, de l’émergence de la vie à la disparition des dinosaures, de la création d’une galaxie à son effondrement en un trou noir?
Pour ma part, je n’en sais rien.
@ BasicRabbit
« On doit donc en principe postuler le déterminisme »
Le déterminisme doit être considéré de deux points de vue :
– d’un point de vue épistémologique ou gnoséologique, c’est-à-dire relativement à une méthodologie scientifique ou une théorie de la connaissance : en ce sens, on postule qu’on ne peut pas expliquer les phénomènes si on ne présuppose pas, pour pouvoir les comprendre, qu’ils sont dépendants les uns des autres ou liés causalement.
– d’un point de vue métaphysique ou ontologique : en ce sens, on affirme qu’ils sont réellement liés les uns aux autres et qu’un état antérieur, de tel phénomène ou de l’univers tout entier, détermine ou cause l’état qui vient après.
L’erreur est de passer subrepticement d’un niveau à l’autre, ou de faire comme si ils n’étaient pas différents. D’une simple exigence (« en principe »), ou d’une condition de possibilité de l’expérience, autrement dit ce qui vaut en droit, on passe à ce qui serait en fait, en affirmant qu’il existerait une connexion réelle et nécessaire entre les phénomènes.
Ici au moins deux illusions : la première est que ce genre d’affirmation n’a de sens que sur fond de savoir absolu, que personne ne possède si ce n’est Dieu, et laisse entendre que si nous avions un entendement identique au sien nous serions capables d’embrasser et d’expliquer la totalité de ce qui est. On peut alors soit partir des conditions de l’expérience : notre entendement est de fait limité, donc il ne nous est pas possible de connaître la totalité des connexions, mais seulement de certaines, soit partir de l’expérience elle-même, à savoir les connaissances scientifiques : il n’existe pas de théorie du Tout, car les déterminismes sont seulement locaux.
La deuxième illusion, liée à la première, est celle du réductionnisme. On peut aussi le considérer des deux mêmes points de vue:
– épistémologique ou méthodologique, qui peut d’abord signifier que la méthode de la science physique doit et peut s’appliquer partout indistinctement (comme l’usage supposé pertinent des mathématiques en anthropologie, alors même qu’il est absurde et ridicule pour une très grande partie de l’économie : « le bien-être des français a augmenté de 3,28% »). D’autre part, qu’il est possible de réduire ou de traduire le langage ou les termes d’une théorie (biologie) en celui d’une autre (chimie).
– ontologique, qui veut qu’en dernière analyse, le plus souvent, tout soit réductible à un seul type d’être, généralement la matière, qu’aucun matérialiste n’a d’ailleurs jamais pris la peine de définir.
Illusion donc, car ce présupposé réductionniste, c’est-à-dire essentiellement matérialiste, qui est présenté comme un programme (comme s’il y avait des programmes de recherche en métaphysique, et pourquoi pas un prix Nobel?), n’a jamais reçu l’once d’un début de confirmation, par exemple expérimentale (comme la réduction de l’esprit au cerveau ou du vivant à la matière), sans même parler des arguments à la sauce platonico-hegelo-kantienne la plus grossièrement naïve qui font de ce programme un « idéal », qui sera certainement réalisé à la fin des temps, lorsque tout le monde sera mort.
@ Boudzi
Il vous faudrait lire l’article entier pour vous faire une idée du sens que Thom donne au déterminisme.
Thom y traite le problème selon la règle des trois états d’Auguste Comte: théologique, métaphysique, positif. Ou, plus simplement, suivant un aspect global à caractère métaphysique, et un aspect local à caractère expérimental et pragmatique. Pour lui le problème métaphysique global (la position de Paul Jorion?) est probablement indécidable. Et il soutient dans l’article que la solution positive du problème local -nécessaire à la pratique scientifique- présuppose de postuler la liberté humaine!
Je ne pense pas que Thom succombe aux illusions que vous mentionnez. Mais il faut vous faire votre propre opinion en lisant l’article.
Suite
« Nicolas Roberti: « Pour aller directement au cœur du propos, existe-t-il un libre-arbitre? »
Paul Jorion: « Je ne pense pas. »
Thom:
« Je crois que le libre-arbitre existe chez l’homme, en tant que système qui permet d’échapper au double bind. »
« La liberté est fille de l’imagination. »
« La mathématique est fille de la liberté humaine. Elle en est peut-être le plus splendide rejeton. »
Cette histoire de libre arbitre me travaille…
Thom: « Aucun homme sensé ne peut nier qu’il fait la différence entre le passé qui est fixé, défini, et l’avenir qui est plastique; on peut agir sur lui. Cette différence est fondamentale; or elle n’est pas exprimable mathématiquement. C’est tout à fait étrange. C’est cela qui m’amène à reconnaître le libre arbitre humain. »
un trés bel article , en effet, la beauté…peut -etre est ce au moment de la mort que l’on peut comprendre que la propriete n’existe pas intrinsequement ;dans le meme sens que la realite de notre existence n’a pas de substance fixe,evanouie en un eclair ! des moines tibetains ont, il y a longtemps, etabli cette realite logiquement en concluant que si il y avait ne serait-ce qu’une seule chose reellement subtancielle dans l’univers , tout ce qui existe serait obligé de s’y aglomerer…hum …en attendant,il faut bien vivre et cette peur quotidienne,infuse en la richesse,de tout perdre…la vie , l’amour, la santé,la securité …etc… semble dementir fortement la tranquillité que peut-etre il y aurait a vivre en sachant que la mort n’est qu’une composante d’une vie qui la crée et l’oublie infiniment. Mais nous pensons que nous ne sommes pas LA VIE mais seulement « notre corps », »nos « pensées…commes nous nous sentons seuls! et subtanciels! et friables…oh gouffres…j’ai lu quelquepart que la possession n’etait pas reelle et j’ai ressenti beaucoup de bonheur à cette pensée lumineuse , une certaine perplexité aussi quand je me suis laissé aller à penser à l’ampleur de la convention qui à cours entre nous et qui s’acharne a démontrer le contraire …la propriete sacrée ! et qui se cache derriere ce sacre? NOUS ! les possedants ! les bourgeois ! et qui se cache derriere les bourgeois ? LE bourgeois ! et qui se cache derriere ? MOI ! qui suis un bourgeois…moi …qui suis un etre humain…aussi fragile , aussi maltrétable qu’ un autre etre humain…vite ! soyons sacrés ! soyons forts ! soyons les plus forts! et notre vie s’ecoule ainsi . Murés. Et bientots murs…le poete antonin artaud fit cette confidence à propos de son pére : » lorsque je me retrouvais au chevet de mon pére mourant , je realisais combien je m’etais senti mal dans mon corps toute ma vie et combien lui aussi s’etait senti mal dans son corps toute sa vie.. ».il compris que sa vie n’aurait de sens qu’il n’ai déraciné en lui cette souffrance…( antonin artaud ; ecrits revolutionnaires) Peut-etre que nous sommes tellements ocupés par notre mental et par ses circonvolutions civilisationnelles que nous vivons de plus en plus eloignés de notre propre realite vivante , presente et perceptive. et quel appauvrissement de notre realité sensible! la beauté est une richesse incroyable ,gratuite ,inouie ! quand jour aprés jour on vis de plus en plus intimement sur terre…,quand jour aprés jours les arbres,le ciel,les rues ,les etres,prennent de plus en plus de réalité , on voit de mieux en mieux la beauté qui est manifestée par l’univers qui est notre vie meme…tout simplement…bien sur il y a la laideur , les angoisses,mais elles sonts interessantes elles aussi…quelle vie fruste ! mais quelle vie ! et puis petit à petit cette misere perds de son emprise et voila plus de disponibilité , et ces espaces et ces couleurs…Un maitre zen decrivait ainsi le temps :en premier le present, en deuxieme le passé, en troisieme le futur. et non pas en premier le passé en deuxieme le present en troisieme le futur…tout par du present ! de la vie meme ! Aujourdhui et pour beaucoup d’entre nous le present devient de plus en plus mince , réduit, de plus en plus nous sommes passants d’une activité a une autre ? d’une distraction , d’une information à une autre…nous passons a coté de la realité vivable de l’univers , quel apauvrissement ! nous passons a coté d’un arbre et nous pensons : un arbre , comme nous epinglerions un papillon mort dans une boite, ou comme nous colerions un sticker sur le frigo…et nous passons notre chemin en nous replongeants immediatement dans nos ruminations … j’avoue qu’avant de m’ouvrir progressivement à ce qui existe en meme temps que moi ,les arbres je les trouvais conventionnellements beau mais plutot ennuyeux ,comme à peu prés tout ce qui m’entourait…maintenant je peux dire que je vois les arbres de mieux en mieux , de plus en plus réels, de plus en plus interessants…comme en fait a peu prés tout ce qui m’entoure…c’est une richesse que je ne posséde pas et qui disparaitra peut etre avec ma mort , meme si je la perds souvent dans mes préocupations , elle finit toujours par revenir et je me demande souvent comment se fait -il que je l’ai occultée…un moine chretien a dit : dieu est en amont , je suis tombé en admiration devant cette phrase, que j’ai completée par : l’amont c’est maintenant.Si dieu est ,il est surtout dans le maintenant. Le grand .le riche .le beau maintenan….le seul…l’innombrable maintenant. Je me demande quand meme si l’espece humaine dont je suis va disparaitre dans un epouvantable chaos et moi aussi j’essayerai de faire de mon mieux ( sans trop de drames) pour quelle puisse continuer à luire dans l’univers, dans des conditions qui nous soient supportables…il m’arrive parfois soudainement de realiser que je suis en vie, tout existe et j’en fait partie,je suis une expression de cet univers vivant ,je n’en reviens pas…malgrés toute l’insignifiance que je m’accorde malheureusement à moi meme par habitude et par capillarité ordinaire; je suis vivant dans cet univers qui est magnifique…merci…merci …merci…merveille! j’essayerai de ne pas fermer la porte derriere moi…pour que d’autres etres humains et tout les etres puissent continuer comme moi a vivre avec l’étre des étres.
@ PJ
« notre degré de liberté, étant ce que nous sommes, est nul : il n’y a aucune possibilité de jouer la pièce autrement. »
« la présence de l’affect ouvre la voie à une perspective esthétique »
Je suis étonné que vous sautiez directement de la case « déterminisme » à la case « esthétique » en sautant la case « éthique ». Pour moi on ne peut sauter cette case. Dans le triangle éthique (je veux, je dois, je peux -dans cet ordre-), vous avez implicitement considéré le « je veux » sous forme « je veux ma survie individuelle et je veux la survie de l’espèce ». Mais vous avez omis « je dois » (à la suite de Thom -si je l’ai bien compris- ce « je dois » provient essentiellement de contraintes topologiques « universelles » -cad hors substrat- de type stabilité structurelle). Le « je peux » apparaît alors comme un « je veux » sous la contrainte « je dois ». Il reste alors à s’organiser pour réaliser le « meilleur » possible sous cette contrainte (on notera l’accent lamarckien). C’est seulement à ce stade qu’apparaît l’esthétique: pour qualifier le « meilleur ».
Suite
Thom a proposé une théorie de l’esthétique (« L’art, lieu du conflit des formes et des forces », Apologie du logos). Il commence ainsi:
« L’activité artistique est un prolongement naturel de l’acquisition du langage. L’un des aspects essentiels du langage est l’apparition des structures syntaxiques: tout discours se décompose en phrases sémantiquement autonomes, et chaque phrase est elle-même une concaténation de mots (une structure actantielle) régie par une structure algébrique d’arbre (un « gradient »). »
« Principes des systèmes esthétiques » comme prolongement de « Principes des systèmes intelligents »?
Suite
Voir l’activité artistique comme un prolongement du langage me plaît. Pour moi ce prolongement permet de réduire l’écart signifiant/signifié, les couacs de l’arbitraire du signe, vers plus d’harmonie.
Selon Thom le symbole –> fait sens, même dans les sociétés qui ne connaissent pas la flèche et « la voix de la réalité est dans le sens du symbole ».
A mon sens l’écueil à éviter est le formalisme, né avec la coupure galiléenne, qui a culminé avec Hilbert, et qui participe à la vision actuelle que nos « élites » nous imposent du monde, erronée selon moi. Car dans le formalisme il y a parfaite identité entre le signifiant et le signifié (mais il n’y a aucun référent externe, c’est le problème).
@ PJ
A propos du déterminisme.
Je tente comme d’hab une lecture thomienne de vos réponses à l’entrevue. J’ai l’impression que pour vous la marche de l’espèce humaine (comme de toutes les autres espèces d’ailleurs) est inéluctable comme des gouttes d’eau qui finissent, quoiqu’il arrive, à se regrouper en rivières, puis en fleuves pour finalement se jeter dans la mer (alias La Mère Nature, alias Dieu): tout ce petit monde suit approximativement sa plus grande pente (ie localement le gradient). Et le approximativement quantitatif ne change rien qualitativement à cause de la stabilité structurelle (le structurellement instable étant gangue stochastique insignifiante -sans signification-).
Pour Thom d’une part il y a quatre situations dynamiques locales fondamentales (ES p. 57), le pli (naissance, mort), la fronce (scission, confluence). L’écoulement, s’il se fait la plupart du temps en mode confluence, se fait également parfois en mode scission (deltas) et d’autre part dans le modèle universel qu’il propose (SSM), Thom fait remarquer que les organismes vivants à métabolisme lent (les végétaux) sont les proies de ceux à métabolisme plus rapide (les animaux), comme en hydrodynamique turbulente les oscillateurs de basse fréquence sont absorbés par ceux de haute fréquence pour finir dans le chaos thermique. Et l’espèce humaine, grâce à l’invention d’outils de plus en plus perfectionnés, a accéléré et accélère encore de manière considérable son métabolisme (la capture des poissons s’est grandement améliorée depuis les sonars et les avions, celle des sangliers aussi depuis les téléphones portables). Finira-t-elle, et la vie sur terre avec, dans le chaos thermique?
Si déterminisme il y a, la cause finale n’est donc, d’après ce qui précède, pas nécessairement un puits de potentiel (la mer, la plénitude) qui attire l’espèce humaine mais peut être également ramifiante (le delta, le chaos). Et il y a sans doute toute la palette intermédiaire des possibles entre ces deux extrêmes.
Thom est nettement mois radical que vous au sujet du rapport déterminisme/libre arbitre (cf. Actualité du déterminisme dans Apologie du logos). Pour lui il y a moyen, de temps à autre, d’influer sur le cours des choses. S’il a raison, c’est à nous de saisir ces instants.
Ps: j’aurais dû écrire 49 avant 48.
@ BRabbit
J’observe à travers vos commentaires tournés vers un recours à ce que je désignerai le « Thomisme » sans mauvais jeu de mots, le silence de Paul Jorion. Pourtant vous ne manquez pas de l’interpeller directement sur la philosophie de R.Thom versus celle de Jorion.
Je dois avouer, au risque de passer pour un crétin mon incapacité à vous lire, c’est à dire à comprendre ou sous couvert de Thom vous voulez aller, je dois dire que votre sémantique ne m’y aide pas beaucoup, que mes éfforts se lassent, d’ou la raison de mon commentaire. Pourriiez vous vous étre plus clair; moins hermétique, car je me dis que « ce qui se conçoit bien s’énonce clairement et les mots pour le dire y viennent aisément » (sic)
Je me demande mème si le silence de Jorion ne viendrait pas de l’hermétisme de ce que vous dites, en observant la clarté de ce qu’il exprime de son coté.
J’ai éprouvé à la lecture de « Prédire n’est pas expliquer » titre alléchant pour qui s’intérresse aux problèmes de la physique contemporaine une lassitude du mème ordre . Si R.Thom est un esprit majeur, comme semble l’indiquer vos obséssifs commentaires, ne laissez pas s’il vous plait les bonnes volontés sur le bord du chemin.
@ Bernard Laget
A la lecture de vos commentaires je crois deviner que vous avez été formé comme moi aux sciences dures (math pour moi, peut-être plus physique pour vous). J’ai travaillé en théorie des modèles formels (logique mathématique) puis en théorie de la prédiction. La lecture de « Prédire n’est pas expliquer » et de sa théorie générale des modèles ont été pour moi un choc mou (je n’ai pratiquement vu passer aucune balle à ma première lecture) suivi d’une lente érosion qui date maintenant d’une quinzaine d’années.
Un point qui me semble important pour la compréhension des scientifiques de formation classique est que sa théorie des modèles permet des brisures de symétries, ce que ne permettent pas les modèles formels de la logique mathématique classique (qui respectent le principe de raison suffisante de Leibniz) et les modèles formels de la physique classique (qui respectent le principe de Curie).
« Rentrer » dans l’oeuvre de Thom a été et est encore pour moi très difficile, le plus difficile étant de comprendre la partie mathématique: la compréhension de l’oeuvre de Thom nécessite (entre autres) une très bonne compréhension préalable de la théorie des systèmes dynamiques. Et ça me déprime quand je lis l’article « Systèmes dynamiques » d’Alain Chenciner dans EU sachant que Thom lit ce genre d’article comme moi je lis un album de Tintin. J’essaie de me glisser dans la pensée thomienne en partant de la facette philosophique de son oeuvre (une période héraclitéenne suivie d’une période aristotélicienne). Ma participation à ce blog y contribue pour beaucoup.
oue
L’un des buts recherchés par Thom est de réduire la coupure qualitatif/quantitatif qui sévit en Science depuis Galilée. C’est également, j’en suis convaincu (et je suis certain que je ne suis pas le seul sur ce blog), l’un des buts poursuivis par Paul Jorion, Thom par une approche mathématique, Jorion par une approche psychologique. Je pense qu’ils ont grosso-modo la même vision des choses, qu’ils sont dans un nouveau et même paradigme dont ils essaient chacun à leur façon de nous faire prendre conscience.
Suite
« J’observe à travers vos commentaires tournés vers un recours à ce que je désignerai le « Thomisme » sans mauvais jeu de mots, le silence de Paul Jorion. Pourtant vous ne manquez pas de l’interpeller directement sur la philosophie de R.Thom versus celle de Jorion. »
Je considère ce blog comme un divan collectif dont PJ est le psychanalyste (cf. commentaire 52). Je ne l’interpelle en aucune manière.
» Si R.Thom est un esprit majeur, comme semble l’indiquer vos obséssifs commentaires, ne laissez pas s’il vous plait les bonnes volontés sur le bord du chemin. »
Je pense effectivement que Thom est un esprit majeur, peut-être le plus grand de la pensée occidentale depuis Aristote. Je pense que PJ est un « grand » de la pensée contemporaine parce qu’il a une vision généraliste et interdisciplinaire qui lui permet de voir les choses de plus haut,ce que les experts/spécialistes de tous poils qui sévissent actuellement sont incapables de faire. Mais tout ceci n’engage que moi: je suis un « de base ».
Si je ne commente pas personnellement vos présentations de la pensée de Thom, c’est que le plus souvent, je ne reconnais pas Thom dans ce que vous écrivez. Sinon, j’ai beaucoup de respect pour ses manières très aventureuses de s’efforcer de voir les choses autrement.
Seule critique : Thom s’affirme constamment « aristotélicien » mais j’ai souvent beaucoup de mal à reconnaître dans l’Aristote dont il parle, celui qui m’est à moi familier. Dit de manière un peu plus directe : je n’ai pas le sentiment qu’il ait consacré beaucoup de temps à la lecture d’Aristote.
Je me demande même parfois si lePpaul Jorion que je comprends ( pas toujours) est bien le Paul Jorion dans le texte .
Heureusement il y a Aristote , référence plus « éloignée » , pour trouver une « compréhension » commune .
Avec pour moi des parasitages de Pascal (que Paul Jorion n’aime pas trop fréquenter ), Dostoïevsky , Tolstoï…
Bref , j’ai mis assez de temps à me comprendre moi même ,là peu près , pour ne pas renoncer à l’idée que je suis mon meilleur ami et forcément le plus intelligent qui soit .
Mais je reconnais que je ne saurais écrire un livre avec ça !
@juan nessy
Les Carnets du sous-sol…
Sinon :
http://bibliotheque.penvenan.pagesperso-orange.fr/Alain%20Bosquet.htm
– Il trouble l’ordre, dites donc, ce type-là
« Thom s’affirme constamment « aristotélicien » mais j’ai souvent beaucoup de mal à reconnaître dans l’Aristote dont il parle, celui qui m’est à moi familier. »
Thom est un philosophe/géomètre qui s’est intéressé à débusquer un Aristote méconnu, un Aristote topologue, penseur du continu. Son « Esquisse d’une sémiophysique » est consacrée à cet Aristote-là qui ne vous est peut-être pas familier. L’un de ses derniers articles (1996) est consacré à la notion de lieu chez Aristote (« Aristote topologue », Alliages n°43, dispo sur le net).
Thom: « Il me semble qu’il y a au coeur de l’aristotélisme un conflit latent (et permanent) entre un Aristote logicien, rhéteur (voire même sophiste, quand il critique Platon et les anciens) et un Aristote intuitif, phénoménologue, et topologue quasiment malgré lui. »
« Dit de manière un peu plus directe : je n’ai pas le sentiment qu’il ait consacré beaucoup de temps à la lecture d’Aristote. »
Je vous laisse la responsabilité de ce jugement (Thom a co-animé pendant un temps un séminaire sur Aristote à l’EHESS à Paris).
@BR
Ayant lu votre commentaire et la réponse de P.Jorion, je me sens un peu rassurés quant à mes difficultés à comprendre la pensée de Thom. Je ne suis pas certain comme vous du caractère décisif de son oeuvre.
Une remarque personnelle, tout de méme : Je ne piges pas par quoi remplacer le principe de raison suffisante, si il fallait pour des raisons nécessaires l’abandonner; car il est la base de l’entendement, et de la transmission d’une cervelle à une autre de l’acceptable.
@BR
« L’un des buts recherchés par Thom est de réduire la coupure qualitatif/quantitatif qui sévit en Science depuis Galilée. C’est également, j’en suis convaincu (et je suis certain que je ne suis pas le seul sur ce blog), l’un des buts poursuivis par Paul Jorion, »
Etes vous bien certain que cette coupure existe en science ? Pour ma part j’observe qu’il y a toujours un peu des deux ; un discours sur les choses et un moyen de le vérifier quantitativement . Le boson de higgs serait de l’ordre du discours prédictif, son observation au CERN de l’ordre de la vérification probatoire. De ce point de vue je rejoins Thom « Prédire n’est pas expliquer »
@ Bernard Laget
« Ayant lu votre commentaire et la réponse de P.Jorion, je me sens un peu rassuré quant à mes difficultés à comprendre la pensée de Thom. Je ne suis pas certain comme vous du caractère décisif de son oeuvre. »
il y a deux lectures possibles de votre dernière phrase. 🙂
Je ne prétends pas que Thom détienne la vérité. Je crois que sa pensée mérite d’être connue. Je fais sur ce blog du prosélytisme pour son oeuvre parce que je pense, je me répète, qu’elle va grosso-modo dans le même sens que celle de Paul Jorion.
« Etes vous bien certain que cette coupure existe en science ? »
Thom a réuni dans Apologie du logos plus de trente articles pour examiner le spectre selon lui continu qui relie le langage mathématique et le langage naturel.
« De ce point de vue je rejoins Thom « Prédire n’est pas expliquer ». Je vous réponds en paraphrasant Jorion: «
Suite
« je ne reconnais pas Thom dans ce que vous écrivez. » 🙂
Dans un commentaire de son billet récent « La déhiscence de l’avoir », Martin Chanaud affirme que Paul Jorion est matérialiste. A la lumière de Wiki (généralités) et de ce billet-ci, son affirmation me semble plausible. La dernière phrase de Esquisse d’une sémiophysique, le dernier bouquin de Thom, est: « Seule une métaphysique réaliste peut redonner du sens au monde », de laquelle j’infère que Thom est réaliste.
J’avoue être un peu paumé avec tous ces mots en « isme ». Et la juxtaposition matérialisme/cause finale a pour moi un relent d’oxymore…
… d’oxymore …
Un bouquin de Thom par exemple, se tient-il mieux debout ou couché ?
Couché, me diriez-vous, car debout, il risquerait fort de tomber à la moindre pression ou d’un simple courant d’air. Mais s’il nous plaît, de le voir (notre livre) bien droit, il suffirait de nous trouver d’autres « tomes » et ainsi de suite, les uns contre les autres, variant les gros avec les minces, tout finirait pas se tenir assez bien, renforçant éventuellement le tout de 2 ou 3 gros livres couchés en bout de ligne, pour mieux contraindre l’ensemble sur une simple planche ou étagère. Le gros avantage aussi serait que tous ces livres resteraient facilement accessibles pour la lecture. Mais reprenons ces mêmes livres (disons une centaine) et mettons les couchés, cette fois-ci les uns sur les autres. Eh bien, nous constaterions que le principe de stabilité d’origine signalé : (L couché=stable, L debout = moins stable) s’inverserait. En effet les livres mis les uns sur les autres finiraient par former une colonne très fragile, au bout de laquelle, rien ne servirait de mettre quelques autres livres verticaux pour consolider l’édifice… Tout aussi vaine serait la tentative de vouloir se saisir d’un livre se trouvant dans ce montage au risque de tout faire s’écrouler…
Voilà donc, un peu par l’absurde il est vrai, la démonstration qu’un principe à base unitaire et présenté comme stable, peut complètement s’inverser une fois dépassé le chiffre basculant dans le nombre. Alors, ce qui est important de ne pas omettre, au risque donc de se heurter sur des phénomènes contradictoires, c’est d’appréhender au préalable le sens géométrique dans lequel va se déployer la fonction numérique.
Car vue à une autre échelle, une chose peut devenir le contraire d’elle-même dans sa direction, en se multipliant en cent, allant dans un sens ou dans un autre opposé. « Horizontalité verticale » ou « Verticalité horizontale » ?
Exemples : « La verticalité des structures s’oppose à l’horizontalité du développement durable » – « La verticalité du mur blanc s’oppose à l’horizontalité de la pelouse verte ».
Cette question oxymorique peut toutefois tomber dans un plus large non-sens transversal, où par manque d’espace souvent, on en vient à créer son propre rangement, ressemblant plus à un joyeux bordel ou chaos organisé, qu’il en deviendra à nos yeux si cérébralement récréatif, que tout étranger venant à en changer de place un élément, nous le remarquerions plus rapidement que si tout était soigneusement accumulé…
Tous les mots en « isme », lorsqu’ils ne sont pas pris en un sens dépréciatif, le plus souvent par leurs adversaires, un matérialiste traitant ainsi un autre de spiritualiste, et inversement, sont des points de repère utiles, une manière d’indiquer certains présupposés métaphysiques sous-jacents. De fait, matérialisme et finalisme font rarement bon ménage, mais on les trouve bien en cosmologie contemporaine. Descartes est en même temps idéaliste et réaliste, spiritualiste matérialiste.
Les tendances de l’époque – déterminisme social oblige? – sont, notamment en philosophie de l’esprit, à l’idéalisme, ou anti-réalisme, et au matérialisme. On pourra , à ce sujet, lire le très bon article de Jean Largeault, lui-même réaliste, sur le réalisme dans l’Encyclopaedia Universalis et celui consacré au matérialisme, qui rappelle que nombreux sont les matérialistes qui n’ont jamais pris la peine de préciser ce qu’ils entendaient par « matière ».
@ Boudzi
Merci. Je vais regarder. Si Largeault est réaliste alors il y a de bonnes chances pour que Thom le soit!
Quid de Paul Jorion là-dedans à votre avis?
@ BasicRabbit
« Quid de Paul Jorion là-dedans à votre avis? »
Il faudrait lui demander son avis, car je ne l’ai pas encore lu 🙂
On trouvera un article, qui vous intéressera sans doute, de Castoriadis, « Remarques sur l’espace et le nombre » (Figures du pensable), qui est une réponse à René Thom, sur le problème du continu et du discret.
@ Boudzi
J’ai parcouru rapidement une version en anglais. Pour Castoriadis la différence discret/continu est clairement transcendantale (comme pour Petitot) mais je n’ai pas examiné ses arguments.
Pour Thom le continu précède ontologiquement le discret: « La rêverie n’est-elle pas la catastrophe virtuelle en laquelle s’initie la connaissance? »
Autre citation: « Il y a une certaine opposition entre géométrie et algèbre. Le matériau fondamental de la géométrie, de la topologie, c’est le continu géométrique, étendue pure, instructurée, c’est la notion « mystique » par excellence. L’algèbre, au contraire, témoigne d’une attitude opératoire, « diaïrétique ». Les topologues sont les enfants de la nuit; les algébristes, eux, manient le couteau de la rigueur dans une parfaite clarté. »
Je croyais que Paul Jorion avait la même position que Thom. Après ce billet et ceux sur « Principes des systèmes intelligents » je n’en suis plus aussi sûr. D’où ma question.
@ BasicRabbit
Si transcendantal veut dire les conditions, ici la distinction, qu’imposerait a priori le sujet à l’objet, ou la manière selon laquelle il ne pourrait pas ne pas se le représenter, je ne pense pas que cela soit sa position. Comme il le note lui-même, au niveau ultime, ce qui vient du sujet ou de l’objet est indécidable, ce qui n’implique pas une position idéaliste. Mais une position réaliste qui affirmerait l’antériorité ontologique du continu sur le discret n’est pas tenable. Car si le le langage distingue, c’est parce qu’il y a des choses distinguables et .donc distinctes.
@ Boudzi
Merci. J’avais hésité entre transcendantal et indécidable (j’arrive à ces sujets par le biais des maths et je découvre sur ce blog l’univers des idées).
« Mais une position réaliste qui affirmerait l’antériorité ontologique du continu sur le discret n’est pas tenable. Car si le langage distingue, c’est parce qu’il y a des choses distinguables et donc distinctes; »
Pour Thom (si j’ai bien compris) les « choses » apparaissent et se distinguent par des mots comme singularités structurellement stables de l’espace-temps (sa position est donc du côté de l’Einstein de la relativité générale). Cette position nécessite l’antériorité du continu géométrique sur le discret. Dans Esquisse d’une sémiophysique, Thom examine au chapitre « Perspectives aristotéliciennes en théorie du langage » la position inverse d’Aristote (qui sera reprise par Mach).
Pour en revenir à la différence entre les points de vue de Thom et de Jorion je la caricature ainsi.
Pour Jorion on réagit inconsciemment aux stimuli extérieurs et la conscience n’est qu’une chambre d’enregistrement de ces réactions. Pour Thom la connaissance s’initie de manière catastrophique par le rêve:
« On sait le rôle étendu que Freud a attribué au symbolisme sexuel (dans les rêves notamment); il faut bien admettre que les formes géométrico-dynamiques représentant les processus sexuels se rencontrent dans tant d’objets de la nature animée ou inanimée, c’est parce que ces formes sont les seules structurellement stables dans notre espace-temps à réaliser leur fonction fondamentale comme l’union des gamètes; on pourrait presque affirmer que ces formes préexistent à la sexualité, qui n’en est peut-être qu’une manifestation génétiquement stabilisée. »
… si les formes géométrico…
Ps: « mais une position réaliste… »
la position de Thom serait donc idéaliste:
« Malgré mon admiration pour Aristote, je reste platonicien en ce sens que je crois à l’existence séparée (« autonome ») des entités mathématiques, étant entendu qu’il s’agit là d’une région ontologique différente de la « réalité usuelle » (matérielle) du monde perçu. C’estle rôle du continu -de l’étendue- que d’assurer la transition entre les deux régions. »
@
« Pour Thom (si j’ai bien compris) les « choses » apparaissent et se distinguent par des mots comme singularités structurellement stables de l’espace-temps »
Ici, l’unité de la chose serait assurée ou garantie par le mot, ou le signe, le risque étant évidemment une position idéaliste: ainsi pour Berkeley, la chose n’est qu’une collection d’idées ou de sensations, car il n’existe rien comme une matière qui serait le support de ces/ses déterminations. De même, dans la physique classique, l’identité de l’objet est le fait qu’il est identifié à un point matériel, qu’on peut penser comme une substance, au sens métaphysique, car un tel point n’a pas d’existence physique, à laquelle sont attachées différentes déterminations (masse, vitesse, etc.). Différemment, l’unité/identité de Socrate dans le temps est l’unité (illusoire pour Jorion) de l’ensemble des significations qu’on peut lui attacher ou associer, ou leur totalité ou totalisation, impossible à penser ou a effectuer, car elles présupposent ce qu’elles prétendent expliquer, à savoir qu’il existerait une substance de Socrate, au delà (= réalisme) de ce qui en est dit. De ce point du vue-là, on pourrait dire que la position de Jorion est idéaliste, à la suite de Nietzsche pour qui, par exemple, le sujet n’est qu’une illusion que la grammaire induit (on prend une catégorie grammaticale (un substantif) pour une chose réelle (un sujet)).
@ BasicRabbit
« Malgré mon admiration pour Aristote, je reste platonicien en ce sens que je crois à l’existence séparée (« autonome ») des entités mathématiques, étant entendu qu’il s’agit là d’une région ontologique différente de la « réalité usuelle » (matérielle) du monde perçu. C’estle rôle du continu -de l’étendue- que d’assurer la transition entre les deux régions. »
On peut être aristotélicien, donc réaliste en un certain sens, et platonicien, donc idéaliste, mais aussi réaliste, en un autre. Platon est idéaliste, à savoir que ce qui existe véritablement, ce sont les Idées, et réaliste, car les Idées mathématiques existent en soi, c’est-à-dire indépendamment de l’esprit qui les conçoit. Alors que pour Aristote, elles ne sont que des abstractions ou des êtres abstraits, qui ne sauraient saisir l’essence des choses.
Lisez d’urgence Comment la vérité et la réalité furent inventées (Gallimard 2009). Dans toutes les bonnes librairies.
@ Paul Jorion
25.08 euros, c’est pas donné… Je vais essayer de me l’offrir pour Noël 🙂 J’ai lu la quatrième de couverture, ça devrait m’intéresser.
Décidément les bouquins de Paul Jorion se vendent de plus en plus chers . Je n’avais acheté mon exemplaire « que » 26 euros .
J’ai hâte que vous l’achetiez et surtout le lisiez pour apporter ici la critique d’un esprit visiblement aiguisé et encore assez ouvert .
Je n’ai pas encore de mon côté , les idées bien claires ( ça a même tendance parfois à s’obscurcir de jour en jour , et comme on dirait en Afrique , ‘j’ai la tête toute gaspillée » ).
Pour vous mettre l’eau à la bouche , dans l’esprit des parutions périodiques de « la survie de l’espèce », je vous cite un extrait significatif du bouquin ( à propos de Turing ):
» Il n’aura pu s’empêcher de penser que » le test de Turing » de l’intelligence artificielle est sans portée : si la voie illuministe possède un quelconque mérite , il existe un codeur , et l’intelligence artificielle existe depuis plusieurs dizaines de milliers d’années, car c’est la nôtre »
Mais , qu’est-ce qu’un extrait » significatif » ? !
Entendu a un colloque sur le cerveau ……( a réécrire , mon taylor is not so rich !)
….un spiritualiste rencontre un materialiste ……et lui demande … What’s the matter ?
rep : Never mind.
…l’autre : What you’ve got in mind ?
rep : It doesn’t matter ….
En fait pour l’ humour , c’est plutot « no matter »
La rente , l’intérêt , la propriété privée et l’héritage sont invités à l’ouverture du testament du capitalisme .
Plus rien à se partager , et même les pleureuses sont mortes .
Et le notaire n’est pas très fringuant non plus .
fringant …
Les « Pleureuses » ? …
Selon vous , qui donc ….?
PS : j’aurais pu ajouter les diafoirus . Je veux bien ôter les pleureuses .
Je crois que si j’essayais d’écrire un livre sur « la rente, l’intérêt, la propriété privée et l’héritage » pour conclure sur le testament du capitalisme; je m’ennuierais de le faire assez rapidement. il me faudrait trouver un fil conducteur entre ces différents chapitres. L’idée alors, serait de les relier en une unité d’espace, en avançant avec le temps. Je commencerai donc de m’imaginer un endroit au temps du néolithique où des premiers hommes auraient construit une hutte, puis ainsi de suite jusqu’à nos jours. Bien sûr chaque époque serait prétexte pour évoquer un sujet de manière différente mais complémentaire. Suivant le fil de son histoire, cette hutte serait devenue, maison collective, auberge, commerce… On serait donc plongé dans un essai passionnant par le suspens que des évènements divers entraîneraient et en les enchaînant dans la course du temps, en un même lieu… nous pourrions certainement joindre tous nos sujets par le truchement de quelques constructions successives, trinquant entre-elles, réunissant ainsi tous les « sens » de la Propriété…
Tchin, tchin !
Y a de l’idée !
Gregory peut s’y retrouver .
Apories fondatrices (sur le divan…)
» Nous sommes entraînés dans un processus où nous sommes motivés à survivre en tant qu’individus et, de manière incidente mais liée, à assurer la continuité de l’espèce. »
« S’il n’y a pas de place pour un projet individuel, il y a cependant place pour un projet de l’espèce, dans cette tâche générale de la production et de la perpétuation de la vie. »
D’un point de vue naïf je verrais bien l’aporie fondatrice de la sociologie comme l’aporie individuel/collectif, alias survie individuelle/survie de l’espèce. La deuxième citation montre clairement que pour PJ il y a un sens, un bon sens: un projet pour l’espèce d’abord, le projet individuel ensuite (cad sous contrainte de respecter au préalable le projet pour l’espèce). Pour justifier ce sens, ce bon sens, il donne un argument « massue »:
« Tout cela parce que la vie, le processus biologique, a échoué dans le cas de notre espèce à réaliser ce qui aurait pu être l’une de ses formes, celle qui aurait rencontré les aspirations de l’individu, à savoir que l’immortalité lui soit garantie. »
Je voudrais mettre en perspective cette aporie en regard d’apories fondatrices de plusieurs disciplines (dont la sociologie) telles que les voit René Thom (« Thèmes de Holton et apories fondatrices », Apologie du logos). De façon à repérer d’éventuelles analogies dans le but de conforter le choix fait ci-dessus par PJ en sociologie.
Psychologie: opposition déterminisme/libre arbitre alias rapport esprit/cerveau.
Biologie: expliquer la stabilité de la forme spatiale des êtres vivants et ce en dépit du « turn over » constant des molécules qui les constituent. L’origine de la vie est un autre aspect de cette aporie.
Sociologie: opposition entre la permanence de la société et la fluence continuelle des individus qui la composent. La structure du pouvoir est un autre aspect de cette aporie.
On remarquera l’analogie entre les apories fondatrices (selon Thom) biologique et sociologique.
Math: opposition discret/continu. Pour Thom cette aporie domine non seulement les mathématiques mais aussi toute la pensée.
Avec la coupure galiléenne, la découverte du calcul différentiel (Leibniz), la formulation de lois de la physique par équations différentielles (Newton), les mathématiques ont privilégié le formel, le discret, sur le continu géométrique. Cette prévalence du formel (qui n’a pas peu participé au scientisme du XIXème siècle, et a sans doute sa part dans les désastres technologiques présents) a culminé avec Hilbert (et Grothendieck en a peut-être été l’étoile du soir). Avec Poincaré comme pionnier puis Smale, Thom, etc., on assiste actuellement à un renversement de tendance, une prévalence du continu géométrique sur le discret algébrique (l’analyse n’est autre que l’algèbre infinitésimale). Thom argumente son choix en disant que seul le continu peut justifier l’infini en mathématiques (et permet de résoudre le paradoxe des Eléates).
Puisque Thom en math et Jorion en sociologie ont argumenté leur « bon sens », il est tentant et naturel de deviner le « bon sens » dans les autres disciplines (et si possible les argumenter), en psychologie en particulier. Si comme l’affirme Thom, l’aporie discret/continu domine toute la pensée, le « bon sens » en psychologie me semble donc être déterminisme d’abord*, libre-arbitre ensuite (et donc esprit d’abord, cerveau ensuite).
Quelle pourrait être la structure du pouvoir? L’analogie biologie/sociologie notée plus haut laisse penser que des idées sur l’origine de la vie pourraient se transposer à la sociologie (et réciproquement bien entendu). Or Thom a proposé un modèle sur l’origine de la vie: SSM pp. 282 à 286; malheureusement je n’ai rien compris. J’ai cependant noté qu’il y est question d’une bouillie à trois régimes. Ce qui m’a rappelé ce que dit Thom à propos de la structure des sociétés: « On pourrait très bien concevoir une société sans chef unique, voire sans aucun chef, mais le corps social serait au moins une variété de dimension trois (afin d’avoir un champ ergodique sans singularité et structurellement stable) ». SSM p.322. Il y a peut-être un rapport…
* ceci m’amène à modifier l’ordre dans le triangle éthique (commentaire 48): « je dois » avant « je veux ».
** pour moi l’aporie fondatrice de la linguistique est l’opposition signifiant/signifié. Le « bon sens » me semble alors être signifié d’abord, signifiant ensuite.
Bonjour Rabbit.
tu dis :
//// D’un point de vue naïf je verrais bien l’aporie fondatrice de la sociologie comme l’aporie individuel/collectif, alias survie individuelle/survie de l’espèce. ///
C’est une premiere approche , mais il y a plus d’ acteurs :
l’ individu
le groupe présent
le groupe historique ( civilisation)
l’ espèce .
chacun de ces acteurs a des interets differents et souvent contradictoires ( notre interet immédiat individuel s’ oppose a l’ interet du groupe , conflit qui se règle par la hierarchisation )
L’ interet du groupe actuel s’ oppose a l’ interet du groupe historique ( futur) …etc .
Pourtant chacun de nos geste doit respecter au mieux ces differents interets
La « Raison » privilègiera logiquement l’ interet individuel immédiat …il faut donc des forces contraignantes pour contrer la « raison » ….etc…
Pour approcher cette logique , les psycho ne servent a rien puisqu’ils ne voient que l’ écume des jours ……La socio va s’ intèresser , non comme dit Goffman , à l’ individu et ses interractions , mais aux interactions et a l’ individu ….en recherchant les rigidité comportementales , les invariants transhistoriques et trans-territoire, pour en déduire la structure originelle de cette stabilité .
« Huxley dans le Meilleur des mondes, quand les impératifs de la machine sociale éliminent toute possibilité pour l’individu d’exister encore en tant que tel. Nous avons eu la malchance d’en voir un échantillonnage au cours du XXe siècle. », Mustapha Menier ? Le produit hors sol…
Nous y sommes dans la régulation des identités (par les marques) avec la vision d’un homme productiviste et « pousseur du caddie ». C’est un véritable programme politique dangereux qui met en péril l’espèce humaine. A la source du mondialisme ?
Probablement un hasard, on retrouve le frère de Aldous, Julian (théoricien de l’eugénisme, auteur et internationaliste) à l’origine de l’UNESCO (1945) en qualité de premier président. C’est un programme d’orientation culturelle et éducatif dans le sens de la normalisation.
Il est également à l’origine du WWF pour la pseudo protection de la nature. C’est une perspective qui met en avant le concept de divination (Gaïa, mère nature,…?).
Par ailleurs, nous ne devons pas confondre « mondialisation » et « mondialisme ». Dans le premier, ce sont les échanges humains et par exemple l’évolution des moyens de se déplacer comme phénomène naturel (L’homme nomade ? ) tandis que le second, c’est une idéologie, une mystique avec une présentation matérielle de la réussite. C’est une tentative d’unification du monde sombre et froide, sans humanité. Il y a tellement à dire sur la vision du commerce (le monde des marchands), les principes économiques (le libéralisme), les producteurs de pétrole,… Ce n’est pas un secret mais simplement des convergences d’intérêts particuliers (aristocratie mondiale et financière).
Aujourd’hui nous avons un monde dans lequel il n’y a pas de place identitaire pour les faibles mais seulement une utilité matérielle provisoire (la variable d’ajustement).
Enfin, je préfère conclure qu’il y a toujours de l’espoir : on raconte que c’est un moustique qui a terrassé « nimrod »……
ps : Le beau est relié principalement aux yeux. Mais une odeur désagréable peut-elle biaisée la notion du beau lors de l’appréciation ? Le jugement des yeux par le regard ne peut pas s’extirper de l’ensemble des autres sens. L’appréciation se manifeste dans un cadre ou le ressentiment et peut-être même l’humeur sont des variables…. Une analogie (le vécu) peut permettre d’inscrire un type de sensations. L’émission et la réception sont conditionnées par le cadre mais aussi par les propriétés intériorisées qui forment les supports. Il y aurait certainement beaucoup à dire sur l’appréhension du furtif et de l’insaisissable ? Temporalité et espace, dimension….
@ Boudzi
« Dissonance fait remarquer que toute vérité est relative: mais je crois que l’humanité le sait depuis toujours, sauf qu’elle essaie de se le dissimuler. »
» C’est [l’histoire] une science car c’est une discipline objective. »
Pour moi ça a un relent d’oxymore.
.
C’est une plaisanterie.
La vérité pratique qui transforme le monde, c’est-à-dire l’histoire, n’est pas relative.
L’histoire n’est pas une science, mais une lutte.
@Marlowe
Entre l’histoire de la colonisation vue par un maghrébin et celle vue par un français, ou encore celle de la conquête des amériques vue par un indien ou par un européen, où se situe la vérité? Dans les livres? Dans les points de vue respectifs des protagonistes ou quelque part entre les deux (et alors qui pour déterminer objectivement cet entre-deux)?
Allons Marlowe, rien n’est plus relatif que l’histoire, précisément parce que c’est le récit d’une lutte, à tel point que même la sagesse populaire proclame qu’elle est écrite par les vainqueurs…
Y’ a qqun qui m’ adit qu ‘ il n’ y a d’ histoire…..que contemporaine .
à Dissonance,
Ce n’est pas moi qui affirme que l’histoire est écrite par les vainqueurs.
@Marlowe
En effet, et alors que faut-il en déduire?
« Tout cela parce que la vie, le processus biologique, a échoué dans le cas de notre espèce à réaliser ce qui aurait pu être l’une de ses formes, celle qui aurait rencontré les aspirations de l’individu, à savoir que l’immortalité lui soit garantie. »
Il me paraît curieux de faire face à un échec d’un côté si de l’autre celui qui « lutte » contre cet échec est en réalité programmé pour, à défaut d’intention ou de libre arbitre.
« Par l’invention de la médecine, et d’autres techniques qui nous ont permis d’améliorer notre confort, nous avons trouvé le moyen de prolonger la vie individuelle au-delà de son donné naturel pur et simple. Cela est possible par la création de la culture qui n’est rien d’autre que l’extension du processus biologique dans le cas d’une espèce comme la nôtre. »
Il ne me semble pas qu’on ait prolongé la durée de vie. Tout au plus aurait-t-on permis à plus de monde d’atteindre des âges avancés, par le « confort ». Ce qui est d’un intérêt relatif, puisqu’après arrive la gestion de la vieillesse, qui peut paraître un calvaire bien plus grand que la mort.
Nestor de Pylos, héros grec, se faisait déjà la réputation d’avoir vécu plus de trois générations. A l’époque, je ne pense pas que les repères d’âge, (enfance, adolescence, adulte, vieillesse) correspondaient à des âges si différents des nôtres.
Diogène de Sinope, pour vivre dans un tonneau, et pour y vivre suffisamment longtemps au point qu’on le connaisse aujourd’hui, prouve que l’hygiène de vie d’alors n’avait certainement rien à envier à celle d’aujourd’hui.
Ni même les connaissances en médecine. Des erreurs il y en avait pas plus pas moins que maintenant. Le prisme du rationalisme imprime la notion de « progrès » dans les esprits.
Pour le terme « culture », j’y vois plutôt les notions de « savoirs » ou de « connaissances ».
Par contre, pour le reste, je dis « amen » 🙂
Si les économistes forment des postulats alors les sociologues ne prendraient-ils pas les mêmes chemins en affirmant qu’il n’y a pas de libre arbitre ? Les mêmes causes donnent les mêmes effets pour un cadre identique : la science.
Dans la forme, le libre arbitre se situe peut-être dans la singularité, l’originalité, la diversité. C’est l’insaisissable, la différence et peut-être même ce que l’on appelle le « beau ». Le sens du développement serait donc primordial afin de respecter ce concept impalpable dans son évolution.
Dans le fond, le libre arbitre peut se traduire probablement dans la spontanéité, l’instantané manifesté parfois par le hasard. Le libre arbitre se trouve peut-être dans l’inconscient ou encore dans ce que l’on pourrait décrire comme « l’âme ».
D’accord avec vous pour dire qu’il y a des choses irréductibles. Lorsque Paul évoque les processus émergents, il point il me semble leur existence puisque l’on ne peut pas déduire absolument d’un état existant des choses ce qui se produira ensuite, d’un point de vue qualitatif.
Mais là n’est pas vraiment le problème s’agissant de nier l’existence du libre arbitre.
Paul définit le libre arbitre dans un sens précis, relatif au temps, le temps d’une prise de décision qui serait faite au niveau de la conscience.
Or, selon cette perspective, qui est celle en fait de toute une tradition philosophique occidentale, le libre arbitre implique l’existence d’un sujet souverain comme seule et unique origine de ladite décision et qui plus est un sujet s’identifiant à moment du temps, précisément celui où l’on prend la décision. Le problème du libre arbitre comme son nom l’indique est le problème du choix.
Ce sur quoi je suis plus dubitatif concerne l’idée que Paul se fait de la conscience.
Celle-ci se réduit-elle comme le pense Paul à sa fonction d’entérinement de divers processus qui font leur oeuvre en arrière plan, ou bien celle-ci a-t-elle un rôle positif dans le résultat de nos actions ?
J’aurais plutôt tendance à penser que la conscience se constitue de différents régimes d’activité dont l’une est la pensée réflexive, de même que la conscience elle-même est un régime d’activité du corps sensible au même titre que l’inconscient. Or la conscience, ce me semble, tire certaines propriétés du fait même de s’exercer sous le régime de la conscience. Penser consciemment, apporte réellement quelque chose à celui qui pense, quand bien même toute pensée se produit dans le cadre d’un milieu inconscient, celui de l’inconscient proprement dit et celui des structures sociales. C’est une activité en soi, qui a des conséquences y compris somatiques. Il me semble donc difficile de postuler que toutes nos pensées conscientes ne seraient que le résultat de processus inconscients. A telle enseigne qu’il existe même des techniques permettant de diriger nos rêves, ces techniques s’acquérant lorsque nous sommes conscients.
Et puis, d’un point de vue phénoménologique, quelle est l’instance qui permet de dire qu’il existe un inconscient, si ce n’est la conscience sous le régime de laquelle, c’est à dire sous la lumière de la quelle apparaît l’idée de l’existence d’un inconscient ? Une pensée réductible aux seuls processus inconscients revient logiquement à dire que nous sommes constamment inconscients. On rejoint alors le fameux paradoxe de Tchou’ang Tsseu, lequel se demandait s’il était un papillon qui rêvait qu’il était Tchouan’g Tsseu ou bien l’inverse. Tout n’est plus alors qu’un rêve. Dans ces conditions, « être en vie, vivre cette vie » cela a-t-il encore un sens ?
Le sentiment de l’existence, comme dirait Rousseau, n’est-il vraiment qu’un épiphénomène ?
Le monde existe-t-il en dehors de ce sentiment de l’existence ?
@ Pierre-Yves D. et Olivier69
Content de voir que ces questions essentielles que PJ soulève et sur lesquelles il prend une position radicale sont ici discutées (libre-arbitre). PJ prend également position sur la cause finale…
Disons que,
nous n’avons pas le choix de prendre
la vie pour ce qu’elle vaut, c’est à dire
RIEN, mais que rien ne vaut cette vie.
Le sens de la vie ne repose pas uniquement sur la conscience. Tout raisonnable n’est pas rationnel. Où plaçons-nous l’intuition ? Viendrait-elle nécessairement de l’observation ? Quelle est la valeur d’une probabilité ? Le développement se définit certainement par une stratégie intuitive, un choix ou une tentative adaptative qui favorisent les propriétés et capacités et non une sélection maîtrisée forcément rationnelle. Le langage (le support) est une science en soi : un mode de communication mais aussi de compréhension relative et de transmission effective. Nous retrouvons à travers le dénombrement les propriétés associatives et dissociatives qui nous donnent la représentation, une perception nécessaire. Ces facultés perceptibles nous livrent la confirmation de l’existence mais ne nous révèlent pas « les compréhensions » pour autant. C’est ce qui nous permet d’être des sujets à part entière en limitant la confusion. Ensemble, « nous » pouvons essayer de ne faire qu’un mais nous ne serons jamais « un ». Une force ou une faiblesse qui s’adapte au cadre d’existence ? La tendance entre intérêt individuel ou social se manifeste trop souvent en fonction des circonstances comme alternativement un gage de dominance en tant qu’« espèce » mais aussi de survie, le cas échéant. La solidarité est toujours là où nous ne l’attendons plus, pourquoi ? Peut-être que « je suis » non pas uniquement parce que je pense consciemment (la raison) mais surtout parce que « j’ai des intuitions » inconsciemment (la sensibilité). La pensée se révèle avec l’intuition comme un mouvement de l’inconscient au conscient réversible puis se travaille avec la raison afin de permettre l’interprétation. Il y a probablement plusieurs types de mémoires dont certaines relatives aux compréhensions (atemporelles) et d’autres aux expériences vécues (temporelles), les perceptions. Une autre approche pourrait définir l’une comme intuitive et l’autre comme rationnelle ou encore génétique et épigénétique. Tout dépend de l’angle d’analyse. La fin (perception) ne justifie donc pas les moyens et seul la quête (compréhension) est noble. C’est pourquoi se connaître soi même ou l’autre est une quête honorable mais ce n’est pas une fin possible en soi. L’existence ou le sens se situe entre l’essence et la fin ! Le sens de l’existence ? Ce n’est donc pas uniquement la rationalité ou la conscience qui fait la connaissance mais l’intuition également. Est-ce que cette rationalité n’est pas une tentative de maîtrise par la stérilisation (ex ogm) et n’entraîne-t-elle pas l’abstraction définitive de l’intuition ? Ainsi, ne faisons-nous partis du tout alors que nous essayons de nous en dissocier ou de nous en soustraire abusivement (statut) ? C’est un déterminisme indéterminé et indéterminable. Qu’est ce que cela voudrait bien dire en terme de condition ? Cela ne veut pas dire qu’il faut chercher ou définir si nous sommes dans l’illusion ou pas. Peut-être que la méthode se résume à la rationalité et l’art à l’intuition ? Je dirai donc qu’il faut plutôt aujourd’hui réfléchir sur les choix de civilisation qui nous permettraient de concevoir davantage ce qui nous a donné ces propriétés et facultés sans procéder systématiquement à une stratégie scientifique et sélective (forcément définie comme rationnelle). Enfin, mon intuition me dit que ce n’est pas la dominance (signe résiduel du règne animal) mais la coopération et le partage tels les relations pacifiées (signe de socialisation) qui ont propulsé notre espèce. Encore faut-il comprendre maintenant que nous ne sommes pas tout (individualisme) et que nous faisons partis d’un tout (infini) pour trouver notre place (collectif). La liberté se situe entre celle que l’on nous donne et celle que l’on se donne. L’existence (une perception plus qu’une compréhension) est une représentation mais également une sensation…
http://www.pauljorion.com/blog/?p=44806#comment-390496
@ Pierre-Yves D
[La pensée consciente] est une activité en soi, qui a des conséquences y compris somatiques. Il me semble donc difficile de postuler que toutes nos pensées conscientes ne seraient que le résultat de processus inconscients.
A l’appui de la première idée, on pourrait se référer, paradoxalement, à la psychanalyse elle-même, dès lors qu’est assigné à celle-ci le pouvoir d’influencer les comportements moyennant la prise de conscience de certaines pensées refoulées.
D’une façon plus générale, on s’accorde souvent à considérer la conscience comme étant un avantage sélectif dans le processus évolutionniste. En toute rigueur, la conscience ne peut donc pas être un simple épiphénomène.
La deuxième idée me semble en revanche reposer sur une confusion entre « être réductible à » et « être le résultat de». Postuler que la pensée consciente est le simple résultat de processus inconscients n’implique nullement que la conscience soit réductible à des processus inconscients et qu’elle ne constitue pas « une activité en soi ». Nier la conscience en la réduisant à autre chose et la considérer comme un simple produit, voire un épiphénomène, engagent deux conceptions de la conscience bien différentes.