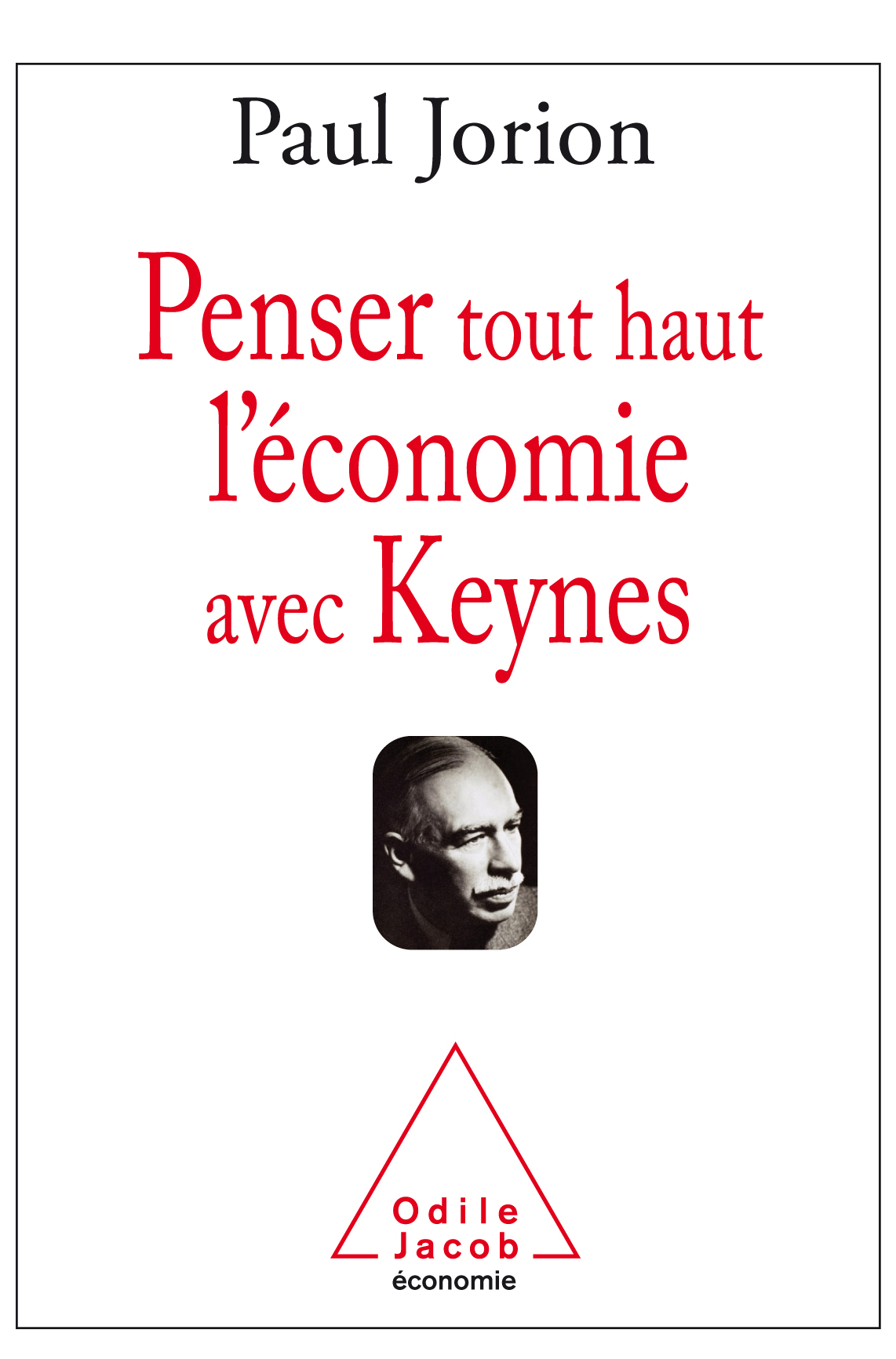 Si l’on veut remplacer la théorie économique dominante, dont Andrew Haldane, économiste en chef de la Banque d’Angleterre, vient de rappeler les faiblesses fondamentales, Keynes demeure un excellent point de départ. Je vous propose du coup en feuilleton dans les jours qui viennent, mes commentaires relatifs aux principaux textes de Keynes, tels qu’on les trouve dans Penser tout haut l’économie avec Keynes (Odile Jacob, 2015).
Si l’on veut remplacer la théorie économique dominante, dont Andrew Haldane, économiste en chef de la Banque d’Angleterre, vient de rappeler les faiblesses fondamentales, Keynes demeure un excellent point de départ. Je vous propose du coup en feuilleton dans les jours qui viennent, mes commentaires relatifs aux principaux textes de Keynes, tels qu’on les trouve dans Penser tout haut l’économie avec Keynes (Odile Jacob, 2015).
National Self-Sufficiency (1933)
[pp. 125-129]
Le 19 avril 1933, Keynes est invité à donner la première des « Finlay Lectures » à University College à Dublin. Dans cette conférence, il évoque spécifiquement la situation irlandaise. Il en réécrira le texte, en le décontextualisant et en en généralisant le propos. L’article paraît sous le titre de « National Self-Sufficiency », l’autosuffisance nationale, dans deux numéros successifs du New Statesman : le 8 et le 15 juillet ; il paraît également aux États-Unis, dans la Yale Review dont le numéro est daté de juin 1933.
Keynes se prononce en faveur de l’autosuffisance nationale. Il s’enflamme à son habitude contre la libre circulation des capitaux à vocation spéculative et déclare que
« Je me range […] aux côtés de ceux qui voudraient restreindre l’intrication des nations, plutôt que de ceux qui voudraient la voir s’étendre. Les idées, le savoir, la science, l’hospitalité, les voyages – telles sont les choses qui de par leur nature devraient être internationales. Mais faisons en sorte que ce qui peut être fait chez soi le soit autant qu’il est raisonnable et pratique de le faire, et, surtout, faisons en sorte que la finance soit essentiellement nationale » (Keynes [1933] 1982 : 236).
Les propos sont convenus et ne reflètent guère l’enthousiasme qui caractérise généralement les interventions orales de Keynes. On ne peut manquer de se demander si le thème de l’autosuffisance ne lui a pas été imposé par le cadre ou par ses hôtes et qu’il se contente là de les obliger.
Autre sujet dont il se débarrasse rapidement : le capitalisme, haïssable sans aucun doute mais difficilement remplaçable et qu’il vaut mieux, du moins pour l’instant, réparer plutôt qu’éliminer purement et simplement :
« Le capitalisme international, décadent mais individualiste, dans les mains duquel nous nous sommes retrouvés après la guerre, n’est pas une réussite. Il n’est ni intelligent, ni beau, ni juste, ni vertueux – ni ne remplit ses promesses. Bref, nous ne l’aimons pas, et nous nous mettons même à le haïr. Mais lorsque nous nous demandons ce qu’il faudrait mettre à la place, nous sommes aussitôt plongés dans la perplexité » (ibid. 239).
Les mots les plus durs de cette intervention viseront d’ailleurs un tout autre adversaire : le communisme soviétique,
« … la Russie aujourd’hui présente le pire exemple que le monde ait peut-être jamais connu, d’incompétence administrative et du sacrifice à des esprits ossifiés de pratiquement tout ce qui fait que la vie vaut d’être vécue » (ibid. 243-244),
… et son chef de file, à la pensée duquel Keynes devient lyrique :
« Staline s’est débarrassé de tout esprit indépendant ou critique, y compris de ceux qui lui étaient favorables sur un plan général. Il a créé un environnement au sein duquel le fonctionnement de l’esprit est atrophié. Les circonvolutions souples du cerveau s’y sont figées en bois. Le braillement démultiplié des haut-parleurs remplace les inflexions nuancées de la voix humaine. La rengaine de la propagande ennuie les oiseaux et les animaux des champs eux-mêmes, jusqu’à la paralysie » (ibid. 246).
Hitler s’en sort presque à meilleur compte :
« L’Allemagne est à la merci d’irresponsables déchaînés – même s’il est trop tôt pour juger sa capacité à réussir » (ibid. 244).
… tandis que Mussolini bénéficie d’un quasi-satisfecit :
« Mussolini, peut-être, est en train de gagner ses dents de sagesse » (ibid. 243).
Mais l’adversaire désigné de cette intervention à Dublin est lui inédit dans les réflexions de Keynes jusque-là : il s’agit de la logique comptable, de son étroitesse, et de ce qu’elle nous force à faire contre notre gré et à l’encontre même de toute rationalité économique. Je reproduis le passage dans son entier :
« Le XIXe siècle a promu jusqu’à la caricature le critère que l’on appellera pour faire bref, « les résultats financiers », comme test permettant de déterminer si une politique doit être recommandée et entreprise dans le cadre d’une initiative d’ordre privé ou public. Le destin personnel s’est transformé en une parodie du cauchemar d’un comptable. Au lieu d’utiliser leurs ressources techniques et matérielles désormais beaucoup plus vastes pour construire une cité idéale, les hommes du XIXe siècle construisirent des taudis ; et ils pensèrent que bâtir des taudis était la chose juste et recommandable, parce que les taudis, à l’aune de l’entreprise privée, « cela rapporte », alors que la cité idéale aurait été selon eux un acte fou d’extravagance, qui aurait, dans le vocabulaire imbécile du monde financier, « hypothéqué l’avenir ». Comment la réalisation aujourd’hui d’œuvres ambitieuses et imposantes pourrait appauvrir l’avenir, nul ne peut le concevoir, à moins que son esprit ne soit sous l’emprise des fausses analogies d’une comptabilité sans lien avec la question. Je passe mon temps encore aujourd’hui – à moitié pour rien, mais aussi, je dois le reconnaître, à moitié avec succès – à tenter de convaincre mes compatriotes que la nation dans son ensemble sera sans conteste plus riche si les hommes et les machines sans emploi sont utilisés pour bâtir les logements dont nous avons tant besoin, plutôt que de devoir leur apporter un soutien dans le désœuvrement. Car les esprits de notre génération demeurent à ce point embrumés par les calculs faussés qu’ils se méfient de conclusions qui devraient être évidentes, parce qu’ils se fient à un système de comptabilité financière qui sème le doute quant au fait qu’une telle opération « rapportera ». Nous sommes condamnés à rester pauvres parce que cela ne « rapporte » pas d’être riches. Nous devons vivre dans des bouges, non pas parce que nous n’avons pas la capacité de construire des palaces mais parce que « nous n’en avons pas les moyens ».
Et c’est la même règle de calcul financier autodestructeur qui gouverne chaque domaine de notre quotidien. Nous détruisons la beauté des campagnes parce que les splendeurs inappropriées de la nature sont sans valeur économique. Nous serions capables d’éteindre le soleil et les étoiles parce qu’ils ne versent pas de dividendes. Londres est l’une des villes les plus riches de l’histoire de la civilisation, mais elle « ne peut pas se permettre » les standards de réussite les plus élevés dont ses propres habitants sont cependant capables, parce qu’ils ne « rapportent » pas.
Si je disposais du pouvoir aujourd’hui, je ferais en sorte, avec la plus grande détermination, de doter nos capitales de tous les accessoires de l’art et de la civilisation du plus haut niveau dont bénéficient à titre individuel les habitants de chacune d’entre elles, convaincu que ce que je suis à même de créer, j’en ai les moyens – et pensant qu’il ne serait pas seulement préférable que l’argent soit dépensé de cette manière plutôt qu’alloué à un fonds d’allocations-chômage mais rendrait tout fonds d’allocations-chômage sans objet. Car avec tout ce que nous avons dépensé en allocations de chômage en Angleterre depuis la guerre, nous aurions pu faire de nos villes les plus grandes réalisations de l’homme au monde.
Ou encore, nous avons jusqu’à récemment considéré qu’il s’agissait d’un devoir moral de ruiner les cultivateurs de la terre et de détruire les traditions millénaires de l’art de l’élevage, si cela nous permettait de payer la miche de pain un dixième de penny meilleur marché. Il n’y avait rien que nous ne jugions notre devoir de sacrifier à ce Moloch et ce Mammon tout en un, car nous imaginions avec ferveur que le culte de ces monstres nous permettrait de vaincre les hideurs de la pauvreté et de mener la prochaine génération sûrement et confortablement, à cheval sur l’intérêt composé, vers la paix économique » (ibid. 241-242).
Et, de crainte de s’être insuffisamment fait comprendre, Keynes conclut :
« Car aussitôt que nous nous octroyons le droit de désobéir au critère du profit comptable, nous entamons de changer notre civilisation […] C’est l’État, plutôt que l’individu, qui doit modifier son critère. C’est la conception du ministre des Finances en tant que président-directeur général d’une sorte de société cotée en Bourse qui doit être rejetée » (ibid. 243).
Ce qui nous interdit donc de prendre les mesures que le jugement rationnel nous enjoindrait de prendre, c’est la logique comptable : la manière toute conventionnelle en réalité dont nous avons pris l’habitude d’établir le bilan de nos entreprise. Nous subissons la dictature des « résultats financiers », qui nous forcent à vivre dans un univers de taudis, au prétexte que « nous n’avons pas les moyens » de faire mieux, alors que des armées de travailleurs désœuvrés et de machines à l’abandon nous permettraient de bâtir d’ores et déjà la cité idéale. L’utopie n’est hors d’atteinte que dans la représentation des banquiers, trouvant un renfort dans la pusillanimité des comptables.
C’est là un thème sur lequel Keynes ne reviendra pas à ma connaissance, en dépit de sa très grande pertinence : une idéologie armée de pied en cap est en réalité inscrite dans les règles comptables. Ce n’est rien d’autre en effet qu’une convention que de considérer les avances faites en travail comme un coût qu’il s’agit à tout prix de minimiser, alors que les dividendes ou les bonus accordés à la direction pour des avances en capital ou en supervision, sont des parts de bénéfice, le montant duquel étant admirable par définition, n’est jamais jugé assez élevé.
La dévalorisation du travail, l’idéalisation au contraire du capital et de la direction d’entreprise, ne sont pas simplement des valeurs dont l’opinion publique pourrait débattre à son gré : elles ont été chevillées, à l’abri de la délibération démocratique, dans la logique économique de nos sociétés, par le biais des règles comptables que nous avons adoptées, ou plutôt qu’adoptent pour nous, loin du débat public, les organismes privés sur lesquels nous nous sommes déchargés de leur rédaction et de leur modification : le FASB (Financial Accounting Standards Board) pour les États-Unis et l’IASB (international Accounting Standards Board) pour le reste du monde, comme s’il s’agissait là de questions techniques indifférentes dont il serait loisible d’abandonner sans danger la rédaction à des « experts » cooptés par leurs pairs.
La vidéo de M.Hoesli. Désolé au bout de seulement 1 minute de sornettes plus débiles les unes que les autres,…