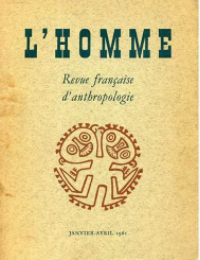
Fou, Sauvage, ou les deux à la fois
A paru dans L’Homme, avr.-juin 1982, XXII (2) : 87-92.
- À propos de Thierry GINESTE, Victor de l’Aveyron, dernier enfant sauvage, premier enfant fou, Paris Le Sycomore, 1981, XVI + 327 p., bibl., index, ill ; (« Les Hommes et leurs Signes)
Dans cet ouvrage, Thierry Gineste a réuni un essai de sa composition et un recueil de documents relatifs à celui qui devint « Victor, l’enfant sauvage de l’Aveyron ». Dans la mesure où l’introduction de Gineste s’appuie sur les documents (beaucoup moins qu’on ne s’y attendrait cependant), disons quelques mots de ceux-ci. Les deux mémoires d’Itard nous étaient connus (Malson 1964; Lane 1976, etc.), comme ceux de Pinel (Hervé 1911 ; Copans & Jamin 1978) ; quant aux autres documents, il fallait se contenter jusqu’ici des extraits présentés par Lane dans The Wild Boy of Aveyron. Parmi les textes « retrouvés » et publiés pour la première fois dans un dossier sur Victor, on notera la polémique inaugurée puis entretenue par Gabriel Feydel, homme de lettres, journaliste et pamphlétaire qui, héritier de Fontenelle, crie à la supercherie et défend brillamment son hypothèse provocatrice, ainsi que deux articles anonymes publiés dans La Décade philosophique en 1800 et 1801. Ces deux textes importants soulèvent évidemment la question de l’identité de leur auteur. Gineste considère qu’il s’agit probablement de J.-J. Virey; cette hypothèse me semble cependant peu vraisemblable, et il ne fait aucun doute pour moi que leur auteur est J.-M. Degérando. Je n’entrerai pas ici dans les détails, mais Virey (pp. 179-197) défend un point de vue strictement rousseauiste : on trouve (pp. 196-197) chez lui des accents très proches du Discours sur les sciences et les arts, alors que l’auteur des deux articles anonymes attaque avec virulence la position rousseauiste dans la perspective de l’Idéologie. Ceci suffirait à refuser la paternité de ces textes à Virey ; quant à l’attribuer à Degérando, il n’est qu’à remarquer la similitude entre le texte, signé, de Degérando (pp. 252-257) et les textes anonymes ; similitude des thèmes — « idiotisme moral » (p. 253), « imbécilité apparente produite par les causes morales » (p. 320) —, mais aussi similitude des formules : « conclure de l’analogie des effets à l’analogie des causes» (p. 253), « rapprocher le tableau des effets de celui des causes » (p. 173), « on n’a pas manqué de conclure que la similitude des effets supposait la similitude des causes » (p. 320).
Dès lors un soupçon : Gineste lit-il avec suffisamment d’attention les documents qu’il réunit pour nous avec beaucoup de soin ? Le sous-titre de l’ouvrage, Dernier enfant sauvage, premier enfant fou, souligne l’intention de l’auteur d’annexer Victor à l’histoire de la psychiatrie. A priori, pourquoi pas ? Le jeune Sauvage appartient déjà aux histoires de la philosophie, de l’anthropologie, de la psychologie et de la pédagogie; pourquoi pas à l’histoire de la psychiatrie? Le prétexte à cette annexion réside dans le diagnostic d’idiotie porté par Pinel : « on ne trouve presque aucun point de conformité entre lui et les individus qui composent les hordes sauvages », et voilà Victor rapproché d’une collection d’enfants disgraciés que, moins mécanistes, nous appellerions « cas sociaux » plutôt qu’ « idiots ». « Ses actes extérieurs, bornés à une sorte d’instinct animal, nous ont donné l’idée de le comparer avec les enfants et les adultes dont les facultés morales sont plus ou moins lésées, et qui, incapables de pourvoir à leur subsistance, sont confinés dans les hospices nationaux » (p. 215). Encore que, sous ce rapport, Victor ne supporte pas la comparaison : « il existe une disparité remarquable entre l’enfant de l’Aveyron et les idiots des hospices relativement aux objets de subsistance » (p. 212). Les moins légitimes inventeurs de la phrénologie, Gall et Spurzheim, porteront un jugement identique. Qu’à la différence des enfants de Bicêtre (selon Itard) ou de la Salpétrière (selon Degérando), Victor ait vécu cinq à sept ans seul dans les bois apparaît en fin de compte comme accessoire à Pinel, sa nosographie ne distinguant pas les « idiots des villes » des « idiots des bois » ; ce qui souligne bien que si Pinel répond à une question, ce n’est pas celle que se posent ses contemporains quand ils reconnaissent en Victor un « Sauvage ». Je suivrais volontiers Tinland (1968 : 83) quand il écrit : « L’engouement mondain pour la fille de Sogny, pour Peter, pour Victor […] serait incompréhensible si leurs contemporains n’avaient vu en eux que des idiots comme ceux que Pinel voyait à Bicêtre. »
En fait, la réponse de Pinel ne porte que sur une des cinq questions que les contemporains se posent. Les cartésiens se demandent si Victor peut nous révéler, non contaminées par l’éducation, les idées innées que Dieu dépose dans notre âme ; les linnéens veulent savoir s’il est un exemple de retour, par atavisme à la forme sauvage de l’humanité (homo ferus) ; les rousseauistes l’imaginent comme « un sauvage absolument sauvage », selon l’expression de Buffon (De l’Homme, 1749), résistant involontaire aux séductions de la civilisation (eux seuls ne risquent pas d’être déçus, car comme l’écrit Rousseau : « J’aime encore mieux voir les hommes brouter l’herbe dans les champs, que s’entredévorer dans les villes » [Dernière Réponse, 1752]) ; les sensualistes condillaciens cherchent l’homme-statue, l’homme absolument privé de contacts sociaux, « l’homme véritablement sauvage, celui qui ne doit rien à ses pareils » (Itard); quant à Pinel, il nosographie les devant-être-assistés et… enfermés.
Le jugement de Pinel illustre bien le fait que les tenants de théories différentes (dont le fondement est toujours métaphysique, comme l’a souligné Duhem) ne dialoguent jamais, mais parlent chacun pour soi. Involontairement il fait appel au paralogisme connu sous le nom de « réduction » : si Victor est idiot, c’est qu’il n’est pas sauvage ; comme si la notion d’homme sauvage avait la moindre place dans son système. Il s’étonne d’ailleurs de bonne foi qu’on puisse parler de « sauvage » à son sujet : « on ne trouve aucun point de conformité entre lui et les individus qui composent les hordes sauvages. Il ne faut pour s’en convaincre qu’une simple lecture d’un recueil qu’on vient de publier sous le titre Voyages chez les peuples sauvages, ou l’homme de la nature » (p. 215). Bien sûr, en se penchant sur un cas clinique et en faisant comme si le diagnostic pouvait dire « oui, il s’agit bien d’un homme de la nature », Pinel disqualifie indirectement les questions que se posent cartésiens, rousseauistes et sensualistes ; mais ainsi, il permet à tous ceux qui se déclarent déçus de cautionner avec enthousiasme le diagnostic d’imbécilité. Degérando a donc raison de dénoncer les tenants de l’idiotie comme étant des philosophes désappointés, en particulier les rousseauistes : « Quelques personnes qui veulent voir dans l’homme solitaire l’homme de la nature, selon lesquelles l’état sauvage est non seulement l’état primitif de l’homme, mais encore son état le plus parfait pendant que la civilisation et l’état de société n’en sont au contraire que la dégénération s’indignèrent que l’homme de la nature répondît si peu à leurs espérances » [c’est en particulier le cas de Virey : « Je suis fâché de voir l’homme naturel si égoïste »], ou « redoutèrent qu’une expérience sans réplique vînt démentir leur hypothèse. Ils se hâtèrent donc d’affirmer que cet enfant était né imbécile, et qu’une lésion naturelle de ses organes physiques ou de ses facultés morales pouvait seule avoir produit des résultats si contraires à leur attente » (p. 253).
À l’étiologie de Pinel, vieille de deux millénaires et non questionnée (frayeur maternelle, vers, ou première dentition difficile), Degérando, avant Itard, oppose « une sorte d’idiotisme moral, semblable dans ses effets à l’idiotisme physique » et produit par « quelques circonstances extraordinaires, comme un long isolement, une existence brutale ». Degérando est un Idéologue, le rousseauisme est pour lui dépassé, les partisans du « sophiste de Genève », comme l’appelle M. de La Harpe, sont pour lui autant d’esprits attardés ; les valeurs qu’il défend sont déjà celles d’un XIXe siècle conquérant. Qu’on en juge par les termes qu’il emploie pour répondre à la question de savoir si Victor est un homme de la nature (pp. 175-179) :
1) Veut-on dire un homme qui « n’ait jamais été modifié par aucune circonstance extérieure et accessoire » ? « Si l’on adopte cette première définition, je dirai qu’elle ne convient en aucune manière au Sauvage de l’Aveyron, qu’elle ne peut même s’appliquer à aucun individu, et que jamais il n’exista d’exemple d’un phénomène semblable. »
2) Veut-on entendre un Homme qui « n’a point éprouvé l’influence des causes extérieures qui appartiennent à l’ordre moral » ? (C’est le cas d’Itard : « En lui donnant ce sentiment — du juste et de l’injuste — je venais d’élever l’homme sauvage à toute la hauteur de l’homme moral », p. 300.) « Si l’on adopte cette définition, le Sauvage de l’Aveyron peut réaliser cette hypothèse, mais alors on ne pourra rien en déduire pour accuser, avec quelque fondement, ou la sagesse de la nature, ou la dignité de l’espèce humaine. »
3) « Veut-on entendre par l’Homme de la Nature, l’Homme qui répond exactement à la destination de la Nature, qui réalise les intentions qu’elle a eues sur notre espèce ? » Mais la nature « nous a destinés à l’état de société, et [au] développement de nos facultés, que cet état suppose et détermine […] dans ce cas le Sauvage de l’Aveyron n’est plus l’Homme de la Nature, et […] personne même n’en est plus éloigné que lui. »
Degérando conclut par une boutade, mais une boutade révélatrice : il existe bien un homme de la nature, mais ce n’est pas celui que certains crurent un instant voir incarné en Victor, et qui se hâtèrent de médicaliser (psychiatriser) l’enfant quand il n’apparut pas à la hauteur de sa tâche philosophique : « Mais lorsqu’en traversant un paisible hameau, je trouve une famille d’honnêtes et laborieux cultivateurs, devant à son économie et à ses soins une douce aisance, dont les membres sont étroitement unis entre eux ; qui dans leur modeste vie, ne sont tourmentés ni par le remords, ni par l’ambition, ni par la crainte ; lorsque j’y vois un bon père, un bon fils, des époux tendres, des citoyens fidèles, des êtres heureux et contents […], alors je dis : j’ai trouvé l’Homme de la Nature » (p. 179).
Dès lors, pour peu que la question ait un sens, l’homme de la nature n’est ni le Pongo [orang-outang] que Jean-Jacques envisage un moment comme candidat possible, ni cet homme de l’âge des cabanes qu’il retint ensuite, mais le paysan français. On notera le chemin parcouru depuis La Bruyère, et l’on découvre les débuts du populisme ruraliste. Donc le débat est loin d’être insignifiant pour nous, puisqu’il oppose les deux sources morales de l’anthropologie française contemporaine : glorification rousseauiste du Sauvage lointain ou glorification populiste du Paysan proche. L’axe est déjà dessiné, opposant deux variétés du fantasme romantique : l’exotique et le quotidien.
Notons toutefois une alternative, Feydel s’en prend à la crédulité de ses contemporains : « Il a dû arriver que, dans le nombre des polissons qui, pour fuir l’école ou le troupeau, ou pour d’autres motifs, se jettent tous les ans dans les bois, quelques-uns aient été poussés par les circonstances extraordinaires, à jouer le rôle de sauvage (p. 132) ; quant à Bory de Saint-Vincent (1825 : 271), il inaugure une formule qui fera recette en incriminant les journalistes : « Ce sauvage de l’Aveyron, véritable idiot, sale et dégoûtant, auquel de nos jours des gens que tourmente la manie d’écrire voulurent donner de la célébrité pour s’en faire une. »
Mais revenons à Gineste et à son ambition de voir dans Victor un jalon de l’histoire de la psychiatrie. « Idiot », Victor l’était sans doute, mais, quels que soient la sympathie ou le dégoût qu’il nous inspire, c’est là la réponse la plus plate au débat dont il fut le prétexte. Dans la mesure où nous ne pouvons échapper à une histoire présentiste qui traduit les questions que se posèrent nos prédécesseurs en autres questions qui gardent un sens pour nous, Victor appartient bien aux histoires de l’anthropologie, de la philosophie, de la psychologie et de la pédagogie. Mais dans l’histoire de la psychiatrie, je dirais qu’il n’est rien. Considéré comme un idiot, tout ce qui fait du Sauvage de l’Aveyron un cas exemplaire est nécessairement gommé. Révélateur de l’homme avant — ou à côté de — la socialisation, dépositaire du fonds instinctuel de celui qui est livré à ses simples sensations mais privé du commerce d’autres êtres humains, individu ensauvagé et rebelle à tout apprivoisement ultérieur, Victor est le support d’un quadruple débat philosophique entre rousseauistes, cartésiens (on ne s’étonnera pas que Gall [le phrénologue] se révèle tel), partisans tardifs de Linné (Blumenbach, Lawrence, Prichard, qui étayent leur monogénisme par l’hypothèse de l’homme comme animal domestique), et Idéologues plus ou moins proches du sensualisme condillacien. Chez Pinel, Victor est classé idiot dans une double logique du maintien de l’ordre : maintien de l’ordre par internement, car si Pinel brise les chaînes, ses « idiots des hospices » n’en sont pas moins enfermés : sourds-muets, albinos, épileptiques, objets proprement inclassables, mais insupportables et rassemblés à ce titre ; maintien de l’ordre rationnel, par classement au sein d’une nosographie symptomatique (son étiologie, nous l’avons dit, est antique et rudimentaire).
J’évoquais plus haut la lecture négligente par Gineste des documents qu’il a réunis. Ne nie-t-il pas qu’Itard soit un élève de Locke et de Condillac, sous prétexte que l’on ne retrouvera pas leurs livres dans sa bibliothèque (p. 82) ? Pourtant les références louangeuses aux maîtres du sensualisme foisonnent ; Condillac est cité en épigraphe au premier rapport : « Le plus grand fonds des idées des hommes est dans leur commerce réciproque » (p. 217), et hommage est rendu « à la force de leur génie et à la profondeur de leurs méditations » (p. 251). Gineste nie aussi qu’il existe un différend entre Itard et Pinel et parle de leur « opposition mythique » (p. 92). C’est là, je crois, un des dommages possibles d’une approche « psychiatrique » du Sauvage de l’Aveyron, car les auteurs qui se sont penchés sur le conflit entre Itard et Pinel ne se sont pas trompés.
Avec Victor, les Idéologues — et Itard en est un, et non des plus tièdes — avaient trouvé l’homme-statue ; Itard lui-même le qualifie d’ « homme-plante » (p. 290). Sicard, instructeur des sourds-et-muets et patron d’Itard, écrit dans la Gazette de France que cet enfant « sera l’objet des observations des vrais philosophes » ; iront le visiter « sans doute avec empressement ceux qui, depuis longtemps, désiraient qu’on élevât loin de toute société et de toute communication intellectuelle, un enfant à qui personne n’eût jamais parlé, et dont on aurait épié jusque aux moindres mouvements qu’il aurait employés, pour l’expression de ses premières pensées : si tant est qu’on puisse penser sans signes fixes et convenus. Cet enfant est tout trouvé » (pp. 119-120). Plus tard, il rappellera que « des tentatives bien louables ont été faites pour développer son intelligence et faire faire quelques pas à la Science Idéologique » (p. 308).
D’Itard à Pinel, on passe de la philosophie à la médecine. Pinel l’ignore, tout comme ses descendants lointains. Itard feint d’évoquer un passé ancien quand il parle d’ « une médecine, dont les vues nécessairement bornées par une doctrine toute mécanique, ne pouvaient s’élever aux considérations philosophiques des maladies de l’entendement » (p. 219). Il n’ignore pas davantage le souci médical du maintien de l’ordre quand il s’écrie dans sa propre prosopopée: « ‘ Malheureux’, lui dis-je, comme s’il eût pu m’entendre, et avec un véritable serrement de cœur, ‘puisque mes peines sont perdues, et tes efforts infructueux, reprends avec le chemin de tes forêts, le goût de ta vie primitive ; ou, si tes nouveaux besoins te mettent dans la dépendance de la société, expie le malheur de lui être inutile, et va mourir à Bicêtre, de misère et d’ennui’ » (p. 287).
RÉFÉRENCES
BORY DE SAINT-VINCENT, J.-B.
1825 Dictionnaire classique d’histoire naturelle, VIII. Paris, Rey & Gravier.
BUFFON
1971 De l‘Homme, 1749. Présentation et notes de Michèle Duchet. Paris, Maspero.
COPANS, J. & J. JAMIN, eds.
1978 Aux Origines de l’anthropologie française. Les Mémoires de la Société des Observateurs de l‘Homme en l‘an VIII. Textes publiés et présentés par J. C. & J. J. Préface de J.-P. Faivre. Paris, Le Sycomore (« Les Hommes et leurs Signes »).
HERVÉ, G.
1911 « Le Sauvage de l’Aveyron devant les Observateurs de l’Homme », Revue anthropologique XXI : 383-394 et 411-454.
LANE, H.
1976 The Wild Boy of Aveyron. Cambridge, Mass., Harvard University Press. (Ed. anglaise: London, George Allen & Unwin, 1977. Trad. franç. par C. Butel, sous le titre : L’Enfant sauvage de l’Aveyron, Paris, Payot, ¡979.)
MALSON, L.
1964 Les Enfants sauvages. Mythe et réalité. Paris, Union générale d’Éditions
( « 10/18 »).
ROUSSEAU, J.-J.
1964 « Dernière réponse de J.-J. Rousseau de Genève », 1752, in Œuvres complètes, III. Paris, Gallimard (« La Pléiade ») : 71-96.
TINLAND, F.
1968 L’Homme sauvage. Homo ferus et homo sylvestris. Paris, Payot.
Laisser un commentaire