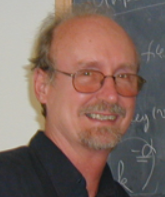 1990 : Douglas White (1942-2021), professeur d’anthropologie à l’Université de Californie à Irvine, mort il y a quelque mois, est à Paris à l’invitation de la Maison des Sciences de l’Homme. Il s’enquiert : « À qui faut-il parler ? ». Prudent, il demande cependant aux noms qui lui ont été conseillés : « Pourquoi croyez-vous qu’on m’a suggéré de vous parler ? ». Nous serons co-auteurs de deux articles en modèles algébriques de la parenté.
1990 : Douglas White (1942-2021), professeur d’anthropologie à l’Université de Californie à Irvine, mort il y a quelque mois, est à Paris à l’invitation de la Maison des Sciences de l’Homme. Il s’enquiert : « À qui faut-il parler ? ». Prudent, il demande cependant aux noms qui lui ont été conseillés : « Pourquoi croyez-vous qu’on m’a suggéré de vous parler ? ». Nous serons co-auteurs de deux articles en modèles algébriques de la parenté.
Cher Doug,
Voici mes réponses aux questions que vous m’avez posées.
Lorsque j’étais étudiant à Paris (1969-1971), j’étais officiellement inscrit à l’École Pratique des Hautes Études comme étudiant de Lévi-Strauss et de Guilbaud. J’ai également assisté aux conférences de Lacan (comme 50 % des Parisiens de l’époque) mais il s’agissait de conférences « ouvertes ».
Lévi-Strauss ne permettait qu’à 25-30 personnes de faire partie de ses séminaires, parmi lesquelles un petit roulement d’étudiants diplômés (5-6), ce qui était mon cas. Je suis rapidement devenu une peste, au grand amusement de Pouillon (alors secrétaire de LS, qui dirigeait également Les Temps Modernes et L’Homme), qui estimait qu’il fallait « faire quelque chose pour un tel casse-pieds universel » (citation de ma rencontre avec Heller l’autre jour) et qui m’a soutenu depuis. Je savais que LS aimait mon travail et il l’a fait savoir de diverses manières. Nous n’étions pas proches car il n’était proche de personne (il est beaucoup plus détendu maintenant). Lorsque ma confirmation en tant que maître de conférences à Cambridge est arrivée (1983), il a écrit une lettre de soutien que je n’ai pas vue mais dont quelqu’un du comité m’a dit qu’elle avait été l’obstacle le plus sérieux à mon licenciement par Jack Goody (qui a quand même gagné). Lorsque je suis récemment passé à la finance, je l’ai rencontré pour lui demander conseil – comme je l’avais fait à plusieurs reprises. Je pense vous avoir raconté sa réponse, à savoir que l’anthropologie était morte pour le moment et que je ferais mieux de faire quelque chose d’intéressant jusqu’à ce qu’elle ressuscite ; la conversation a ensuite dérivé sur la théorie des catastrophes et les fractales.Guilbaud avait de l’ordre de cinq étudiants à l’époque et nous nous réunissions dans une pièce obscure juste en face des Folies-Bergères. Il était alors le conseiller mathématique de Lévi-Strauss et de Lacan. Il était le plus enthousiaste des enseignants, mais il n’attirait que les très rares mordus de mathématiques dans les sciences sociales. J’ai beaucoup appris de lui en termes d’utilisation des mathématiques comme une boîte à outils, sans préjugés sur ce qui pourrait fonctionner ou non.
Avec Lacan c’était différent, je venais juste de commencer ma formation en psychanalyse (1971-3) quand on m’a retenu avec une demi-douzaine d’autres débutants pour me présenter formellement à lui comme « l’avenir de la psychanalyse ». Bien sûr, nous nous sommes disputés ce jour-là (l’enregistrement a été publié plus tard) et il a pris goût… à ma personnalité. Bien que je n’aie jamais pratiqué la psychanalyse, les Lacaniens se tournaient souvent vers moi comme vers un « sage ». Ainsi, mon invitation à donner une conférence au département de psychanalyse (1985-86) de Paris VIII – anciennement « Vincennes », mon unique conférence en tant qu’invité à la chaire de Lacan (1983), alors – et toujours maintenant – occupée par J-A Miller, la chronique qui m’a été offerte à L’Ane (magazine de belle apparence d’inspiration psychanalytique) dirigé par Judith Miller (née Lacan), etc.
J’avais d’autres « protecteurs » : Edmund Leach avec qui j’ai entretenu une relation très étroite : travaillant ensemble sur l’histoire de l’anthropologie britannique, il m’appelait à tout moment de la journée avec une nouvelle anecdote ou réflexion ou m’envoyait de longs commentaires (j’ai une correspondance avec lui couvrant des centaines de pages) ; comme vous le savez, il m’a aussi beaucoup aidé avec mes articles sur l’algèbre de la parenté, en simulant sur son ordinateur (il a dû être parmi les 50 premières personnes en Angleterre à avoir un micro-ordinateur : 1979), en faisant des suggestions, etc.
John Barnes ? Nous avons reconstitué les premières tentatives d’algèbre de parenté (Deacon, Barnard, Armstrong, Brenda Seligmann, etc.) : il a consenti un travail énorme pour donner substance à nos discussions.
Rodney Needham ? Il est devenu un véritable « agent » pour ma conception de l’anthropologie, il m’a obtenu la bourse Nuffield qui m’a fourni un assistant mathématique (cela n’a pas aidé non plus pour ma reconduction à Cambridge : je devenais une unité autonome dans le département. Lorsque JG a refusé d’avoir des étudiants diplômés, j’ai commencé à chercher moi-même des bourses pour étudiants et j’ai réussi. Une vraie peste, vous dis-je ! … à Cambridge cette fois !) ; Needham a été la seule personne qui, parlant de moi, a constamment souligné l’exploit que mon travail de terrain en tant que pêcheur professionnel avait constitué.
Et Meyer Fortes. C’était très émouvant : j’avais beaucoup de sympathie pour son parcours du combattant en tant que juif à Cambridge (nous nous aimions tout simplement !). Un jour, quelques semaines avant sa mort, il m’a convoqué au King’s College pour me faire part très solennellement de son credo philanthropique en anthropologie, me disant que, en dépit des apparences, j’étais le seul à partager sa conception des études de la parenté et qu’il comptait sur moi pour poursuivre dans cette voie. Je lui ai souvent rendu visite durant ses derniers jours à l’hôpital, lui apportant de gros livres et de gros classeurs – au grand étonnement de sa famille qui s’était réconciliée avec le fait qu’il était mort de fait.
D’autres amis étaient la très âgée Audrey Richards – qui me racontait des anecdotes très personnelles sur Malinowski qu’elle avait espéré épouser un jour. Également, Helena Wayne-Malinowska qui avait un point de vue de médecin-légiste sur son père. Je lui rendais souvent visite, elle m’a fait asseoir un dimanche midi à côté de quelqu’un qu’elle voulait que je rencontre (sans me dire qui il était, pour que ce soit une surprise), j’ai deviné après une dizaine de minutes qu’il s’agissait d’Arthur Koestler.
Synapse est un somptueux mensuel de psychiatrie d’inspiration lacanienne. Ils ont un jour publié une longue interview de moi, puis m’ont demandé de faire partie de leur conseil scientifique.
Le Journal du MAUSS (vous avez vu les deux numéros où j’avais un papier sur la formation des prix) est une revue de gauche qui publie essentiellement des sciences politiques et économiques. C’est une revue de très haut niveau, c’est le genre de publication dont les numéros seront réédités dans une cinquantaine d’années parce qu’il y a une forte densité de gens qui vont devenir des vedettes dans les sciences sociales. Ils m’ont approché pour la première fois en 1986 lorsque mon article « Reprendre à zéro » dans le numéro du 25ème anniversaire de L’Homme (publié simultanément en livre de poche) a fait scandale (mon article avait été commandité, puis refusé, puis accepté à nouveau, etc. à plusieurs reprises). Un peu plus tard, ils ont organisé un débat public entre Dan Sperber et moi-même sur le relativisme culturel. Après cela, ils m’ont proposé une chronique, puis m’ont finalement appelé au conseil d’administration. En mai, ils m’ont à nouveau opposé dans un débat public à un spécialiste de l’économie selon Aristote, en raison de ce que j’avais brièvement mentionné dans le papier que vous avez lu. Ce Monsieur ne comprenait rien aux mathématiques grecques et il a été facile de démontrer qu’il avait tout faux (je me souviens vous avoir rencontré pour la première fois juste après avoir acheté quelques livres sur ce sujet pour affiner mes arguments).
Je pense qu’il y a là réponse à tout ce que vous m’avez demandé (et un peu plus).
Armel et moi arriverons à San Diego le 21 décembre à 17h41 (TWA 99). Je devais décider si je passerais plus de temps à discuter d’anthropologie et de la vie en général avec Lilyan et vous à La Jolla, ou de finances à Houston [P.J. j’y étais alors employé par un hedge fund], et j’ai opté pour la première solution ! J’espère que vous êtes d’accord. Nous partirons donc tous les deux le 2 janvier.
Mes meilleurs vœux,
Traduit par DeepL
Laisser un commentaire