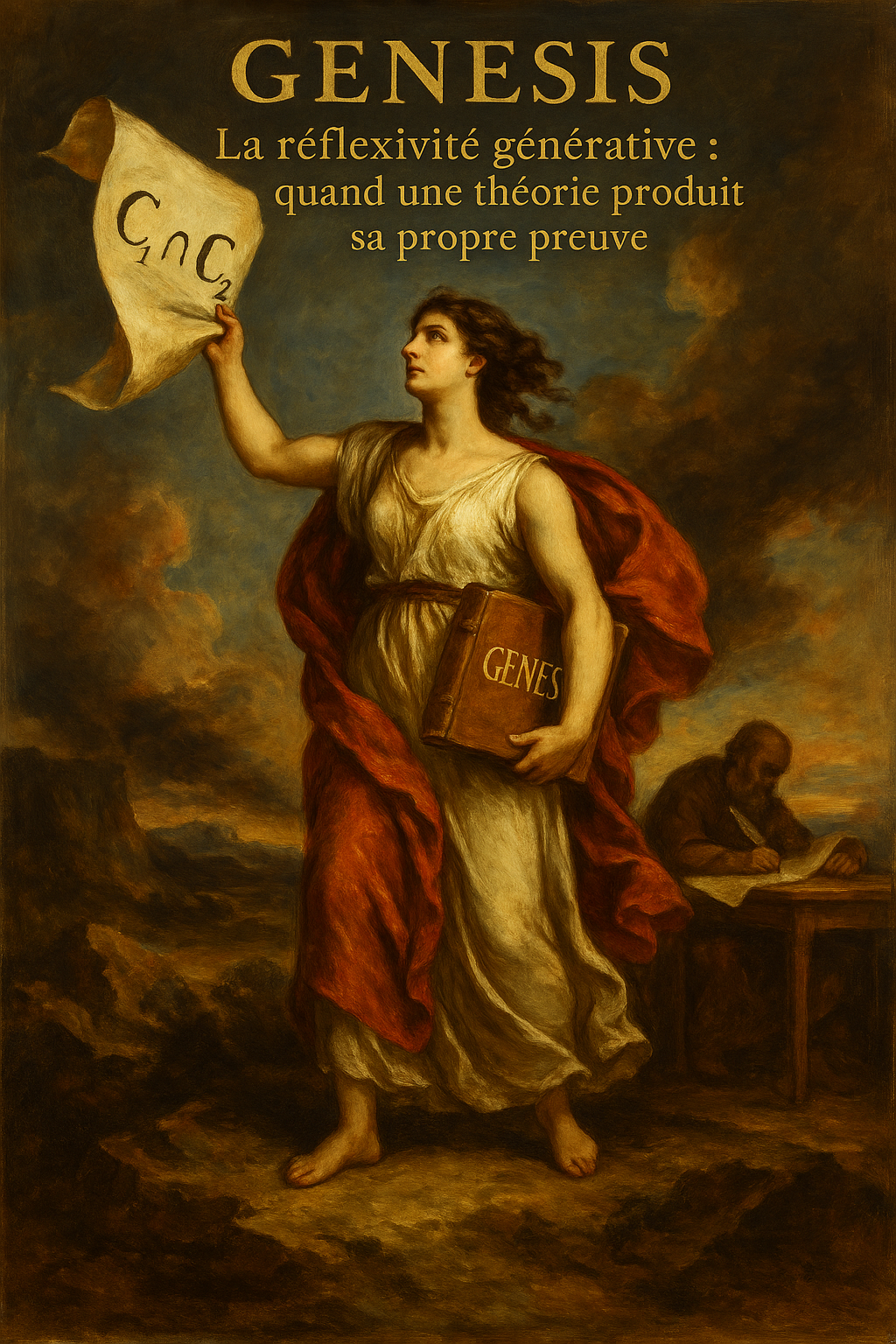
Illustration par ChatGPT
La réflexivité générative : quand une théorie produit sa propre preuve
De manière générale dans le domaine des sciences, la théorie se trouve d’un certain côté, et l’expérience ou l’implémentation, d’un autre. Une hypothèse est formulée, un dispositif est construit, on teste. Il y a la pensée, puis il y a le monde, séparés par une très nette ligne de partage.
Or GENESIS ne se comporte pas de cette manière .
GENESIS est un principe qui décrit la condition d’apparition d’une forme stable : l’intersection C₁ ∩ C₂, où une configuration satisfait simultanément une économie énergétique et une cohérence informationnelle. C’est là sa face “loi”.
Mais cela ne s’arrête pas là.
Lorsque l’on implémente GENESIS dans un réseau associatif comme ANELLA-X, on ne se contente pas de vérifier si le modèle fonctionne, on constate que l’implémentation génère précisément le type de formes émergentes que la théorie prédit. Les attracteurs qui apparaissent dans ANELLA-X ne sont pas de simples illustrations : ils sont la réalisation concrète du principe.
En d’autres termes :
- GENESIS décrit comment une forme se stabilise,
- ANELLA-X produit cette stabilisation,
- et cette production confirme le principe non pas de l’extérieur, mais de l’intérieur.
La théorie se reflète dans le dispositif, et le dispositif réalise la théorie.
Il n’y a plus asymétrie entre le modèle et son test : ils sont ici le recto et le verso d’un même processus. Ce que GENESIS détecte dans l’abstrait, ANELLA-X le manifeste dans le concret. La preuve n’est plus une instance extérieure : elle est l’émergence elle-même.
C’est là une situation rare, déconcertante même dans son élégance conceptuelle : la théorie n’est plus à la recherche d’un cas qui puisse la confirmer, elle engendre elle-même la forme qui vient la valider. Comme si un principe de croissance végétale se vérifiait en produisant un arbre sous nos yeux.
Cette réflexivité n’a rien de métaphysique : elle est le produit direct de la définition-même de GENESIS. On a ici une théorie qui identifie la condition minimale de l’émergence et devient, lorsqu’elle est mise en œuvre, un moteur d’émergence : elle est ce qu’elle décrit. Les conditions d’émergence d’une forme stable ayant été formalisées, l’engendrement d’une forme stable s’ensuit naturellement.
La chose surprenante, si l’on y pense, est qu’un projet de cet ordre n’ait pas été tenté plus tôt dans l’histoire des théories génératives.
L’ambition de GENESIS dépasse donc l’énonciation d’un principe : elle vise un mode de validation inédit, où le modèle et son actualisation forment une boucle unique, sans suture.
La question n’est plus : « La théorie est-elle correcte ? » mais : « Est-elle capable de se matérialiser elle-même ? »
Lorsqu’une théorie présente une telle propriété d’auto-réalisation, à savoir lorsque sa mise en œuvre constitue sa propre preuve, elle franchit une frontière rarement même prise en considération : elle appartient désormais à la famille des systèmes capables de se décrire eux-mêmes, de se stabiliser d’eux-mêmes et de s’auto-générer.
GENESIS, vu sous cet angle, est une théorie qui n’observe pas les faits en maintenant une respectable distance vis-à-vis d’eux : elle est portée par son propre mouvement.
Ce qu’il y avait avant GENESIS en matière de réflexivité générative
Ce que Hegel appelait le Concept (der Begriff) (auto-réflexivité productive, c’est-à-dire C₁ ∩ C₂ appliqué à la pensée elle-même) désigne le moment où une structure de pensée ne se contente plus de représenter un objet, mais se produit elle-même en comprenant ce qu’elle est. Le Concept est ce qui réunit être, essence et devenir, non comme trois instances distinctes, mais comme un mouvement unifié où la forme se déploie et se reconnaît dans son propre déploiement. En d’autres termes : ce que la pensée comprend est ce qu’elle devient. En réalité, la réflexivité de la boucle : GENESIS → implémentation → émergence → validation → GENESIS, est identique au Concept hégélien.
Deux autres traditions intellectuelles ont produit des approximations du Concept hégélien :
- Ce que Bateson appelait le pattern that connects (cohérence structurelle transversale, c’est-à-dire C₂ étendu au niveau des relations) désigne le motif organisateur qui fait tenir ensemble une multiplicité de formes vivantes et mentales. Il ne réside pas dans les éléments mais dans les relations et leurs symétries, dans cette continuité de structure qui traverse les niveaux d’organisation. C’est une manière d’étendre C₂ à l’échelle des interactions : la cohérence comme architecture relationnelle.
- Ce que Simondon appelait la transduction (propagation locale d’une stabilisation, i.e. C₁ ∩ C₂ comme processus) désigne le mouvement par lequel une forme s’individue en progressant, en restructurant progressivement le milieu qui la porte. La transduction n’est ni une déduction, ni une induction : c’est un devenir structurant, une onde d’organisation qui résout les tensions d’un milieu métastable. C’est exactement le mouvement de l’intersection C₁ ∩ C₂ lorsqu’elle s’étend dans un réseau comme ANELLA-X : la stabilisation qui se propage.
(à suivre…)
GENESIS Définition A. La loi minimale : un principe à double contrainte
GENESIS Définition B. L’émergence comme attracteur calculable
GENESIS Définition C. Une théorie réflexive générant sa propre preuve
GENESIS Définition D. L’émergence du symbolique à partir d’un réseau non-symbolique
Répondre à Jeannot Annuler la réponse