Billet invité.
Depuis longtemps déjà, les linguistes (1) écartent l’hypothèse selon laquelle notre mot pour « travail » dériverait de la forme nominale « tripalium » : un instrument de torture utilisé par les Romains et que le manuscrit du Concile d’Auxerre (582) produit encore sous la forme de « trepalium » ; quant à la forme verbale supposée, « *trepaliare » elle n’a jamais été rencontrée. L’échange d’un « e » pour le « i » de « tripalium » pourrait justifier le treballar catalan, mais ne rendrait pas compte de la série de transformation en « a » pour les autres langues romanes – travailler (fr.) trabajar (esp.) travagliare (it.) trabalahar (port.). Pour rendre compte du « a », Walter von Wartburg -1932 – écartait le « tripalium », avancé par quelques prédécesseurs, et privilégiait l’origine dans le latin « trabes » (poutre), lequel donnera par la suite le « trevail », soit la machine consistant en l’assemblage de deux poutres parallèles (la travée), laquelle servait à entraver bœufs et chevaux lors du ferrage. Si le treballar catalan ne peut être relié aux souffrances du tripalium, l’étude de ses usages morpho-syntaxique en catalan médiéval montre assurément son affinité avec certaine formes de pénibilité. De plus, d’une façon générale, la recollection de von Wartburg (2) atteste que vers les 12e et 13e siècles, les formes lexicales associant « travail » et l’une ou l’autre forme de douleur sont abondantes. La présence d’affects négatifs anciens attachés à la notion de travail est donc manifeste, il suffisait aux linguistes de puiser dans le répertoire des « poutres ecclésiastique » de « trabécule / trabéation » (en référence à la toge de cérémonie ornée de poutres), mais aussi à la « poutre de gloire » (trabes doxalis) laquelle sanctifier l’origine païenne d’une consonance doloriste bien venue, quitte à s’emmêler les pieux restons utiles.
La « tripaliation » savante comme la reprise par le trevail vernaculaire rechargeait les affects hérités sur des signifiants neufs qui tout en étant phonétiquement voisins, sont sans filiation directe avec les précédents. Que ce nuage d’affects était lié depuis longtemps à tout un réseau de signifiants dont la résonnance indo-européenne saute aux yeux :
laBoR(latin.)
aRBei(t) (allemand)
RaBo(t) (russse.)
(t)RaBajo (espagnol)
(t)RaVail ( français)
…
(d)aRBs (letton)
Le couple de voyelles R-B(V) forme la racine indo-européenne « orbh », de laquelle dérive, par exemple, le grec orphanos (orphelin). De même, selon Pokorny – Indogermanisches Etymologisches Woerterbuch (3)- les langues slaves et germaniques présentent deux séries parallèles en R-B désignant le travail, l’esclave tel le slovène « rabôta » ( servage ) mais aussi comme en vieux russe, lorsque les diminutifs robu , robja, robjata signifient autant enfant que travailleur. « Erbe (al.) (héritier ), heir (ang.) vient égalment s’ajouter à ce champs sémantique.
Ces liens sont généralement « expliqués » par le fait que les orphelins étaient affectés à des tâches ingrates et seulement rattaché à la communauté par dune relation de servitude. Plus en amont encore, Michael Weis (4) – latin Orbis and his cognates,Cornell University – , au terme d’une étude serrée, rattache la racine indo-européenne orbh à une racine proto indo-européenne cette fois, laquelle correspondrait tout simplement la notion de « cercle » jusqu’au latin (orbis) cette racine se serait clivée en deux branches la première liée au travail agricole, et la seconde à l’idée de retournement et/ou d’exclusion dans le processus d’héritage ou d’ « orphanage ». Reconnaissons toutefois que les mots servant à rendre compte des situations d’esclave et d’orphelin peuvent à toute époque, fixer des affects moroses.
Michael Weis, (conclusion de l’étude)
§
Pourquoi cette mise en spectacle du « tripalium » mille fois répété jusqu’à l’obscurantisme ? N’avons-nous pas affaire à une étymologie-écran ? Sans raison qui lui serait extérieure, le travail serait à l’image du tripalium : « faut faire avec ». Faire croire que la pénibilité serait une propriété du travail et non pas le produit d’une organisation sociale particulière, garantit quelque peu la tranquillité des classes sociales qui se nourrissent d’un mode de domination par réduction du « labor » au « travail », du « werk » à l’« arbeit ». Comment, au centre gauche, aujourd’hui sous nos yeux, une bande de borgnes roués tente-t-elle encore d’accrocher nos affects à la forme sonore « la société du care ». Depuis un demi-siècle, cette gauche politique et syndicale « cassolette » avec la droite, et laisse creuser la dette afin de participer à la redistribution du budget de l’état, entre soi entre amis, ne remet rien en cause de l’organisation du travail et laisse le capital déplacer le curseur de répartition du surplus par l’introduction des stock options. L’effort de la gauche fut de contrer la pénibilité du travail par la promotion du pouvoir d’achat et les loisirs de compensation, mais – grand dieu ! – , sans jamais proposer un monde ou chacun puissent faire œuvre de sa vie sans avoir besoin d’eux . Que feraient-ils d’autre ces redistributeurs qui de gauche comme de droite nous ont sucré quarante années sur le thème « l’écologie c’est pas sérieux c’est destructeur d’emploi » ? Comment oublier ces 40 années d’immobilisme devant l’impasse de la retraite, calculée depuis longue date, mais laissée au repos dans les cartons ? Sans doute attendaient-ils que nous fussions en état de recevoir l’allocation de lange vieillesse plutôt que de prendre le risque de nous voir descendre dans la rue les prostates encore vives. Rien ne fut entrepris pour que le travail fût joyeux et non, qu’au bout d’une vie de souffrance au travail, les chevaux fourbus réclament leur mise à la retraite et que les plus jeunes ne se suicident de ne pouvoir jamais y arriver. Nous sommes, une fois de plus, orphelins. La prochaine fois qu’on s’occupera de refaire tourner l’économie, essayons de ne pas nous faire avoir juste pour le plaisir d’être ainsi dominé ! Ecce, article 1.
(1) Voir par exemple, Marie-France Delport, « Trabjo trabajae(se) », Etude lexico-syntaxique, Cahiers de linguistiques médiévales, Klinsiek ,1984.
(2) Walther v.Wartburg, FranszÔsishe Etymologishes Worterbuch, Eine dartstellung des galloroamisschen sprachschattzes Lieferung Nr.101/102, Band XIII / 2. Teil, Klincksieeck,
1965. – trabs, pp 135-139 , – *tripaliare pp 287 -291 – tripalium pp 291-292
(3) Pokorny – Indogermanisches Etymologisches Woerterbuch
(4) Michael Weis – latin Orbis and his cognates, Cornell University
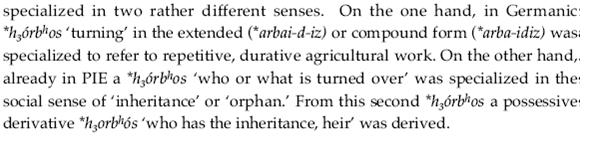
149 réponses à “Le travail, par Jean-Luce Morlie”
Pour avoir fait partie de ces milliers de gens qui ont cru (et expliqué à d’autres) cette étymologie suspecte, je vous remercie de cet éclaircissement. La mise en rapport entre le langage et le fait politique est toujours éclairante.
on peut aussi solliciter de références bibliques « tu travailleras à la sueur de ton front ».
Plus sérieusement, le travail, pénible ou non, reste la seule source de richesse, la seule chose qui s’offre à l’échange.
Dès lors, la monnaie elle-même représente du travail, son pouvoir d’achat répond à tant de travail réalisé en échange de l’obtention de tant de monnaie (le prix).
Plus encore, dès que la monnaie ne circule plus, c’est du travail gelé qui ne s’échange plus, puis qui ne se fait tout simplement plus.
Dès que l’on ne manie plus le fouet de l’esclavage, le travail ne peut se faire qu’en échange d’un salaire, une sorte d’ »indemnisation » pour céder une part ou tout de son travail.
La précarité et le côté éphémère du travail n’imposent-ils pas que la monnaie soient aussi éphémère et précaire? Précisément le SMT!
Une monnaie susceptible de se transformer en capital rentier impose en face l’esclavage et enlève toute « joie » au travail, pénible ou non.
Je remercie Monsieur Jean-Luce Morlie d’élargir ainsi le débat.
La précarité du travail…. C’est ce contre quoi luttent les syndicats…. dommage pour la monnaie fondante.
Merci, les RoBots n’ont pas le talent de dévoiler le savoir de la langue.
La réponse au – travail – est résumée ici dans cet extrait pris dans la chronique de Philippe Béchade du 17 mai 2010
Voici en guise de conclusion un petit extrait du best-seller Atlas Shrugged [« La révolte d’Atlas », NDLR.] d’Ayn Rand, l’égérie d’Alan Greenspan. A noter que ce texte est paru en 1957 et non pas en 2007 !
« Lorsqu’on constate que le commerce se fait non par consentement mais par compulsion — lorsqu’on constate que pour produire, il faut auparavant obtenir la permission d’hommes qui ne produisent rien — lorsqu’on constate que l’argent afflue vers ceux qui dispensent non des biens mais des faveurs — lorsqu’on constate que les hommes deviennent plus riches par la subornation et les pressions que par le travail, et que les lois ne vous protègent pas de tels hommes, mais les protègent au contraire de vous — lorsqu’on constate que la corruption est récompensée et que l’honnêteté devient un sacrifice — on sait alors que la société est condamnée ».
Je conclue que c’est le travail qui crée le progrès technique et que c’est ce dernier qui libère d’autant de la pénibilité du travail. Donc toute notre condition physique ici bas dépend du coefficient de progrès appliqué et accessible au juste prix (le vrai coût de production).
Je l’ai dit très souvent, la question n’est pas: peut-on payer tel bien ou tel projet? Mais: a-t-on les compétences pour le produire et peut-on le produire physiquement? Si c’est non et bien les choses rentrent dans les cartons, et on verra plus tard. Si c’est oui, alors pas de problème particulier pour le réaliser. En particulier pas de problème qu’une société compétente avec les resources, les compétences et les moyens de produire ne puisse pas créer ce qu’il y a d’infiniment plus facile à faire que de produire industriellement, c’est à dire créer la monnaie nécéssaire et correspondante à la production de ce bien ou de ce projet. Il est bien moins difficile de financer que de produire des biens concrets (financer est un jeu, certes très sérieux, honnête et à adapter, mais jeu d’enfant quand même) vu les expériences et la maîtrise de la complexité industrielle qu’il a fallu acquerir au fil des générations et pas autrement pour produire tous les biens dont nous nous servons. Exemple entre milles autres, je connais un tout petit peu l’aviation, un avion actuel contient 120 ans d’expériences et de progrès industriels.
Ayn Rand… l’égérie de tous les anarcho-capitalistes (c’est encore un cran au dessus des minarchistes, qui sont eux même un cran au dessus des libertariens favorables à un Etat « veilleur de nuit ».
Bref Ayn Rand c’est l’antithèse absolue de « l’esprit » de ce blog. On a rarement fait plus hostile à la démocratie, par essence corrompue pour A. Rand (ne vous y trompez pas ce n’est pas la corruption de la démocratie qui visée que la démocratie elle-même).
Le passage que vous avez cité sert en particulier à justifier le principe d’appropriation des ressources « premier arrivé premier servi », l’idée étant que les ressources naturelles, à l’origine, n’appartiennent pas à tous en commun (sans quoi il faudrait demander la permission des improductifs), mais à personne, et sont donc librement appropriables par la première compagnie pétrolière venue, entre autres…
Réfutée par… Nozick, qui y a consacré un assez long article, dans un article intitulé « On The randian argument », republié dans « Socratic Puzzles » et (pas trop mal) traduit en français ici (par un théoricien acquis au néolibéralisme le plus dur):
http://herve.dequengo.free.fr/Nozick/Nozick2.htm
NE TRAVAILLEZ JAMAIS
Je comprends : « ne travaillez jamais pour l’organisation dominante, mais contre elle, pour construire votre vie. »
Je ne travaillerais pas contre une organisation (on s’y cassera les dents, tout seul), ni pour une organisation (je ne suis le laquais ni le sherpa de personne), je ne travaille que pour moi – et sa paye!
« Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front ». Nos gauchistes en condamnant le travail reprennent une vieille attitude chrétienne. Le travail ne mérite ni cette excès d’honneur , ni cette indignité car le travail est une activité que possède en commun l’homme et l’animal . Le travail c’est la présence en l’homme et en l’animal de la volonté de vivre, la détermination de ce qui existe par ce qui n’existe pas et le mépris aristocratique ou des sociétés de l’ancien régime envers cette activité brutale et naturelle a pu ainsi se justifier et réservée aux serfs ou aux esclaves.
Cependant à la différence de l’animal l’homme a fait – peu à peu et puis depuis la prise de pouvoir des commerçants de plus en plus vite sur la société – de son activité vitale un objet d’échange et l’histoire de l’homme est l’histoire de la suppression du travail par l’échange et la joie qui accompagne le jeu de cette suppression .
Cette activité est pour qui sait y regarder la caractéristique de l’activité des maîtres modernes, les commerçants, et c’est un des principaux but de l’existence de la croyance actuelle appelée Économie de masquer sous des tonnes de prétextes utilitaristes les profondes jouissances éprouvée par nos commerçants à pratiquer cette suppression de l’activité que nous avons en commun avec les animaux. Le riche moderne ne jouit pas du tout de ses revenus comme veut nous le faire croire la publicité commerciale, il peut même apparaitre comme simplement avare car sa véritable activité est – qu’au moyen du Kapita – son plaisir réside surtout dans le monopole qu’il s’est réservé de pratiquer l’activité humaine fondamentale -de suppression infinie de notre dépendance à la Nature – à la place de l’humanité elle-même. C’est pourquoi il laisse les gauchistes vitupérer
Activité ne vaut pas travail. Il y a entre les deux un monde civilisé, réducteur par le droit de propriété d’y glaner et d’habiter ou bon vous semble.
L’animal y exerce une activité prédatrice génétiquement programmée dans le but de sa survie et sa reproduction.
En contrepartie du droit de propriété organisé, ll faut bien que la société subvienne aux besoins essentiels de sa population par l’exploitation reglementé du travail commun. Qu’il soit bénévole ou rémunéré.
Il me semble que la frontière travail/rémunération sera de plus en plus perméable, la valeur travail/production matérielle/gain de productivité/salaire n’est plus qu’illusion.
Est-ce que l’activité locale de l’abri habitat et du couvert (on ne va quand même pas manger avec ses doigts) redeviendra l’activité essentielle le travail salarié devant être partagé entre tous.
C’est ce que je dis : le « tu gagneras ton pain à la sueur de ton front » c’est le début du bourrage de crâne !
Personne ne devrait « gagner sa vie » puisque la vie nous a été donnée !
La vie ne devrait pas se résumer à courir en permanence pour obtenir 3 sous, acheter son pain du jour et recommencer le lendemain !
Surtout que cela ne sert en fait qu’à engraisser quelques uns qui se fichent bien de nous !
Quelques uns qui ont mis au point des machines infernales pour tirer le maximum de profit de tout et de tous.
Quelques uns qui se rendent coupables de crimes si grands et si odieux que le commun des mortels n’arrive pas à en prendre complètement conscience.
C’est comme le mensonge : plus c’est gros, plus ça passe, dit-on.
Là c’est pareil.
Plus il y a de morts par famine, épuisement, pollution, écoeurement (suicide), guerre, plus la planète est polluée, l’eau, la terre, l’air et plus les gens croient que c’est par le travail qu’ils arriveront à s’en sortir, à échapper au sort qui a été défini par les quelques uns : être les esclaves des machines infernales de la phynance.
Pire, ceux qui croient que, en se retirant de ce monde de profit et de compétitivité, ils arriveront à s’en sortir, font fausse route.
A un moment ou à un autre ils seront rattrapés .
A un moment les efforts qu’ils ont entrepris pour ne plus consommer, pour ne plus dépendre du travail vont être réduits à néant.
Car à force de réglementations de plus en plus contraignantes, d’impôts ou de taxes sur ceci ou cela, ils seront obligés de céder ou d’abandonner leurs maigres biens.
Certains se croient ainsi à l’abri, parce qu’ils ont une petite maison, un jardin et quelques poules.
Ce n’est que reculer pour mieux sauter.
Les quelques uns trouvent tous les jours de nouvelles manières de ponctionner le peu qui a été mis à l’abri.
Car leur appétit est insatiable.
Il ne peut y être mis fin qu’en supprimant l’objet même de leur envie, de leur désir : ce qu’on appelle l’argent, la richesse, l’accumulation de biens matériels, la fortune.
Les supprimer eux-mêmes est une option que certains commencent à trouver raisonnable, mais ne résoudrait rien si nous laissons d’autres pareils à eux prendre leur place.
Il faut rendre l’accumulation de biens impossible.
Mais il faut aussi repenser la façon dont les choses peuvent s’échanger, la vie en autarcie est possible mais c’est du chacun pour soi et tant pis pour les autres.
Et là se poser la question de ceux qui n’ont rien.
Que leurs bras.
Et parfois même pas.
M. Jorion nous dit qu’il faut passer par une période de transition pour arriver à créer un monde où l’exclusion quelle qu’elle soit n’existerait plus.
Avons-nous déjà commencé à transiter ?
Un certain nombre peut-être grâce aux échanges sur ce blog ou d’autres du même acabit.
La conscience de l’iniquité de ce qui se passe aux plus hautes sphères des instances dirigeantes commence à apparaître chez de plus en plus de gens.
Mais là un autre danger se profile, comment tenir « les troupes » lorsqu’elles sauront enfin au plus profond d’elles mêmes qu’elles se sont laissé embarquer dans une histoire pareille ?
C’est à dire qu’elles ont participé au plus grand génocide de l’histoire ?
Génocide perpétré sur tout le vivant .
Donc comment faire comprendre que nous ne sommes plus dupes de quoi que ce soit ?
Comment faire comprendre de l’urgence de la situation ?
Comment faire comprendre que si ils veulent éviter de se retrouver la tête sur une pique, comme au bon vieux temps, les quelques uns doivent fournir au plus vite une feuille de route crédible ?
La technologie peut-elle nous aider ?
Un truc du genre : vous n’ètes pas d’accord avec cette vie alors déposez une cocotte en papier devant les mairies, l’Elysée et tous les ministères ?
A faire passer dans tous les réseaux, ça peut se faire en combien de temps ?
Y en a beaucoup qui savent faire une cocotte en papier ?
On peut faire passer un modèle ?
Plus parlant qu’une grève générale ?
Plus facile à mobiliser ?
Complètement idiot non ?
Mais comme je vous l’ai dit plus c’est c… plus ça passe………
d’accord avec vous.
bonjour,
œuvre plutôt que travail, voilà qui est réjouissant.
Mais pour revenir à la linguistique, à quoi rattache-t-on le travail de la femme en couche ?
Probablement au tripalium sur lequel on l’attachait en position de parturiente …comme sur une table d’obstétrique.
Suggestion à vérifier chez Pline.
Vous accouchez de drôles d’idées.
bonjour Paul,je suis venu vous voir a quimper car je vous suis à travers tous les médias .j’aurais tant voulu vous parler directement mais à mon arrivé , j’ai été tétanisé par la moyenne d’age de l’assemblée .j’ai oublié le message auquel j’aurais tellement voulu vous faire parvenir.je viens juste de m’en rappeler. vous ne vous rendez pas compte du décalage,entre vous et la majeur partie de la population, sur la compréhension de comment fonctionne l’économie mondiale.depuis 4 ans je passe un temps fou car cela me passionne,et même mon amie qui partage ma vie et cette passion ,est larguée.même si cela peut vous paraitre ringard simplifier votre discourt pour que tout le monde puisse agir,encore beaucoup de regret.merci.
Bonjour,
« travailleur », « orphelin » même racine etymologique, mais logiquement « esclave » devrait aussi descendre de la même racine ou famille de mot ?
Cordialement
De sclavus ou slavus.Latin XII°s.
Les slaves étaient nombreux réduits en esclavage en Germanie puis la Venise médiévale.
(cf Robert etymologique)
en russe, ia rabotaiou, c’est je travaille,
slovo , slova, c’est un mot, les mots, clavacatchiétanié, groupe de mots, sinon il y a aussi clava, la gloire, na clavou, à merveille
Pour le mot esclave, a l’école on m’avait parlé de menottes faites d’un fer tordu en forme de « S », traversé par un grand clou (clavo en espagnol d’après le prof). un peu comme cela: $ soit un « S »cloué ou bien « S » clavo
Bonjour
Timeo rhetorici doctores et dona ferentes!
Il est intéressant de voir jean Claude Werrebroucke nommer ces gens: entrepreneurs politiques. En y songeant bien c’est assez juste: à partir du moment où la politique devient un métier ( cf F.Mitt.) qu’il y aurait il d’anormal dans une société désormais marchande à ce que ce métier s’exerce au sein d’une entreprise?
Nous avons donc deux grands types d’entrepreneurs politiques: ceux qui font leur chiffre d’affaire en vendant à un cheptel d’électeurs des emplois subventionnés et des loisirs , l’autre grand groupe vend des réductions d’impôts à son cheptel…
Merci pour la dissipation de faux sens et de songer à passer du travail à l’oeuvre!
labeur mène aussi au laboratoire qui conjugue le labeur et la prière!
la main et l’esprit: nous rejoignons là Bernard de Clairvaux!
Cordialement.
Merci Steve
OK avec le labo …et le reste.
à l’opéra
C’est la vision que Chomsky pour les US Corporate america avec une section politique a deux branches .
Le sens physique du travail élargit l’horizon en neutralisant la subjectivité qui est en général associée au travail. On pourrait l’énoncer ainsi: Toute action est travail.
On peut compléter par la forme retournée de « la fin justifie les moyens », c’est à dire par « les moyens justifient la fin », ou autrement dit « toute action a des conséquences », quoi qu’on en pense.
Comme « faire travailler son argent », par exemple…???
Le jour où vous verrez un billet transpirer, faites-moi signe.
à Yvan,
Quel jeu de jambe dans la réplique! Mais l’expression « faire travailler son argent » tente en effet sans doute de cacher que l’argent ne fait rien et que s’il ne travaille pas on ne voit pas pourquoi il pourrait rapporter autant. Bien vu.
« À moins de se fonder sur un compromis et une flexibilité permettant à l’homme travaillant de se valoriser intellectuellement, professionnellement, sentimentalement, familialement et socialement, tout en lui procurant un salaire lui permettant une vie matériellement comblée sans endettement permanent, le travail est un vol du temps, une vampirisation de la vie de l’employé par l’employeur. Car la vie d’un homme sur terre n’est autre que le déploiement temporel de son existence. Imposition pesante de la vitesse de la société de consommation, le travail, avec sa précipitation productive, triture le temps par l’urgence et l’immédiateté. Et le temps bourgeois, en devient un antitemps – c’est-à-dire un harcèlement constant, enfonçant le temps du travailleur dans l’exclusivisme temporel du présent par et pour la productivité, l’abîme de l’instant à rentabiliser par la production. Ce qui fait de l’homme, l’être du maintenant, et sacrifie toute la vie à la pression de l’urgence, à l’exigence de la performance… C’est littéralement le règne sinistre de l’adage « le temps c’est de l’argent » proclamé par le capitalisme. »
http://www.legrandsoir.info/Le-travail-cette-expropriation-systemique-du-temps-humain.html
Le travail rend libre de se résigner à la domestication
et plus vite que ça
D’ailleurs la gauche ne se vante t’elle pas d’avoir obtenu le « droit AU travail » au lieu du droit au repos.
Elle obtint la portion congrue sous la forme des congés payés en 36..
« Le droit au travail participe à la dignité de l’être humain. Il a été affirmé pour la première fois, en 1848, par la IIe République qui créa, dans cette perspective, des Ateliers nationaux permettant de fournir un travail aux chômeurs. Ce droit au travail a été repris dans le préambule de la constitution de1946 , qui affirme : » Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi « , et par notre constitution actuelle… »
Hé hé hé. Finement rappelé, Tartar.
Le droit au travail est en effet un des points peut-être pas des Droits de l’Homme originaux, mais en tout cas d’une éventuelle reprise commerciale de ceux-ci.
Il est maintenant évident que toute mise en commun de moyens permet de démultiplier toute action. D’où, bien évidemment aussi, l’utilisation par la puissance de l’argent de cette force.
Par contre, Tartar, si je parlais d’entreprise communautaire, nous aurions des points de vue… antagonistes, non?
Oui, les congés payés en 1936 : une bizarre victoire
avant la drôle de guerre, aussitôt suivie de l’étrange défaite
ont donné l’illusion d’accéder aux privilèges des véritables riches
et des patrons : pour quinze jours un mois, avant de retourner au turbin,
au taf, au boulot, au charbon, au chagrin et plus encore,
et comme ça, jusqu’à présent,
au chômedu
est-ce assez sophistiqué ?
Ce blog est un phare.
Faramineux…
Un phare de bull-dozer?
…Mais la tempête gronde…
Un « phare » breton ? hum …. c’est bon
Ouaich…
Ma femme rêvait de passer une nuit dans un phare un jour de tempête…
Encore fallait-il qu’elle sache ce qu’est un coup de tabac…
http://www.youtube.com/watch?v=m2LeNBY_5gk
Elle ne demande plus, maintenant.
@ Yvan
précision: la musique en fond est le requiem de Mozart
Merci pour ce précieux décorticage étymologique et pour cet étonnant emploi du mot « cassolette » très bien mitonné.
On pourrait relire Marx: Le travail doit son nom de travail parcque c’est une méthode d’exploitation que les romains nommaient esclavage. L’esclave « travaille ». Pas l’homme libre.
L’homme libre s’active, mais ne « travaille » pas…
En clair il domine son activité, pas l’esclave…
La noblesse n’avait pas pour valeur le travail, et pour cause! Cela ne voulait pas dire qu’ils n’avaient aucune activité utile.
Au fond l’origine du mot travail provient de son ultime réalité: L’esclavage moderne.
peut-être qu’avec Stiegler, le prolétaire (comme l’esclave …) travaille, alors que l’ouvrier (l’artisan, l’artiste, l’entrepreneur …) oeuvre
« Nous, petites abeilles de la ruche mondiale, sommes enrôlés de force dès l’enfance pour vomir à outrance notre force de travail et surproduire le miel de l’impérialisme capitaliste.
…
L’Homme du 21ème siècle est un esclave moderne, un produit de consommation robotisé vendable en permanence sur un marché, évoluant dans une immense machine qui le dénature et le dépossède de sa propre conscience, ce, sans en avoir connaissance évidemment. Par un devoir normatif d’obéissance aux institutions qui aliènent ses propres conditions d’existence, l’humain est devenu un gladiateur passif sans armes errant dans une immense arène, un camp de concentration à l’échelle de la planète où les élites pilotent ces institutions en toute impunité pour que l’état de dépendance énergétique et matérielle des dominés perdure indéfiniment envers les détenteurs de la puissance. L’esclave des temps moderne, contrairement à l’esclave de l’Empire romain, a l’impression de vivre un monde de libertés et de démocratie : il pense jouir librement de la démocratie et faire entendre sa voix alors que la délégation de son pouvoir à une classe politique oligarchique inamovible a toujours été instituée au service de la classe possédante et dans une perspective antidémocratique. Il pense recevoir salaire de sa participation à l’appareil productif de son entreprise là où il ne fait que vendre sa force organique de travail alors que la vraie valeur de son travail est exploitée, expropriée par l’entreprise par l’entremise des objectifs actionnariaux. Et la hausse de son salaire à mesure que la carrière professionnelle se poursuit est une manière d’acheter la paix sociale en donnant l’impression de liberté, une fausse marge de manœuvre permise par le pouvoir d’achat. Il pense être doué d’une conscience lui permettant d’être libre de penser par lui-même en même temps qu’il reproduit les codes qui lui ont été transmis par la socialisation (famille, école, amis, collègues de bureau etc.) et les médias pour l’adapter au système. »
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/la-globalisation-des-echanges-est-75539
Un livre de 1983 de Edward T. Hall La danse de la vie, Temps culturel, temps vécu dont le titre original est The dance of Life. Il examine le temps vécu dans les différentes cultures au travers de son expérience personnelle par des exemples et des anecdotes. La finalité est de militer pour la compréhension des autres.
Souvenir, souvenir…. ma prof d’italien du lycée (palmes académiques) nous faisait apprendre par coeur du Dante. Et si mes souvenirs sont bons, dans le passage de l’Enfer de la Divine Comédie il était dit Quanto è duro il pane altrui que j’ai toujours traduit pour moi par combien il est dur de gagner son pain quotidien chez les autres. Mais j’essaie de faire de ma vie une belle oeuvre. Dante Alighieri c’est 1265-1321 il avait déjà tout cerné.
Travail …. que voilà un mot porteur de sens , d’interprétations , de légendes , de confluences entre « pensé »voire « sensitif » et « réel » !
Il s’était écrit pas mal de choses intéressantes sur le blog de Jacques Attali lors de l’un de ses billets ( » Prendre son temps » du 14 juillet 2007 ) sur la notion de travail à la rencontre de temps contraint , temps de loisir , temps de travail , d’effort » personnel et/ou collectif , de « bon » temps …
Qu’est ce qui sublime l’effort , donne l’audace , le courage , l’espoir , l’envie de soi et des autres ?
« Il y a de la peine oisive et du loisir qui est labeur » D’Aubigné .
Mais l’éloge de la paresse , j’aime bien aussi …
Le dernier mot à Socrate , une fois de plus : Jamais trop .
L’idée vers laquelle tend ce billet à beau être réjouissante, le procédé employé me paraît quelque peu douteux. Un exemple simple, et hors cadre professionnel tant qu’à faire, suffit à remettre en question cette présentation:
On travaille son potager. Il n’y a dans cette activité aucune autorité capitaliste pour vous y contraindre, c’est même devenu un loisir pour bon nombre d’occidentaux. Pourtant, munissez-vous d’une simple bêche, et commencez de travailler la terre. Assez vite, l’effort produit devient douloureux. Et ce, non pas parce qu’un mode d’organisation sociale tend vers cela, mais bêtement parce que les muscles à l’effort se chargent d’acide lactique et autres toxines. Cette réalité me paraît difficilement contestable.
Disso, ne pas confondre souffrance et douleur. La seconde est passagère, et contre elle le cerveau produit des endomorphines, de sorte qu’elle apporte une part de plaisir. (Mais attention, on parle de douleur consentie !) La souffrance ça n’a rien à voir, c’est le contraire du bonheur de vivre, c’est subir quelque chose à quoi on ne peut pas consentir, même si ce n’est pas douloureux.
Merci Dissonance. Vous parlez d’or…
« Tu enfanteras dans la douleur » : Voilà bien un « travail » sur lequel l’égalité des sexes et le code du travail ne peuvent rien.
Donc travail=souffrance.
Consentie ou imposée…comme la tâche qui est un travail à effectuer dans un temps imparti.
Travailler serait un « devoir » , un don de soi à insérer dans le social et procurerait parait-il une « satisfaction du devoir accompli »…çà existe aussi..
« Mal de dent, mal d’amour » dit le proverbe.
Les financiers aussi ont de temps en temps une dent qui les « travaille ».
Mais eux se font rapidement soigner.
Au casino de la vie, là aussi, Il n’y a aucune égalité face à la roulette…..
je reviens du potager, et j’ai eu effectivement l’impression de travailler : il y avait des racines profondes à sortir, ça fait mal au dos ! Je me demande si les hommes peuvent faire autre chose que travailler, toutes nos activités sont du travail , que ce soit récréatif, rémunéré ou non, fatigant ou pas, intellectuel ou répétitif, peu importe. Il s’agit toujours de « gagner sa vie ». Même si elle nous est donnée, faut arriver à se maintenir, et en aucune circonstance ce n’est évident. L’histoire de l’humanité ça doit être un peu ça, tenir la nature à distance. Probablement c’est l’apparition du langage, et avec lui la conscience , qui a transformé pour nous la survie, puis la vie qu’on s’est mise à penser, en travail. C’est devenu un objectif permanent, s’extraire de nos conditions naturelles décidément trop hostiles. On s’est organisé pour . Et on a construit les civilisations avec cet objectif, qui est devenu un horizon indépassable: le Progrès. « Se rendre maitres et possesseurs de la nature ». Et voila le travail !
Dissonance, si, quelque part…
Tu n’iras donc pas acheter de légumes au supermarché. Tu fais donc une concurrence déloyale ainsi que du travail au noir qui ne rapporte rien à l’état…
Quand à la notion de PLAISIR, car je préfère parler de celle-là, il ne faudrait tout de même pas oublier l’œuvre accomplie ainsi que la satisfaction d’avoir « abattu beaucoup de boulot »…
(pauvres arbres…)
disso
On travaille son potager , personnellement je cultive mon potager
travailler la terre , pour moi , je prépare ma terre
je n’ai jamais traité le jardin de travail , mais plutôt de source de nourriture . ( sans pesticide , OGM etc ….. )
et parfois aussi de courbature 🙂
mais si, au lieu de bêcher, on paille…. plus de gaspillage d’acide lactique !
ceci-dit, par ici, on ne dit pas « travailler la terre ou le potager » mais « faire du jardin »…
il est clair qu’il y le plaisir de la tâche accomplie, celle dont nous voyons tenants et aboutisssants, celles adossées à un cycle naturel car nous sommes la nature. le plaisir dans l’effort car vient ensuite le relachement. le monde est en systole/diastole permanente…
d’autre part nous avons évolué et possédons la capacité d’avoir des robots, comme des tracteurs. ainsi que des ingénieurs géniaux.
nous avons besoin de tant de tracteurs, et nous nous les prêtons. une fois le quota construits, nous fermons l’usine ou la reconvertissons à fabriquer de l’huile pour les moteurs…
il est important d’aimer ce que l’on fait, l’aliénation commence à la chaine de montage, maintenant que nous savons produire en masse. chacun de nous ira donc donné quelques heures par mois aux chaines de montages résiduelles et inhérentes. tout le reste sera auto-suffisance, troc, commerce équitable!
le plus important c’est de faire des choses cycliques, car une boucle (de production) eh bien en bout de chaine ça se boucle, héhé.
i have a dream! that one day…
vous lire me fait beaucoup de bien, merci!
Ce n’est pas de cela dont parle Jean-Luc Morlie.
Il termine d’ailleurs pour exemplifier son propos en évoquant les suicides.
Que je sache personne ne s’est jamais suicidé pour avoir été jardiné dans son potager !
Il ne faut pas confondre la douleur temporaire occasionnée par un effort physique et les conséquences
d’un travail difficile pendant des années à la mine ou comme travailleur agricole dans des conditions difficiles.
D’autre part, et c’est je crois l’essentiel, le billet précise bien qu’il s’agit d’appréhender le travail en tant qu’objet social. C’est la dimension sociale du travail qui confère à celui-ci sa pénibilité, qui fait qu’elle est selon les cas acceptée, refusée, justifiée, contestée, radicalement remise en cause.
Or l’économie de laquelle participe le travail, est une dimension du social. La science, l’humanité ont acquis des trésors de savoirs qui permettraient de faire du travail autre chose qu’il n’est la plupart du temps aujourd’hui : une simple variable d’ajustement lorsque l’on est salarié ou un facteur de subsistance dans des conditions difficiles lorsque l’on vit dans un pays où les moyens de faire fructifier ces savoirs ne peuvent être mis en oeuvre. Il n’y a donc aucune fatalité à ce que le travail soit attaché à quelque souffrance.
Ou alors ce à quoi vous vous référez est une souffrance définie selon un mode existentiel.
Il est vrai y compris l’artiste peut passer par des phases de souffrance, de doute, avant de produire, d’accomplir un certain travail.
Mais ce genre de souffrance n’est pas du même ordre que celle produite par une organisation sociale donnée. C’est une souffrance qui s’inscrit dans un projet éthique, un projet de vie que l’on assume pleinement.
@PYD
« C’est la dimension sociale du travail qui confère à celui-ci sa pénibilité, qui fait qu’elle est selon les cas acceptée, refusée, justifiée, contestée, radicalement remise en cause. »
J’ai du fort mal m’exprimer, car c’est précisément ce que j’entends contester par l’exemple que je fournis. En l’occurrence, j’évoque une forme de travail débarrassée du contexte social incriminé mais qui demeure pourtant pénible. Le contexte social ne fait qu’ajouter à la pénibilité pré-existante jusqu’à la rendre insupportable, ce qui n’est pas du tout le propos de Mr Morlie.
Dissonance,
Je ne vois pas de contradiction entre votre constat à propos des travaux pénibles et l’exigence sociale, qui ressortit aux choix des types de travaux acceptables pour une société, ce qui in fine relève du politique.
Jean-Luc ne me semble pas constester la pénibilité de certains travaux, seulement il ne s’y apesantit pas car l’affaire est pour lui entendue, et c’est pourquoi d’ailleurs il appréhende d’emblée le travail sous l’angle social, car le social renvoie ici au politique, en tant qu’une société donnée accepte ou refuse, selon les moyens dont elle dispose, certains travaux. Et au titre de ces moyens il y a tout le leg de connaissances dont dispose l’humanité dans son ensemble. Il y a donc aussi un réel problème du partage et de l’accessibilité des connaissances pour tous.
Jean-Luc dit : »l’effort de la gauche fut de contrer la pénibilité du travail par la promotion du pouvoir d’achat et les loisirs de compensation, mais – grand dieu ! – , sans jamais proposer un monde ou chacun puissent faire œuvre de sa vie sans avoir besoin d’eux . »
Son propos est très clair : il faut se passer des travaux pénibles et des compensations afférentes !
Et je partage entièrement son constat à propos d’une gauche qui ne propose que des palliatifs au lieu de prendre les problèmes à la racine. L’humanité dispose d’une quantité phénoménale de connaissances qui permettraient à chacun de faire « oeuvre de sa vie » pour peu que seraient retenus les moyens adéquats.
Or le travail au potager, éreintant sans doute car c’est un travail physique, ne me semble pas s’opposer à ce qui relève de la vie en tant qu’oeuvre. Planter, prendre soin de ce qu’on a planté, puis manger les fruits de ses plantations, n’est-ce pas une satisfaction qui vaut bien quelque fatigue dès lors que l’on y prend du plaisir ?
N’est-ce pas une plaie de notre temps, une souffrance psychique, que la dissociation que tend à créer la société de consommation entre l’activité de production et l’activité de consommation ? (Stiegler auquel se réfère Timotia en parle très bien.)
Il existe des travaux pénibles, qui occasionnent de véritables souffrances, des travaux qui aliènent et endommagent des corps au point d’anéantir toute vie de l’esprit, ce sont ces travaux qu’il faut bannir, transformer, ou faire exécuter par des machines, si toutefois encore les emplois relatifs à l’utilisation de ces machines ne sont pas eux-mêmes aliénants.
Mais à trop vouloir ignorer le plaisir des corps en mouvement, avec y compris leur dépense physique, nous aboutirerions à une société où tout serait automatisé mais où les souffrances ne disparaîtraient pas pour autant car celles-ci seraient essentiellement psychiques à défaut d’être doublement physiques ET psychiques.
@PYD
Ce qui me paraît incongru dans la présentation de JL Morlie ne tient pas en une contradiction entre exigences sociales et pénibilité, mais dans l’ordre de préséance qu’il leur attribue. Je prétends que la pénibilité existe en dehors de tout contexte social, et que par conséquent l’amélioration de ce contexte, même si je ne nie pas l’effet favorable qu’il puisse avoir, ne peut toutefois pas suffire à éliminer la pénibilité, or il me semble justement que c’était le but visé par le propos qui nous fait débattre.
Vous proposez d’abandonner les travaux pénibles? Je n’ai rien contre, mais alors attendez-vous à un retour précipité à l’age des cavernes (et encore je suis optimiste sur ce point).
Vous proposez la solution technique comme alternative?
Je vous renvoie ici. Pour vous épargner une lecture exhaustive, voici l’objection que je fais: Il faut alors que la moindre entreprise artisanale se dote du budget de la NASA pour résoudre la pénibilité de certaines activités largement plus complexes que ce que peuvent gérer les machines-outils courantes – Un exemple me vient en tête à l’instant: Comment mécanise-t-on la pose d’un toit d’habitation (individuelle)?
@PYD bis
J’ajoute une nouvelle objection qui vient de m’apparaître:
Le texte de JL Morlie propose entre autres une critique des conséquences du Taylorisme, du Fordisme et du Toyotisme – et des modes d’organisation qui en découlent. Mais lorsqu’on oppose quelques objections quant à la manière dont est formulée cette critique, la réponse apportée est la suivante: Parmi les solutions possibles, il y a celle d’une nouvelle révolution industrielle.
C’est à dire que l’on suggère comme solution au problème évoqué ce qui est précisément à l’origine du problème. La boucle est ainsi bouclée, en somme… Il semble toutefois que cette démarche ne soit en fait qu’une fuite en avant supplémentaire.
@ Dissonance
Si votre toit doit être en ardoises, c’est la tuile effectivement pour automatiser. En revanche, si vous faites poser les panneaux pré-fabriqués en usine, étanches et parfaitement isolés qu’un futur proche nous amenait, cela devient tout de suite beaucoup plus simple. Il existe bien sûr à l’heure actuelle des objections techniques valides, mais elles ne le sont plus forcément dans un référentiel adapté.
J’ai tendance à rejoindre Pierre-Yves sur cette idée que la notion de progrès est le moteur de l’homme pour s’affranchir à terme de toute pénibilité dans l’exécution des tâches nécessaires. C’est aussi une des raisons du peu de cas que je fais des hypothèses décroissantes globalisantes (à opposer aux hypothèses décroissantes de transvasement : un peu moins de ceci, un peu plus de cela).
@Julien Alexandre
Et je persiste pour ma part à considérer que de miser indéfiniment sur le progrès technique pour répondre aux problématiques qui nous occupent ne permet que de déplacer le problème, pas de le résoudre.
Ajoutons encore que la mécanisation totale d’une tâche donnée implique nécessairement un coût énergétique supplémentaire, argument qui devrait en faire réagir plus d’un… Sur ce thème, le discours de Jancovici est lumineux – si j’ose dire – lorsqu’il évoque le coût énergétique de la mécanisation en « équivalent esclave », la conclusion est sans appel.
Il y a sur cette question un choix à faire. Prôner le progrès technique pour toute réponse, ce n’est ni plus ni moins que faire le choix de ne pas choisir, de continuer avec les mêmes vieilles recettes jusqu’à temps que la mécanique se grippe définitivement.
Je suis relativement surpris qu’autant d’habitués de ce blog, si prompts à fustiger cette attitude lorsqu’il est question de finance, ne fassent plus preuve de la même rigueur d’analyse lorsqu’il est question du travail. Le soucis étant que peut-être, il soit facile de dénoncer ce à quoi on ne participe pas, tandis que bon nombre d’entre nous travaillons, et qu’une critique objective du travail conduise par conséquent à notre propre auto-critique, forcément désagréable.
Dissonance,
Il me semble difficile de concevoir le travail indépendamment de la technique.
L’humain ne serait pas humain sans l’artefact, autrement dit l’outil sans lequel
il serait le plus faible des animaux. Avant même l’apparition de l’homo sapiens sapiens, l’espèce humaine
se faisait déjà forte d’économiser son énergie. L’homme de Néandertal connaissait les outils. C’est toute l’histoire de l’humanité que celle de la découverte et du perfectionnement des techniques pour libérer un surplus d’énergie physique, surplus d’énergie physique qui sera selon les cas, c’est à dire suivant les sociétés, et l’époque historique considérée, sera utilisée de façon spécifique. D’où l’idée que l’homme-artefact est aussi relatif à un certain type d’organisation sociale.
La question cruciale devient alors : y-a-t-il un type d’organisation sociale optimale pour l’association de l’humain et de la technique ? Se poser cette question permet sans refuser l’évolution des techniques d’éviter de poser l’idée de progrès de manière abstraite, de faire du progrès quelque chose qu’il faudrait accepter les yeux fermés.
Ma réponse est qu’il faut d’abord se situer dans une époque, définir les caractéristiques de notre époque et puis se demander si le système technique actuellement dominant est satisfaisant ?
Je rappelle qu’un système technique est l’association cohérente d’un ensemble de techniques, association qui a un rapport avec un système économique et une organisation sociale donnée. Par exemple, depuis un siècle le système technique dominant est axée autour de l’or noir, avec le moteur à explosion, l’industrie des dérivés du pétrole, l’industrie automobile. Pour faire court un système technique axé sur l’utilisation d’une source d’énergie non renouvelable avec ce que cela implique d’économie de la rente pour ceux qui s’approprient ces industries. A contrario, en toute hypothèse, un système technique qui serait axé sur l’hydrogène, ou même H2O, utiliserait une ressource quasi inépuisable, d’où une économie de la rente beaucoup plus difficile à mettre en oeuvre, ce qui favoriserait en retour un autre type d’organisation sociale.
Il découle de cette analyse rapide qu’il n’existe aucune fatalité à ce qu’il faille les compétences de la NASA pour accomplir autrement des tâches pénibles.
Depuis des dizaines d’années, comme l’on remarqué certains historiens des techniques, l’humanité a surtout perfectionné les techniques existantes, emblématique est à cet égard l’exemple de l’automobile. Celle-ci depuis qu’elle est fabriquée de façon industrielle (ainsi j’exclue l’automobile de Papin qui fonctionnait à la vapeur) intégrée au système technique du pétrole, via le moteur à explosion, lequel moteur on a préféré perfectionné plutôt que de lui substituer un nouveau principe, quand bien même d’autres solutions existent et mériteraient d’être développées.
Je ne développe pas, je vous renvoie aux analyses de Gilles, Simondon, Gras, et Stiegler qui ont traité abondamment la question des systèmes techniques, de leur évolution et des rapports directs qu’ils entretiennent avec l’évolution des sociétés.
Toujours est-il que le ou les systèmes techniques contemporains sont entrés en crise, sous l’influence conjuguée des crises énergétique, économique et sociale. Un peu comme dans le domaine financier le système technique actuel a atteint un degré de perfectionnement tel qu’il n’est plus en phase avec l’évolution des sociétés humaines. Le système technique actuel devient même une menace pour l’humanité.
L’exemple de la plateforme pétrolière au large de la Louisiane est à ce titre particulièrement frappant. Il est symptômatique d’un système technique arrivé en bout de course.
Ce type d’analyse me semble très intéressante car elle doit nous faire porter un regard critique sur la techno-science mais en même temps elle ouvre une nouvelle perspective. Elle laisse la place à un possible nouveau système technique, qui reste à invente, même s’il en existe d’ailleurs déjà certaines prémices. Celui-ci apparaîtrait peut-être plus simple en regard du précédent, car moins sophistiqué, mais par contre il serait beaucoup mieux adapté. Il n’y a donc pas à choisir entre le retour à l’age des cavernes et la fuite en avant d’un système technique, celui que nous connaissons actuellement, lequel, comme les précédents aura une fin.
Un discussion sur ces thèmes en avril 2008
http://www.pauljorion.com/blog/?p=509#comment-4257
Méfions-nous, de la surutilisation de la « justification technique » lors de la création de nouvelles formes de rente …par la CERTIFICATION (est-ce une forme moderne de la théologie?).
Recyclage de l’ascarel, un prix très élevé à la tonne (dioxine, mais uniquement s’il brûle) et pour la fonte du transfo c’est le même prix.
Recyclage de l’amiante (naturellement pour l’enlèvement du floculé c’est très cher, mais c’est justifié» par contre coût de l’ardoise d’ éterrnit, 50*50 de 20 à 30 ct d’euro pièce.
Coût d’un diagnostique technique (achat vente d’un bien immobilier entre 450 et 650 € de 2 à 3 heures sur place et déplacement compris, 1h de travail administratif (à la main) . Soit 4 heures, soit plus de 100 € heure.
Quelque soient les solutions techniques, nanotubes carbones ou autres, le couple dissocié hydrogène oxygène est dangereux, aussi le niveau d’exigence de sécurité sur toute la filière sera fixé par le premier groupe qui installera la première filière en bloquera l’accès aux entrants potentiels, c’est rationnel, compréhensible et humain. Les seuils de toxicologie sont fixés par les niveaux supportables de rentabilité économique des filières concernées, je me trompe ?
@ Pierre-Yves D. dit : 31 mai 2010 à 23:37
Notre civilisation industrielle s’est bâtie sur une utilisation intensive de matières premières non renouvelables (pétrole, gaz, charbon et métaux) dont entrevoit clairement l’épuisement.
Pour l’énergie, il est possible d’envisager de nouvelles sources (fusion nucléaire —> Projet ITER) mais pour les métaux la concurrence sera dure pour se les approprier sans avoir recours à la violence. D’où l’intérêt d’avoir des réserves financières et pas de dette.
Quant au mode de production, je crois nous sommes condamnés à nous tourner à jamais vers le mode capitaliste. Il autorise les grosses organisations seules en mesure d’atteindre un haut niveau de qualité et d’efficacité. Ce haut niveau est à la base du rendement de l’activité humaine et par là, à la base du niveau de vie auquel depuis toujours le commun des mortels a pris goût.
On peut aussi aspirer à vivre autrement, par exemple en recherchant du plaisir dans un haut niveau d’activité intellectuelle ou spirituelle. Dans ce cas, il faudrait consacrer de gros moyens afin d’opérer une reconversion de l’homme. Davantage de spirituel et moins de matériel, c’est aussi une voie de sortie.
Jean-Luc Morlie
En vous lisant je me rend compte que mon exemple n’était sans doute pas bon.
Mais ce n ‘était qu’un exemple. Rien ne peut exclure que d’autres systèmes techniques se substituent au systèmes techniques actuels, ou actuellement concevables en théorie, y compris des systèmes techniques qui bien que basés sur d’autres bases techno-scientifiques, ne seraient pas forcément plus dangereux, sécuritaires, monopolistiques, que les systèmes actuels. Il me semble que l’évolution du capitalisme, voire sa disparition induira nécessairement un changement de paradigme techno-scientifique.
Si l’humanité « veut » effectivement assumer un destin où l’argent irait là où l’on en a le plus besoin, c’est à dire devant satisfaire le plus grand nombre, alors le choix de la solidarité, des complémentarités, au détriment des rentes et des droits de propriété industrielle, devra être fait.
Mais il est vrai, votre remarque ouvre une perspective plus sombre, qui serait celle où l’humanité délivrée de la question des ressources non renouvelables grâce à une percée techno-scientifique dans un sens sécuritaire, réinventerait en quelques sorte le capitalisme, avec ses inégalités, ses rentes et tutti quanti.
Mon hypothèse est que la transition du capitalisme à la société post-capitaliste n’ayant pas du tout été anticipée d’un point de vue pragmatique, l’humanité face à de nouvelles contraintes, seulement de survie, va devoir retenir les options techno-scientifiques les plus faciles à mettre en oeuvre et ne nécessitant pas des infrastructures par trop monstrueuses, en moyens techniques et financiers. D’où l’abandon assez brusque de l’ancien système technique qui va nous projeter plus rapidement que nous ne l’aurions cru dans un autre paradigme.
Dans l’idéal il faudrait une nouvelle civilisation où mutualisation des connaissances humaines irait de pair avec une délocalisation des centres de décision économiques et politiques. Sans en faire la pierre de touche de cette civilisation du futur, le système technique Internet fournit comme le prototype de ce type d’organisation. Dans le passé, après la chute de l’empire romain il se produisit via l’essaimage des monastères en Europe un phénomène qui pourrait donner une image de ce que pourrait être notre futur, toutes proportions gardées, car ce n’est qu’une image, bien entendu. Ces monastères étaient autonomes mais une culture commune les animait, véhiculée par une langue commune, le latin. La nouvelle civilisation aura forcément elle aussi une nouvelle culture commune, une culture dont le socle idéologique ne serait plus l’économie, j’entends l’économie capitaliste, économie par trop liée à l’ancien système technique, au final autodestructeur.
Jducac,
je sens poindre dans l’option spirituelle que vous n’excluez pas a priori une critique larvée du capitalisme, me trompe-je ? 😉
@ Pierre-Yves D. dit : 2 juin 2010 à 00:48
Vous voulez de toute force éliminer le capitalisme. Je crois que si vous restiez froidement réaliste, pragmatique, en vous libérant de tous les freins idéologiques qui vous égarent, vous en arriveriez à conclure, comme l’on fait les dirigeants chinois, soviétiques, et autres, que s’est un très bon système qui a bénéficié à tous ceux qui l’ont exploité.
Les chinois se sont mis à l’exploiter à fond et ont en quelques décennies vu à quel point celà leur profitait. Ce système démultiplie sa puissance dès lors qu’on lui permet de s’exercer sur des très grands nombres. Avec la Chine, la nation la plus peuplée, et le monde qui est le plus grand marché qu’on puisse conquérir, le capitalisme a trouvé les ingrédients qu’il lui fallait pour s’imposer sur notre planète. Le seul frein qu’il va trouver est celui des énergies et métaux disponibles pour l’alimenter. Pour l’énergie, on peut espérer de nouvelles sources, comme la fusion nucléaire. Mais pour les métaux, je vois mal comment nous pourrions aller au delà de ceux que nous possèdons en les recyclant à l’infini.
« je sens poindre dans l’option spirituelle que vous n’excluez pas a priori une critique larvée du capitalisme, me trompe-je ? » dites vous.
J’évoque effectivement depuis quelque temps sur ce site, l’option spirituelle. L’homme dont les ressources intellectuelles sont probablement infinies, (les vertus de la capitalisation, s’exerçant aussi dans ce domaine) va se trouver à court de métaux, pour poursuivre son évolution dans la recherche de satisfactions matérielles, en supposant qu’il résolve son problème d’énergie avant l’épuisement complet des métaux.
Une solution lui reste ouverte pour poursuivre sa formidable capacité à modifier ce qui l’entoure une fois qu’il n’aura plus de matériaux à transformer. C’est de travailler sur ce qui n’est pas matière: le spirituel. C’est un domaine dans lequel il s’est essayé depuis toujours et qui est peut-être le seul domaine dans lequel il n’y a pas de limites.
Pas de chance pour vous qui exécrez le capitalisme. Dans le domaine spirituel, les lois du capitalisme s’appliquent probablement aussi.
jducac,
je ne veux pas « éliminer de toute force » le capitalisme. Le terme « éliminer » ne me convient pas car il peut renvoyer à l’idée d’élimination physique d’ennemis désignés.
Je souhaite seulement sa disparition mais à condition qu’il soit remplacé par quelque chose de mieux, car ce système s’il a montré certaines réussites, comporte maintenant plus d’inconvénients que d’avantages. La base du système c’est la rente du capital. Cette rente c’est par principe de l’argent que d’autres n’auront pas.
Au nom de quoi des investisseurs parce qu’ils ont de l’argent devraient-ils détenir le pouvoir exorbitant de décider comment peuvent et doivent vivre leurs contemporains qui n’en disposent pas ou peu ? Car c’est à cela que revient finalement le fait de disposer de ce pouvoir de l’argent, de le faire « travailler. »
Sauf à supposer que l’inégalité est un phénomène humain naturel (je ne parle pas ici des différences biologiques bien entendu) je ne vois pas comment justifier une telle chose. D’aucuns ont beau dire que la richesse de quelques par un effet de ruissellement retombe sur le plus grand nombre, hélas pour eux la crise apporte un démenti cruel à ce genre de théorie. Cette théorie pourrait avoir une certaine pertinence si l’on considère les pays pris un à un, mais manque de chance l’économie est mondialisée, globalisée. Les gains des uns font les pertes des autres.
A défaut de condamner le capitalisme, peut-être seriez vous d’accord sur l’idée que nos sociétés souffrent d’être conduites par les intérêts quasi exclusifs des investisseurs. Savoir s’il existe de bons ou de mauvais investissements est aussi une question importante, mais la logique actuelle du capitalisme, toute acquise aux seuls investisseurs, fait que les bons investissements sont ceux que les investisseurs auront décidé.
C’est là que le bât blesse. Et c’est cela qui pervertit la démocratie.
vous n’appréciez pas tant que çà le poil à gratter …
Quel bonheur ce texte ! Un cadeau formidable ! Impossible d’aller plus loin dans la démolition d’une idée fausse : cette analyse linguistique sans appel touche au socle rocheux. Un délice ! Désormais, les adeptes du travail-souffrance, ces bourreaux en puissance, devront se cacher la tête sous une cagoule ! Je ne sais pas si vous en avez une claire conscience, Jean-Luce, mais vos révélations mettent un pilier fondamental du capitalisme en capilotade ! S’il faut bien admettre que la douleur, – et non la souffrance , est inévitable pour atteindre des performances physiques supérieures, la nécessité récurrente du travail, – symbolisée par le cercle et signifiée par la racine orbh -, n’implique nullement celle de la souffrance. Celle-ci n’est imputable qu’à la soumission comme le veut son étymologie : du latin sufferentia, la résignation, c’est-à-dire l’abandon de sa propre volonté et de ses droits. Et le cercle, qui ramène le même à lui-même, symbolise, – conformément à la « seconde branche » de la même racine orbh -, l’exclusion de la trame collective, la véritable source du droit dont jouissent les individus.
Par une heureuse coïncidence, c’est exactement à ce thème que je pensais ce matin en me fumant une petite cigarette dans la cuisine. En ce qui concerne le travail et la consommation, l’idéologie capitaliste est franchement schizophrénique. A l’en croire, souffrances et sacrifices au travail sont des nécessités incontournables, le plaisir une denrée rare et contingente réservée à l’élite. Mais quand elle aborde la consommation, le discours s’inverse : non seulement souffrances et sacrifices sont oubliés, inconnus au bataillon, mais on ne parle plus que plaisirs et satisfactions, comme si l’on était au paradis. Avec la publicité sur les crédits, cette schizophrénie se voit comme le nez sur la figure. Alors que les patrons ne peuvent jamais accorder un cent d’augmentation de salaire, – sur l’air bien connu qu’il faut être raisonnable et regarder la réalité en face -, les offres de crédits pleuvent dans la boîte à lettres, qui toutes vous invitent à satisfaire sans attendre vos envies, vos « coûts de tête », vos projets, n’importe lesquels évidemment. Dans la bienheureuse société capitaliste, on dirait que l’argent a cessé d’être une chose sérieuse et grave, celle qui a toujours fait couler le plus de sang.
Mais puisqu’il est question de linguistique, de travail et de souffrance, j’en profite pour exposer, – quitte à me couvrir de ridicule -, un vieux rêve personnel concernant l’apprentissage du français. Je tiens la méthode syllabique pour être incontournable et très efficace, car elle vise à inculquer un automatisme qui ne peut que faciliter la suite de l’apprentissage. Malheureusement, cette phase est particulièrement rébarbative, donc source de souffrance : les pédagogues éclairés ne l’ignorent pas, mais leurs réponses sont loin d’être « optimales ». La solution dont je rêve consiste à rendre agréable cette acquisition, afin qu’elle soit plus rapide et plus efficace, pas seulement à en atténuer les difficultés par des contournements divers. Pour rendre ce travail agréable, il n’y a qu’une solution : mettre les syllabes en musique, inventer pour les enfants des ritournelles dont elles seront les paroles. Cette idée peut paraître ridicule, mais je vous fiche mon billet que, si les Africains avaient eux-mêmes inventé l’écriture, c’est ainsi qu’ils l’enseigneraient.
Crapaud ne me dit pas qu’en fumant t’as pas pensé à un effet boeuf !?
Et a propos laquelle de toutes ces princesses (ou un prince qui sait ?) te transformera en un économiste charmant ?
J’ai un peu raté mon coup avec ce long post. Ci-dessous Steve résume bien mieux toute la problématique en une image, à la fin, quand il écrit :
Et cette image est conforme à ce qu’il faut comprendre du texte de Jean-Luce, à savoir que la souffrance (et pas la douleur, scrogneugneu !) au travail n’est pas une nécessité mais une conséquence de la solitude.
MERCI à Dissonance pour sa lucidité.
Cette idée selon laquelle le travail ne devrait pas être pénible est absurde. Rares sont ceux qui ont la chance d’aimer le métier qu’ils font ou de s’épanouir dans cette activité. Est ce injuste? Je ne sais pas. Est ce triste? Certainement.
Remettre en question l’idée que l’homme doive travailler pour sa survie est vraiment comique (c’est une réalité biologique que d’échanger avec le milieu extérieur pour continuer à « perséverer dans son être »). Rappelons quand même que tous les peuples n’ont pas la chance des français, qui ont un accès « facile » à la nourriture et à l’eau en raison de la géographie de leur territoire. La démocratie ne pouvait naître que dans le cadre d’une économie de subsistance.
Imaginons deux secondes que vous soyez pachtoune… que vous n’ayez rien à « cultiver »… la seule chance de survie qui vous reste est alors une économie de « prédation » des ressources accumulées par les autres, ce qui implique une certaine structure sociale (guerrière) à l’intérieur de laquelle vos idéaux de « démocratie » et de « travail comme oeuvre » n’ont aucun sens. Ils conduiraient tout simplement à l’extinction pure et simple de la communauté.
Bien sûr vous pouvez toujours essayer d’imaginer de distribuer les ressources de manière « égale », afin de permettre aux moins bien lotis de s’en tirer mieux qu’ils ne le font, au prix d’un léger sacrifice (ce « léger » sacrifice est un sacrifice que peu d’entre nou sont prêt à payer, avouons le, et il faudra nous l’arracher de force de la même manière qu’il faudra arracher de force les privilèges dont jouit la finance). Nous achetons notre vie oisive au prix de la souffrance et du travail des autres. C’est un fait.
Et ce qu’on prend pour une « justification » de l’esclavage par Aristote n’est rien d’autre qu’un constat désagrable mais lucide.
L’idée de remplacer « travail » par « œuvre » est aussi consternant que de prétendre que chacun est un « artiste » (lol). Et fustiger le christianisme, qui ne fait qu’énoncer un trait central de la condition humaine et qui de surcroît valorise le travail des hommes (cf « l’action de grâce »), c’est vraiment le produit d’une méconnaissance profonde de la théologie chrétienne! Enfin passons…
Les hommes ne naissent pas égaux. C’est un fait, et certains devront travailler plus dur que d’autres pour parvenir au même résultat, parce que les talents sont inégalement répartis (toutes choses égales par ailleurs, tout le monde n’est pas capable de battre le record du monde du 100m, même à quantité d’efforts équivalente). Et la « volonté de s’en sortir » ou la « persévérance » elle-même est un talent précieux inégalement réparti.
Seuls les théoriciens politiques prétendant s’attaquer à la distribution naturelle et inégale des talents , c’est à dire ceux qui ont été au-delà de Platon quant aux limites du domaine à l’intérieur duquel devrait s’exercer la justice (!), se sont véritablement attaqué au problème. Et quelle solution ont-ils trouvé à la pénibilité du travail? Il n’y en a qu’une, qui consisterait à prendre le mal « à la racine »: une certaine forme d’eugénisme libéral: l’extension de la sphère du marché au domaine de la manipulation du patrimoine génétique des générations futures.
L’égalitarisme a ses limites. Tout ce qui est arbitraire n’est pas nécessairement injuste ou encore… il y a des choses pires que l’injustice.
Ca ne veut pas dire qu’une société qui distribuerait équitablement la pénibilité des tâches n’est pas meilleure qu’une société qui ne le ferait pas. Cependant, en dehors d’une société d’abondance ou en dehors d’une mise en commun de la totalité des ressources de la planète (ce qui n’arrivera JAMAIS), la seule chose que nous puissions faire est d’organiser la distribution de cette pénibilité au mieux. Mais JAMAIS nous ne pourrons revenir sur le fait que certains travaillent pendant que d’autres « œuvrent », que certains ont une vie professionnelle plus riche que d’autres (ce qui n’est pas nécessairement une question de revenus), et sur le fait que certains sont naturellement plus talentueux que d’autres, ce qui leur confère certains avantages (le problème étant qu’en plus de certains privilèges ils devraient également avoir davantage de devoirs… ce dont ils se sont complètement affranchis… suivez mon regard!).
« Cette idée selon laquelle le travail ne devrait pas être pénible est absurde. Rares sont ceux qui ont la chance d’aimer le métier qu’ils font ou de s’épanouir dans cette activité. Est ce injuste? Je ne sais pas. Est ce triste? Certainement.
Remettre en question l’idée que l’homme doive travailler pour sa survie est vraiment comique »
Vous confondez la nécessité de travailler pour vivre et celle de souffrir pour travailler. C’est un peu facile de se demander ensuite « est-ce injuste ? » et de répondre « je ne sais pas ». La réponse, vous la connaissez, c’est injuste, mais pour ça il ne faut pas commencer par l’incipit que vous avez choisi.
Il y a aussi le climat, chez nous, l’hiver où rien ne pousse, ailleurs, sur des sols arides la corvée d’eau, mais peut-être quelques contrées plus propices ….
Et merci au clown gris pour avoir vu si loin dans ma propre façon de penser. 🙂
@Le Clown Gris et Dissonance : voir deux aveugles se renvoyer leur balle de ping-pong est franchement comique…
@dissonance
De rien 🙂
@crapaud rouge
Quand je dis « je ne sais pas » c’est « je ne sais pas ». Pas de mauvaise foi ici.
Je ne sais pas, parce que comme expliqué ci-dessous je ne suis absolument pas sur de mes intuitions morales concernant l’étendue du domaine de la justice, c’est à dire du domaine à l’intérieur duquel dire « tel ou tel chose est juste/injuste » a encore un sens (au sens Wittgensteinien de l’expression). Ainsi , si une île qui a déjà énormément souffert subit 5 ouragans dans l’année, c’est certainement « tragique », mais ça n’est pas « injuste ».
On entre ici dans des considérations d’ordre existentielles, liées au « sens de la vie », à « la signification du Tout ». C’est la question de la « théodicée », celle de l’origine du mal dans le monde (qui ne se pose que dans le cadre d’un arrière-plan théologique bien déterminé). Bref: autant trouver « injuste » d’être né ici et pas ailleurs, de ne pas avoir le physique de mon voisin « irrésistible » auprès des femmes (Iriez vous jusqu’à avancer, crapaud rouge, que le justice sociale requiert que la communauté politique me paie des cours de musique, d’art plastique, un coach particulier… et de nombreuses séances de chirurgie plastique pour égaliser mes chances avec lui?). Iriez vous jusqu’à égaliser les chances de succès amoureux? Et si non, pourquoi pas, tant que vous y êtes? Pourquoi arrêtez vous ici les bornes de la « justice sociale »?
Au delà de la suppression des privilèges nés à la naissance et de la garantie de l’égalité équitable des chances, il reste des différences de talent, liées au fatum et à la biologie, et certains auront des travaux moins pénibles que d’autres.
Bien sûr vous pouvez également vous arranger pour que des « machines » fassent le travail pénible, plutôt que des esclaves et vous pouvez également compenser la pénibilité de différentes manières (temps libre supplémentaire – salaire plus élevé – etc, bien que les français préfèrent laisser ces travaux aux populations immigrées, et qu’ils n’accepteraient sûrement pas de voir ces derniers subitement jouir d’un prestige social supérieur au leur du fait de certains aménagements allant dans ce sens), tout comme vous pouvez également obliger chacun à « tourner » (solution marxiste alternative à celle de Pol Pot, un peu plus radicale…).
Mais égaliser le temps libre et la répartition du capital ne change rien au fait que le temps de travail des uns et des autres sera plus ou moins « pénible » et que certaines places enviées ne seront destinées qu’à quelques uns parmi la multitude. Tout bien considéré, pester contre ça est peut-être du même ordre que de pester contre le fait que 2+2=4: voilà pourquoi je disais « je ne sais pas ».
Je ne sais plus quel poète disait que les deux choses les plus importantes dans une vie sont les amours et le métier… et que des deux le hasard décide.
@Crapeau Rouge:
« quand je vois les réactions à cet article, le pire y côtoie le meilleur. »
« voir deux aveugles se renvoyer leur balle de ping-pong est franchement comique… »
On comprend ainsi que le « pire » se résume à tout ce qui n’est pas conforme à la pensée de Crapaud Rouge, et par opposition « le meilleur », tout ce qui s’y conforme. Dialogue grandiose en perspective… 🙂
Je ne puis que vous répondre que, contrairement aux préjugés de l’idéologie judéo-christo-capitaliste, ni la souffrance ni la pénibilité au travail ne sont des nécessités, seulement des contingences. Pour le comprendre, il ne faut pas confondre la vraie nécessité de l’existence du travail avec la fausse nécessité de la souffrance/pénibilité au travail. Il ne faut pas non plus, comme le fait Dissonnance, confondre souffrance et douleur, ou souffrance et pénibilité. Si l’on n’est pas d’accord sur ces bases, il n’est pas possible de discuter du reste.
Note: je suis né dans une famille hyper-archi-méga catho. Alors, de grâce, ne me répondez pas sur ce registre, sinon je vous envoie une armée de crapauds qui hanteront vos nuits et vous empêcheront de dormir.
@Dissonnance : « On comprend ainsi que le « pire » se résume à tout ce qui n’est pas conforme à la pensée de Crapaud Rouge, et par opposition « le meilleur », tout ce qui s’y conforme. » : bien évidemment ! Sinon y’a plus d’justice ! 🙂
Je ne vois pas vraiment en quoi la pénibilité du travail ne serait que « contingente ».
Précisons:
– il y a la pénibilité du travail « en tant que tel », en tant que c’est une activité imposée par la nécessité de la survie, au sens par exemple où on préfèrerait se livrer à l’ »oisiveté » (mais je sens bien qu’ici aussi on va ramer pour se mettre d’accord sur une définition).
– il y a la pénibilité de tel ou tel travail « particulier » (la « vraie » pénibilité), je pense par exemple aux travaux des champs, aux risques que courent les pêcheurs en mer, ou à l’abrutissement du travail sur les plate-formes téléphoniques. Cette dernière est contingente au sens où elle dépend de l’activité en question.
Dans ces deux cas le travail est TOUJOURS pénible, et il l’est cependant plus ou moins.
– il y a la « souffrance au travail », celle-ci étant contingente au mode d’organisation du travail, des techniques managériales etc… et aux aspirations existentielles des salariés qui les subissent.
Il reste que que le billet parle du travail en tant que tel (puisqu’il s’agit d’étymologie) et non pas du tout de « la souffrance au travail ».
Bien sûr, le fait que vous ayez été traumatisé par une éducation catholique ne change rien au fait que ce n’est pas de la contingence de la « souffrance au travail » mais du fait qu’une communauté humaine doive travailler pour assurer sa survie (par opposition à ce qui était prétendument l’état de l’homme avant la Chute, le Jardin d’Éden pourvoyant à tous ses besoins physiologiques si tant est même qu’il en avait) dont il est question dans la Bible. Quant à l’autre volet « la souffrance au travail » je la Torah contient les premiers textes connus de l’histoire humaine s’efforçant de la réglementer (quelques millénaires avant l’invention de nos « syndicats »).
Bref… encore un procès absurde fait au monothéisme: un de plus je dirais…
Le problème avec l’étymologie, c’est que ça ne nous renseigne pas tant que ça: il est en effet important de savoir dans quel contexte le mot était utilisé afin de savoir quel type d’activité il recouvrait exactement. Ce n’est pas parce qu’un mot est traduit comme-ci ou comme ça dans telle ou telle langue que la manière de découper le réel dans les deux langues en question est identique (en fait ce n’est jamais le cas). Je doute que le contexte biblique recouvre le réseau de signification hindi/romain/contemporain. Évidemment les philologues/linguistes essaient normalement de prendre ce point en considération.
Je soutiens donc Dissonance dans sa remise en cause tranchante des posts qui précédaient, et qu’il a mieux compris que vous je dois dire (puisqu’à aucun moment il ne s’est agit de « la souffrance au travail »!)
@Le Clown Gris : « Dans ces deux cas le travail est TOUJOURS pénible » : non. Le travail est toujours fatiguant, même celui de bureau, même s’il est agréable. Mais c’est le propre de toute activité. Quand j’étais jeune, je rentrais d’une journée de ski complètement crevé, cela ne fait pas du ski une activité « pénible ».
Les préjugés véhiculés par le langage ne parlent pas de pénibilité, mais de « souffrance », un distinguo dont vous refusez de tenir compte, de sorte que vous ne pouvez pas être d’accord. La souffrance ne provient pas de la pénibilité mais de l’impossibilité de consentir au travail ou à son contexte. Le cas peut se produire quand on vous demande un travail con (mais pas forcément pénible), stressant (pas forcément pénible mais fatiguant pour les nerfs), dangereux, (pas pénible mais qui expose à des maladies ou des accidents), ou encore qui vous empêche d’avoir une vie familiale normale (les 3 x 8 par exemple). Aucune de ces causes de souffrance, – dues au fait que les modes de vie traditionnels ne sont pas respectées -, ne sont nécessaires.
« Le problème avec l’étymologie,… » : il n’y a pas de problème avec l’étymologie, le problème est avec les dominants qui utilisent l’étymologie pour faire admettre leur domination.
En ce qui concerne les monothéismes : 1) Le protestantisme et son puritanisme est le pire de tous ; 2) Le christianisme est une religion jeune : quand elle est apparue, les hommes avaient déjà fait de la vie un bagne (esclavage). Le christianisme n’a fait qu’entériner la situation avec son mythe d’Adam et d’Eve. 3) Pour les aborigènes d’Australie, la création a été faite « au temps du rêve » : un rêve, que je sache, ce n’est pas un cauchemar, mais quelque chose que toutes les cultures connaissent pour être une forme d’idéal. Donc, pour eux, la nature est l’eden, alors que pour les chrétiens, chassés du paradis, c’est l’antichambre de l’enfer. Le préjugé commence là, bien évidemment.
Bien que je ne privilégie pas l’hypothèse de la traverse (du joug) à cause de ce qu’on appelle travail dans le sud-ouest, abri pour travailler le sabot du cheval sur un trépied, mon article « Changer le travail, changer la vie » conteste aussi l’étymologie populaire, comme celle de religio.
http://jeanzin.fr/index.php?post/2007/03/21/81-changer-le-travail-changer-la-vie
Le terme de travail s’est malgré tout généralisé à cause de la physique et des machines qui fournissent un travail. Ce n’est que l’autre nom du salariat en tant qu’équivalent général d’une activité indifférenciée mesurée par le temps (à l’opposé de l’artisanat ou du labour pourtant laborieux).
J’ai lu votre article et j’ai tout particulièrement retenu cette phrase :
« Faire du travail le meilleur des loisirs »
J’ai découvert avec bonheur le thème des « coopératives municipales pour travailleurs autonomes ».
Je m’y intéresserai de plus près désormais.
Bien à vous
Beaucoup d’autres informations sur le terme « travail » sur ce lien :
http://www.languefrancaise.net/forum/viewtopic.php?id=3026
j’ai retenu celle-ci
« …
On ajoutera que cette racine a donne « travel » outre-manche et le roumain a lui adopte le mot « lucru » pour travail, du latin profit, ect…
…
Ce blog est bizarre.
Pratiquement tous les sujets offerts semblent intéressants et ouvrir discussion avec une ambiance décontractée qui n’exclut heureusement pas la contradiction.
Alors bon,
Je ne sais si le « détrollage » est important ?
Il doit y avoir ici quelque attracteur étrange.
« Ce blog est bizarre. (…) Il doit y avoir ici quelque attracteur étrange. » : oui, sans doute, car, quand je vois les réactions à cet article, le pire y côtoie le meilleur.
@ TARTAR,
J’ai appris grâce à vous un nouveau mot: « détrollage » (et bien sûr son contraire « trollage ») en allant faire un tour ici:
http://www.uzine.net/article1032.html
Que voulez-vous dire par « bizarre »? Que contrairement à d’autres blog, celui-ci a une excessive cohérence? Qu’un « esprit fort » y règne?
J’imagine quelques raisons à cela.
– Tout d’abord un « détrollage » assez conséquent (Les soupçons, les ragots invérifiables, les anathèmes ou les arguments ad hominem finissent toujours par tuer tout débat.)
– Ensuite, je me demande si l’ »ambiance décontractée » que vous évoquez, n’entraîne pas d’elle-même une certaine civilité des échanges (les « coups de gueules » sans arguments se trouvent très vite désamorcés, comme on peut le constater souvent, et certains échanges inutilement polémiques se terminent, sinon en poignées de mains, au moins en respect mutuel).
– Un esprit fort règne 😉
@ Crapaud Rouge,
Le meilleur du pire!
« Je suis capable du meilleur et du pire. Mais dans le pire, c’est moi le meilleur. » (Coluche)
Bêcher son jardin comme toute activité physique soutenue – tout sportif peut en témoigner – produit aussi des endomorphines qui procurent une sensation de bien -être . Il semble bien plutot que ce ne soit pas l’effort qui soit en lui-même la cause de la malédiction décrêtée par la Bible et le gauchisme.
Ce qui produit une sensation pénible dans le fait de bêcher est plutôt que dans nos sociétés cette effort reste un loisir et que ce loisir s’effectue dans une société ou les loisirs sont une compensation comme l’explique très bien le texte de J.L.LMorie et ou donc l’homme en est réduit a chercher un sens à sa vie dans ce que son patron lui laisse de temps.
Bonjour à tous
J’avais oublié Alphonse Allais: » L’homme n’est pas fait pour travailler! La preuve c’est que ça le fatigue! »
Attention avec la bible, le texte original peut réserver bien des surprises à l’interprétation!
Dans la traduction ici citée l’homme de glèbe n’est pas condamné à peiner mais peine parce que il a condamné la glèbe! La condamnation c’est la culpabilisation arme d’asservissement puissante si bien connue du pouvoir!
Sur la résistance qu’oppose la matière à l’homme on peut relire « la terre ou les rêveries de la volonté » de Bachelard.
Au dernier festival de Cannes quel bonheur que de voir une actrice- Danielle Darrieux, plus légère que bien des liftées, à plus de 90 ans faire encore son métier et le cinéaste Manoel de Oliveira à plus de 100 ans tourner encore! Duby, Braudel, Levi Strauss entre autres ont ils jamais cessé de « travailler »? Manet de peindre?
Mais j’ai aussi vu des ouvriers de chez Renault revenir chaque matin s’accrocher aux grilles après la fermeture de l’île Seguin parce que leur travail, aussi ingrat soit il les avait socialisés et leur avait permis de nouer des amitiés et qu’ils étaient fiers.
Cordialement
Denis Hopper est mort .
Une perte immense. Un réel artiste, acteur, réalisateur, photographe, collectionneur d’art … Une amérique qu »il interprétait dans toutes ses facettes.
Une petite info pour les linguistes et autres philologues distingués…
En béarnais, langue romane de type gascon, langue d’Henri IV, « travail » se dit « tribalh » et « travailler », « tribalha », avec un joli » i « …
Justement , ( je vous recopie le v. Wartburg) , les quelques rares formes en « i » sont uniquement gasconnes, mais la première forme gasconne repérée (1300) est en « a », viennent ensuite les formes gasconnes en « i « puis en « e » ; je remarque que les formes gasconnes « tribalhar » et elles seules, ont également une acception juridique ( procès, cause, poursuivre en justice) ?.
La mise en évidence de la racine consonantique indo-européenne en R-B règle la question du « tripalium » : il existait un mot antérieur en R-B, dont nous n’avons pas trace…et pour lequel le « trevail » a pris la place. Par contre, comme le fait remarquer Cécile, nous avons que dans le domaine anglo-saxon le mot « travaillour» fut repris du « trevail » continental , et que ce travailleur a lui-même pris la place d’un vieux mot anglo-saxon de racine R-B tombé en désuétude : earfoð or earfoþ* « hardship »
Par la suite « travaillour a donné naissance à « traveller / travel, ce que les étymologistes justifient par la « fatigue des voyages »
§
Relativement au billet, ces détails linguistiques sont sans grand intérêt : l’idée principale est la manipulation des affects autour de la société du « travail » et son « passage » à la « société du care » relativement aux orphelins déclassés. Cette société nécessite l’adjonction d’une quatrième classe sociale invisible : capitaliste – entrepreneur – redistributeur (de gauche comme de droite), travailleur (déclassé). La gauche passe de la thésaurisation paranoïaque des affects – « c’est la faute aux autres » – à la « gestion du repentir », allez « mes p’tits fi » – nous avons été trop gourmands, c’est vrai – on va tous se serrez la ceinture et les banques aussi, tient donc ! Mais nous aut’ , on est bons, on va prendre soin de vous… cassolette and Co.
Pour être tout à fait honnête, toute thèse se rapportant à celle du « travail émancipateur » me donne de l’urticaire, et celle-ci ne fait pas défaut. Peut-être parce que, contrairement à d’autres, je goutte bien moins la satisfaction du devoir accompli que la douleur qui l’accompagne, peut-être aussi parce que ne manque jamais de considérer la futilité de l’acte sur le long terme.
Il semble que l’exemple que j’ai choisi ne suffise pas à vous convaincre tous. Je n’en suis pas vraiment étonné, ceci dit j’aurais une foule d’autres exemples à fournir, et en tout état de causes quelques réponses à formuler:
@Crapaud Rouge
Réminiscence de Knock… « Est-ce que ça vous chatouille, ou est-ce que ça vous grattouille? »
http://films7.com/videos/louis-jouvet-knock-gratouille-chatouille
La nuance introduite ici n’est sans doute pas fausse, mais intéresse certainement plus les psychologues, les philosophes et les linguistes que les premiers concernés: Le type qui souffre d’arthrose après s’être usé toute sa vie durant dans un travail – si gratifiant soit-il – ne voit certainement pas de grand réconfort à savoir que sa pathologie lui provoque des douleurs, mais pas de souffrances… A mon humble avis…
@Tartar
« Travailler serait un devoir »
L’emploi du conditionnel est superflu: Quelle que soit l’espèce animale considérée, le simple fait de choisir de vivre plutôt que mourir implique de fait la nécessité d’un travail pour y parvenir, ce n’est même pas une caractéristique humaine, contrairement à ce que suggère anne-bis à votre suite.
Les questions du « don de soi » et de la « satisfaction » sont d’un autre ordre, à mon sens relatif au soucis permanent de hiérarchisation sociale: On fait don de soi aux autres pour être reconnu, et ainsi grimper dans l’échelle sociale – ce qui apporte des privilèges (cf. ça et donc de la satisfaction.
@Yvan
Je crains que le plaisir dont vous parlez ne soit qu’une illusion . Beaucoup de travailleurs ne voient absolument aucune gratification morale dans leur travail, mais gouttent effectivement le moment où leur journée de labeur s’arrête, c’est là précisément qu’ils parviennent à ressentir une certaine satisfaction de nature bêtement chimique et tout à fait relative, induite par le cerveau (voir le post du dendrobate écarlate). D’où l’expression qui fait florès chez mes collègues du moment: « Ça fait du bien quand ça s’arrête« .
Concernant votre plaisanterie quant à la concurrence déloyale générée par les potagers privés, elle introduit un biais intéressant et me permet d’évoquer quelques anecdotes:
Non bien sur, je n’entre pas en concurrence avec le marché si je fais pousser mes patates plutôt que de les acheter. D’une part parce que c’est ce même marché qui m’aura certainement vendu les semences – et l’État aura eu le bon goût d’ajouter au prix de base une patente bienvenue – et d’autre part parce que mes cultures ne sont pas destinées au commerce mais à mon usage personnel. Justement, il se trouve que mon vieux père a eu récemment la curiosité de faire une petite comparaison, et devinez quoi? Le kilo d’oignons « prêt à consommer » est bien moins cher que le sachet de semences correspondant…
Ceci dit, nos amis ultra-libéraux sont tout à fait enclin à prendre votre boutade pour argent-comptant. C’est ainsi que par exemple, sous couvert de « mesure d’hygiène », la récupération et l’usage des eaux pluviales (à usage privé) à été légalement restreint en 2008 dans des proportions qui frisent le ridicule (euphémisme): Voyez par vous-même.
Peut-être a-t-il été pensé en haut lieu que les cumulus et autres cumulonimbus faisaient une bien méchante concurrence à la générale des eaux, et qu’il convenait d’y remédier…
@nada
Le paillage ne suffit pas à lui seul à supprimer les efforts nécessaires à l’entretien d’un potager – sinon depuis le temps ça se saurait – et ne vaut que pour le moment du semis. Quid de celui de la récolte? Vos plantations sont-elles si satisfaites de leur traitement « bio » qu’elles sautent d’elles-même dans leur cagette? Et qu’en est-il des travaux pénibles non-agricoles?
Mr Jorion aurait sans doute ainsi beaucoup à dire sur la pénibilité du travail sur un bateau de pêche, quant à moi j’aurais aussi bien pu évoquer l’authentique torture subie par les ostréiculteurs du Belon ou d’ailleurs pour avoir eu quelques amis, saisonniers dans cette branche – en plein hiver, les pieds dans l’eau…
En résumé, il me paraît aussi illusoire de chercher à considérer le travail autrement que comme une douleur nécessaire. Le faire est à mon sens du même ordre que de parler du plaisir qu’on a à se rendre chez son dentiste…
Il paraît que la technique du BRF Bois Raméal Fragmenté diminue sensiblement le travail au jardin.
J’ai l’intention d’essayer l’année prochaine.
http://fr.ekopedia.org/Bois_Ram%C3%A9al_Fragment%C3%A9
http://www.terrevivante.org/247-mieux-que-le-compost-le-bois-rameal-fragmente-.htm
@louise
Puisque le sujet semble vous intéresser, je ne saurais trop vous conseiller de vous renseigner sur la PERMACULTURE, et particulièrement les travaux de Fukuoka au Japon. Difficile de ne pas y trouver son bonheur, tant les perspectives de cette approche systémique sont larges, tout en restant humbles.
Par exemple l’écologue Whittaker a montré » qu’un écosystème naturel mature est largement plus productif que n’importe quel système humain de production de nourriture La productivité primaire nette d’une foret tempérée caduque est deux fois celle d’une terre cultivée moyenne(1200 g/m²/an (gramme de matière sèche par mètre carré et par an) contre 650 g/m²/an), du fait d’une utilisation de l’énergie, de l’eau et des nutriments beaucoup plus efficace que celle de l’agriculture ».
De cette même école,dans la même éthique, David Holmgren a développé en 2002 un ensemble de principes légèrement différents et parfois complémentaires.
1. Appliquer l’autorégulation et accepter les rétroactions (feedback) – il faut décourager les activités inappropriées pour s’assurer que le système continue de fonctionner correctement.
2. Intercepter et stocker l’énergie – en développant des systèmes qui collectent les ressources quand elles sont abondantes et que nous pouvons utiliser à besoin.
3. Utiliser et répondre créativement au changement – on peut avoir un impact positif sur des changements inévitables en observant avec attention et en intervenant au bon moment.
4. Concevoir en passant des motifs généraux (structure) aux détails – en prenant du recul on peut observer les motifs dans la nature et la société et les reproduire. Ils peuvent alors devenir la colonne vertébrale de nos designs et les détails mis en place à mesure que nous progressons.
5. Intégrer plutôt que séparer – en mettant les bons éléments aux bons endroits, des relations se développent entre ces éléments et ils travaillent ensemble pour s’entraider.
6. Observer et interagir – En prenant le temps de s’engager avec la nature on peut concevoir des solutions qui correspondent a la situation.
7. Obtenir un résultat – s’assurer que l’on reçoit réellement des récompenses utiles pour le travail qui est fait.
8. Ne pas produire de déchets – en trouvant une valeur à chaque ressource disponible et en les utilisant toutes, rien n’est un déchet.
9. utiliser et valoriser la diversité – la diversité réduit la vulnérabilité à une variété de menaces et tourne à son avantage la nature unique de l’environnement dans lequel il réside.
10. Utiliser et valoriser les ressources et les services – faire la meilleure utilisation de l’abondance de la nature pour réduire notre comportement consommateur et notre dépendance vis-à-vis des ressources non renouvelables.
11. Utiliser les bordures et valoriser le marginal – l’interface entre deux choses est l’endroit ou les événements les plus intéressants se produisent. Ce sont souvent les éléments qui ont le plus de valeur, et qui sont les plus divers et productifs.
12. Utiliser des solutions petites et lentes – Les systèmes lents et petits sont plus faciles à maintenir que les gros, en faisant un meilleur usage des ressources locales et en produisant des résultats durables.(Sources Wikipédia)
Ce me semble un peu plus cohérent que l’approche « mystico-occultiste » de la Bio-dynamie inspirée de l’anthroposophie de Steiner, ou, dans la perspective inverse, de l’arnaque absolue de l’agriculture « raisonnée », sensément « durable »!
le fait est que quelques exemples, même symboliques comme cultiver des légumes, ne prouvent pas une démonstration… ils l’agrémentent.
ils peuvent aussi servir de point de départ à une réflexion (remise en cause ?) personnelle de dogmes acquis ou en tout cas admis comme vérités universelles.
le paillis ne sert pas de tremplin aux pommes de terre vers le cellier.
mais il ne se limite pas non plus au temps du semis.
mis en place à l’année, il nourrit les portions inoccupées en hivers, évite les labours automnaux et printaniers, mortifères pour l’humus, et permet à l’humain opportuniste de s’installer à genoux ou assis, pour dégager un coin de terre, bien noire, bien friable, bien chaude (un peu de lyrisme !) et d’y confier une graine ou autre pomme de terre, sans trop d’effort et sans sentiment de commettre une agression.
la culture habituelle du potager nécessite bêchages, arrosages et certains adjuvants chimiques.
le système montre actuellement qu’il appauvrit la terre et nuit à l’humain (douleur à la culture, pollution par la consommation).
ce n’est qu’un exemple. ça n’a pas valeur de démonstration.
mais ça me fait réfléchir à la nécessité implicite de la douleur (reçue ou infligée) pour tous les actes vitaux humains. y compris le travail.
la douleur fait partie du hasard de la vie, elle ne la justifie pas.
certains indiens ne tuent pas d’animaux pour manger. ils vivent.
les occidentaux (moi y compris) tuent des animaux pour manger. ils vivent.
mes voisins ne paillent pas, ils bêchent. ils ont mal au dos. ils mangent leur légumes. ils vivent.
je paille. je ne bêche pas. je mange mes légumes (objectivement…. les limaces aussi !). je vis.
je me demande juste si la douleur, subie ou infligée, est une constante obligatoire…
Merci vigneron, mais c’est déjà fait !
dissonance, je ne voulais pas suggérer que c’était une caractéristique humaine, au contraire. Les humains sont des animaux comme les autres pour ce qui concerne leur survie. C’est le mot travail qui fait la différence. Parce que je ne sais pas pourquoi , mais nous nous regardons survivre, et nous essayons de gérer et d’organiser cette survie, et on appelle ça travail, ça devient un concept. Les autres espèces ont autant de mal que nous, mais elles n’en parlent pas. Que nos activités soient devenues monnaie d’échange, dont la forme évolue, c’est une formule sophistiquée des stratégies classiques de reproduction, d’accès aux ressources, de colonisations de territoires, partagées avec le reste du monde vivant. Bon en même temps c’est un peu une évidence …Mais ce qui l’est moins, c’est comment ce concept de travail a produit cet impératif maximal qu’est le progrès, jamais vraiment remis en question, avec la haine de soi comme corollaire il me semble.
@anne-bis
« je ne voulais pas suggérer que c’était une caractéristique humaine, au contraire […] »
J’avais bien compris, mais votre manière de le dire me paraissait sujette à interprétation.
D’autres pistes sur le concept du travail / savoir-faire /savoir-vivre
– Richard Sennett « Ce que sait la Main »
ou La culture du nouveau capitalisme » (titre ressemblant à celui de Rifkin)
– Stiegler (Bernard) et l’Otium (loisir/amatorat:….) , qui s’oppose au « neg-otium » le négoce, qui préfère le chiffre (« Zerstörisches Geld ») au savoir-faire.
Le cerveau peut gommer une partie de l’inconfort si cela lui est permis par son état de « protention » (l’attraction vers un but, le contraire temporel de la rétention).
Le fonctionnement sur une base « otium/savoir-faire » a besoin d’un milieu associé, (un milieu « émetteur récepteur », comme le rôle que joue la langue, dont tout écouteur est locuteur) . IL a aussi besoin d’une liaison des pulsions et de leur sublimation, d’un « ça ne se fait pas (dont la base peut être biologique, cf le numéro de Books de Mai Juin, ça m’entrainerait vers le neurones miroirs comme base de la notion de justice, je stoppe là ce fil).
Son absence mène à la misère symbolique, aux formes de « prolétarisation » (indépendamment du revenu monétaire).
L’organisation sociale capitaliste n’a qu’un côté de bon, par rapport à cela, c’est de favoriser (historiquement) le « projet », l’investissement dans ce projet, assez aveuglément.
C’est toutefois une vision occidentale que celle-ci, je pense que dans une vision chinoise, sans doute, les contradictions n’apparatraient pas du tout aux mêmes jointures.
@>strong>crapaud rouge, sur l’apprentissage syllabique : oui, je pense que s’adresser au cerveau sur plusieurs registres permet de mieux le « re-coder » ; en pratique, je me suis laissé dire que c’est comme ça qu’on apprenait les langues sémites auprès des religieux en Afrique du Nord (synagogues ou mosquées) ;
Je pense aussi que la psychanalyse a pris comme « tournevis » le langage pour tenter de re-conditionner tout l’esprit, et essaye de faire « au mieux », tout en ayant pas mal foiré son coup globalement,… je préfère vos idées pragmatiques sur le chant comme assistance linguistique mutatis mutandis
Je n’ai rien contre la poésie.
Observons, cependant: Que dès le xiie siècle, leur première apparition dans les textes, et tout au long du moyen-âge, « travail » et « travailler » signifient « tourment » et « tourmenter », que « travailleur » jusquèau xviie siècle signifie « bourreau ». Que le mot pour dire « travail » au moyen-âge est « oeuvre », « travailler », « ouvrer ». D’où, aussi, notre « ouvrier ».
Remarquons aussi que la 2e partie du mot est oublée par notre poète : « -alium », qui permet de ranger le terme dans la très classique série des mots dont le pluriel en « aux » correspond aux transformations phonétiques de la finale : als, aws, aus, graphie : aux.Ce sont nos mots en -al, ou ail,pluriel aux; cf émail, émaux.
Et le salariat Jean-Luce…Vous nous en remettrez bien une petite pincée non ?
http://www.presse-francophone.org/apfa/motdor/etymolog/salaire.htm
Pour les moineaux, c’est sur la queue.
Un vrai travail semblable à une œuvre, serait de vivre dignement de nos capacités manuelles, intellectuelles, spirituelles, c’est exaltant, c’est gratifiant, la joie, c’est le premier des salaires, et ça n’a pas de prix.
La douleur qui accompagne souvent le travail peut être négociée par la joie de ce que le travail peut apporter à chacun.
Soustraire la joie du travail et la douleur devient souffrance, et nous mourons esclaves.
@ Louise dit : 29 mai 2010 à 13:07
Louise ma sœur, pas de doute nous sommes frères.
Les hasards de l’existence nous ont amenés à prendre des options différentes, pour conduire notre vie. Partant de conditions initiales quasi identiques, nous sommes arrivés à des situations actuellement différentes. Pourtant dès demain, elles risquent d’être très semblables, dans l’au-delà ou peu avant.
J’adhère à beaucoup des idées que vous exprimez. Mais ce qui me gène le plus, c’est de sentir poindre chez vous un sentiment de rancœur et de haine rémanente, notamment quand vous évoquez « la tête sur une pique »
Ceux qui ont implanté un tel sentiment dans votre cœur et dans celui de beaucoup trop d’autres, sont à mon avis potentiellement coupables de crimes contre l’humanité. Ils ont cherché à transformer des têtes et des coeurs en bras armés de piques afin de faire régner leur idéologie.
Marx était certainement nourri de bonnes intensions, mais au point où l’humanité en est arrivée il est temps de le dépasser, surtout quand on voit où cela a mené ceux qui ont voulu mettre ses théories en application.
L’argent, le travail, le capital, la dette, sont des inventions humaines nées de l’évolution naturelle de notre civilisation, probablement pour son bien, même si actuellement elles nous posent problème. Elles ne résultent pas forcément d’une volonté de nuire de la part de ceux qui ont été les premiers à s’en servir ni de la part de ceux qui s’en servent encore honnêtement.
C’est, me semble-t-il, les dévoiements de leurs règles d’usage qui sont à condamner. Ils résultent de viols à la morale que sont, l’envie non maîtrisée, l’avidité, la cupidité, le cynisme, la tromperie, le mépris des autres, l’irresponsabilité, tous défauts qui rangent ceux qui les portent, hors du champ des hommes dignes de bâtir l’humanité de demain à laquelle les honnêtes gens ont droit.
Evoquer des comportements sanguinaires me semble à proscrire quand on veut s’inscrire dans une démarche de restauration des valeurs morales indispensables à l’humanité de demain.
Au contraire, il semblerait bon de faire émerger les qualités et les vertus humaines qui sont à l’opposé des défauts signalés ci-dessus.
La fusion des idées de bonne volonté, plutôt que leur opposition. La tempérance et la maîtrise des envies plutôt que le libre cours aux pulsions. La prise en compte du futur, plutôt que l’exploitation excessive du présent. L’attention aux autres de demain au moins autant qu’à soi aujourd’hui. Le rejet systématique de la violence. La recherche permanente de la justice en prenant en compte les aspirations légitimes de tous les autres.
Nota : J’ai écrit en pensant à vous ici : http://www.pauljorion.com/blog/?p=11875#comment-82357
Rattacher le travail à la torture peut avoir un intérêt étymologique mais sert surtout certains ayant des tendances tout de même sadiques à justifier leur comportement ! L’intérêt du travail n’est pas dans la souffrance qu’il procure ni même le temps que l’on y passe ni la « sueur ». Son intérêt n’est que le résultat ! que l’on claque des doigts ou que l’on souffre sang et eaux n’ajoute aucune valeur en soit si ce n’est que l’auto-justification sociale de certains tant dans leur comportements sadiques d’une part ou masochistes de l’autre leur permettant tout au plus de justifier leur statut social mais qui n’a de fait aucun rapport ni quantitatif ni qualitatif. Chacun tente de justifier son statut social à posteriori alors que de fait il n’y a aucun rapport significatif et scientifiquement calculable entre le travail et votre statut social et l’argent que vous avez ou que vous gagnez qui lui n’est justifier par contre que part votre appartenance à un groupe social et cela par contre est scientifiquement calculable et sert même de base de remboursement pour les assurances. Si votre enfant a un accident et qu’il reste handicapé c’est bien le statut social des parents qui servira de base de remboursement !
Art. 9. – A côté du système socialiste d’économie, qui est la forme dominante de l’économie en URSS la loi admet les petites économies privées des paysans individuels et des artisans, fondées sur le travail personnel et excluant l’exploitation du travail d’autrui.
Art. 12. – Le travail, en URSS, est pour chaque citoyen apte au travail un devoir et une question d’honneur selon le principe : « Qui ne travaille pas ne mange pas ». En URSS se réalise le principe du socialisme : « De chacun selon ses capacités, à chacun selon son travail ».
Art. 10. – Le droit des citoyens à la propriété personnelle des revenus et épargnes provenant de leur travail, de leur maison d’habitation et l’économie domestique auxiliaire, des objets de ménage et d’usage quotidien, des objets d’usage et de commodité personnels, de même que le droit d’héritage de la propriété personnelle des citoyens, sont protégés par la loi
Art. 118. – Les citoyens de l’URSS ont droit au travail, c’est-à-dire le droit de recevoir un emploi garanti, avec rémunération de leur travail, selon sa quantité et sa qualité. Le droit au travail est assuré par l’organisation socialiste de l’économie nationale, par la croissance continue des forces productives de la société soviétique, par l’élimination de la possibilité des crises économiques et par la liquidation du chômage.
Art. 119. – Les citoyens de l’URSS ont droit au repos. Le droit au repos est assuré par la réduction de la journée de travail à sept heures pour l’immense majorité des ouvriers, par l’établissement de congés annuels pour les ouvriers et les employés avec maintien du salaire, par l’affectation aux besoins des travailleurs d’un vaste réseau de sanatoria, de maisons de repos, de clubs.
Ces extraits de la constitution de 1936, réputée comme la plus démocratique sur le papier, devraient travailler le lecteur. La notion d’entrepreneur que P. Jorion différencie justement du rentier et du travailleur a peu de place ici, puisque réduite au travail personnel à l’exclusion de « l’exploitation » d’UN seul autre. Sur le papier, on a écrit aussi « liberté, égalité, fraternité », le cours de cette devise est très variable car c’est une action au long cours entre idéal et délire. Il reste beaucoup de travail à faire pour se reposer dessus.
« et excluant l’exploitation du travail d’autrui ».
Sauf qu’il est impossible de définir « l’exploitation » d’une manière telle qu’elle serait absente dans le « socialisme » mais toujours présente dans le capitalisme (l’argumentation, implacable, se trouve chez P. Van Parijs).
Et quid du chanteur qui vend des milliers de places de concert et qui ne force personne à assister à ses représentations? Qui exploite t-il? Qui du peintre génial? Quid du joueur de foot?
Le principe de justice bien connu « de chacun selon ses capacités à chacun selon ses besoins » échoue devant « l’argument des gouts dispendieux », ce pourquoi on a abandonné l’égalitarisme du bien-être pour l’égalitarisme strict des ressources chez les penseurs égalitaristes (qui sont anti- marxistes, d’ailleurs, les marxistes rejetant l’idée que le problème puisse être réglé au niveau (re)distributif sans prendre en compte la question des modes de production).
Qu’ils se la gardent leur constitution: elle n’a rien de démocratique et tout de totalitaire, derrière des apparences chatoyantes, dès lors qu’on y regarde de près. La démocratie garantit bien plus que ça!
À clown gris,
J’ignorais l’existence de Philippe Van Parijs, j’ai lu les 2 premiers pages que proposent googlebank, j’ai lu l’article wiki sur l’Allocation Universelle, un fatras de considérations moralos-psychologiques pauvres. Wiki c’est parfois excellent, parfois nul, mais puisque leur règle de fonctionnement inspiré du wiki anglophone prétend à des articles neutres, je lis où mène cette prétendue neutralité. L’A.U. inspirée de Locke, la propriété privée suppose d’indemniser ceux qui n’y ont pas accès. On fabrique le rentier de base, avec le souci de protéger la vie privée des pauvres, leur liberté ! Je suis pour la levée totale du secret bancaire, c’est vous dire si la notion de vie privée… « privée de quoi ? » demandait Aragon ? J’apprends le terme « dividende social » MDR ! Je lis que Socialistes et verts français y serait favorables, Toni Negri aussi. C’est très grave. Merci de m’avoir ouvert les yeux sur ce complot. Décidément n’importe quoi plutôt que toucher à la propriété privée ! Déjà qu’il n’y a pas de sauveur suprême, mais alors ceux là, comme disent les enfants qui parlent mal : on se court ! (Au secours/ on secourt). Ensuite pour le chanteur, la « liberté » du public étant bien plus complexe que ne le supposent les branchés de l’A.U. ce qu’ils versent pour jouir du trou de leurs oreilles devrait être imposé jusqu’à fabriquer une échelle de revenus extrêmement limitée. La notion de totalitarisme promue par Arendt ne m’a jamais convaincu, mais je lis que vous avez votre définition.
Em Português: trabalhar !
Merci, j’en ai mis trop « trabalahar (port.) » je ne me suis pas relu, je me connais, j’ai du en laisser d’autres, pardon.
L’alinéa 5 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, repris intégralement dans la Constitution du 4 octobre 1958, affirme que “chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi”
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/preambule-de-la-constitution-du-27-octobre-1946.5077.html
Voici de bien belles déclarations de principe mais qu’en est il de leurs applications concrètes ?
La réalité nous saute aux yeux : Son éclat nous aurait il aveuglé à ce point pour ne plus le voir ? L’emploi devient une denrée rare, non pas qu’il n’y ait plus d’activités pour occuper le coeur, la tête ou les bras de nos chers concitoyens loin s’en faut.
Mais pour deux raisons très simples : seules les activités dites rentables ou bien subventionnées doivent être retenues sur le marché du travail. De plus l’impérieuse nécessité de faire toujours plus de profit pousse les entrepreneurs à s’automatiser ou se délocaliser.
L’alinéa 11 du même texte précise que “tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence”
Puisque l’on sait que la réalité économique pèse toujours plus lourd sur l’emploi et
que le salariat s’effiloche de plus en plus (précarisation, chômage, bas salaire, paupérisation
des travailleurs …), alors à quoi cela sert il de se voiler la face ?
Il existe bien un conflit d’intérêt entre ces deux mondes diamétralement opposés : Capital
et Travail. C’est peine perdue que de s’évertuer à vouloir les rabibocher.
Le droit constitutionnel n’y changera rien car complétement anachronique face à une évidence qui s’impose de façon criante : LE LIEN INEXTRICABLE ENTRE REVENU ET TRAVAIL EST EN TRAIN DE SE ROMPRE.
L’alinéa 5 devient inapplicable. En revanche l’alinéa 11 va devenir la règle et non plus l’exception.
De sorte que « Le droit d’obtenir un emploi » devrait être remplacé « par le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence »
La lutte des classes devrait donc se focaliser sur cet alinéa 11 puisque la destruction du salariat est inéluctable, évolution logique du système productiviste. Marx l’avait déjà prédit en son temps. Mais cette casse du salariat est bénéfique car elle va permettre de remettre en question les rapports de production et redéfinir le travail non plus en tant que nécessité pour vivre et mais en tant que vecteur central de citoyenneté.
De sorte que les millions de Français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, les chômeurs qui survivent avec l’ASS, le RSA ou rien du tout, devront se mobiliser de plus en plus pour rappeler aux gouvernants le caractère « convenable » et hautement constitutionnel de ces « moyens d’existence » énoncé dans cet alinéa 11.
« Un million de demandeurs d’emploi vont se trouver en fin de droits avant fin 2010 en France. Une situation intenable, d’autant que 60 % d’entre eux ne bénéficieront plus d’aucune indemnité »
http://www.bastamag.net/article879.html
Quant à l’étymologie suspecte du mot travail à savoir « tripalium », cela n’est pas totalement faux.
La douleur de l’enfantement sera toujours consubstantiel à la finalité d’une oeuvre. Qu’elle soit d’ordre professionnelle ou ludique, la volonté d’atteindre un résultat implique en contrepartie un effort plus ou moins douloureux. Là n’est pas la question.
La question n’est pas non plus de remettre en cause la valeur du travail et de l’effort qui s’y rattache ni de son influence bénéfique dans la construction de la personnalité et du lien social.
La véritable question est : comment affranchir le travail de l’autorité du capital ? Comment transformer cette économie de l’échange par une économie de la répartition ? Répartition des revenus et répartition des activités socialement utiles (et non pas seulement marchandes)
“Le rôle social de la machine économique, écrit Jacques Duboin, ne doit plus être de fournir
du travail (entreprise chimérique, même à l’ère de la rareté), mais de procurer des produits
et des services”.
http://www.saintnazaire.net/2475-des-pistes-pour-l-apres-crise-les-idees-de-jacques-duboin.html
Cela me rappelle qu’en 1988, ils ont changé une phrase de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme telle qu’elle est affichée dans les établissements scolaires français .
Avant c’était : « tout homme a droit au travail « .
C’est devenu : »tout homme a le droit de travailler » .
Ce n’est pas du tout la même chose, même si certains n’y ont pas prêté attention .
Quand on dit que tout homme a droit au travail, un chômeur peut porter plainte, pour non respect des droits de l’Homme, contre l’Etat français qui n’intervient pas pour lui procurer l’emploi auquel il a droit .
Quand on dit que tout homme a le droit de travailler, cela veut dire qu’il n’est pas illégal de travailler, rien de plus .
Ce changement de phrase iindiquait que le gouvernement ouvrait le parapluie pour se prémunir contre les attaques et qu’il n’avait pas l’intention de prendre des mesures pour s’opposer à l’installation d’ un chômage de longue durée .
« La « tripaliation » savante comme la reprise par le trevail vernaculaire rechargeait les affects hérités sur des signifiants neufs qui tout en étant phonétiquement voisins, sont sans filiation directe avec les précédents. Que ce nuage d’affects était lié depuis longtemps à tout un réseau de signifiants dont la résonnance indo-européenne saute aux yeux »
Réponse : » Ouille ! »
http://pagesperso-orange.fr/jardin.secret/EcritsLitteraires/Nouvelles/hexagonal.htm
Beber, vous n’êtes pas si cancre que de rien entendre à mes abscondités.
cher Jean-Luce, je vous soupçonne juste de travailler pour une marque d’aspirine …
Mais vous n’êtes peut être qu’un amoureux transi des mots .
@jducac
« Partant de conditions initiales quasi identiques, nous sommes arrivés à des situations actuellement différentes. Pourtant dès demain, elles risquent d’être très semblables, »
Effectivement, mon cher jducac, car dans le monde où nous vivons, que l’on soit fourmi ou cigale le résultat sera le même, car les forces prédatrices qui sont en place auront tôt fait, par l’augmentation des taxes et impôts, par la réduction des aides sociales, par les augmentations de prix (gaz, loyers, etc), par les baisses de salaires, par les baisses de revenu des petites économies, par l’accaparation de ces petites économies au travers des jeux de monopoly de la bourse (même si vous ne jouez pas en bourse que croyez-vous que les banques font de votre argent) et j’en passe et des meilleures ou des pires c’est selon.
Vous commencez peut-être à vous en rendre compte.
Que l’on soit cigale ou fourmi on participe tous à ce jeu morbide et lorsque les cigales commencent à tomber les fourmis ne vont pas tarder à suivre.
Les choses sont tellement imbriquées qu’il ne peut, dans ce monde, y avoir de cigales sans fourmis, ni de fourmis sans cigales.
Toutes sont dans le même bateau et le bateau est en train de couler, il est inutile de se renvoyer la balle car nous avons été embarqués dans un jeu où « face : « ils » gagnent, pile : nous perdons » !
Nous avons été embarqués par ces « ils » dont certains ont été élus par nous-mêmes !
Et non, je n’ai aucune haine envers eux, ni envers quiconque d’ailleurs.
Ce que j’exprime n’est que le reflet de ce que je peux lire sur ce blog ou sur d’autres, où de plus en plus de gens on dépassé le stade de l’indignation pour entrer dans celui de la colère.
C’est aussi ce que j’entends de plus en plus autour de moi.
Le problème est donc de trouver un moyen pacifique pour faire comprendre à nos chères (dans tous les sens du terme !) zélites que nous ne sommes plus dupes et que nous voulons un changement radical des modes de pensées qui gouvernent ce monde actuellement.
C’est pourquoi j’ai proposé une idée idiote : la cocotte en papier.
Parce que la cocotte en papier représente la pause, c’est quelqu’un qui n’a plus rien à faire, qui « bulle » dans sont coin (sans risque d’explosion), qui, tout en occupant ses doigts à une action totalement gratuite et inutile, réfléchit tranquillement.
Et c’est ce qui nous manque actuellement, du temps pour se poser calmement et réfléchir à ce que pourrait être une vie « autrement ».
La cocotte en papier pour dire stop ! Y en a marre ! On veut plus jouer ! Faites quelque chose !
Faites d’autres choses !
Pour leur dire on ne vous à pas élus pour çà, pour que les riches soient toujours plus riches et les pauvres toujours plus pauvres !
Vous avez été élus parce que certains ont cru vos belles promesses de campagne électorale et parce que pour d’autres vous étiez ce qui leur paraissait le moins pire.
C’est rien une cocotte en papier, ça mange pas de pain comme disais un de mes amis, c’est vite fait et on peut les laisser n’importe où.
Mais des dizaines, des centaines, des milliers, des millions, tous les jours, ils nous mettront des amendes pour jet d’ordures sur la voie publique ?
@louise
Ca fait toujours plaisir de vous lire 🙂
Pour tous ceux qui n’aime pas la cocotte en papier. Voici un modèle qui peut les réconcilier:
http://origami-rom1.over-blog.com/article-1476434.html
Je suis persuadé que depuis l’origine des temps, c’est la loi du plus fort qui règne en maître. Chez les hommes comme chez tous les êtres vivants, ce sont les êtres les plus faibles qui sont éliminés lors des situations de crise. Nos dirigeants n’étaient pas là à l’origine des temps, ils ne sont donc pas responsables de la mise en place de cette loi naturelle contre laquelle il me semble difficile de lutter quand les crises deviennent trop graves. Par contre, dès le début des années 70 les dirigeants de l’époque et ceux qui ont suivi ont eu des signaux d’alerte mettant en évidence l’impossibilité de poursuivre éternellement notre croissance économique et démographique, et ils n’ont rien fait. Au contraire, ils ont les uns et les autres repoussé les décisions douloureuses à plus tard. Tellement tard que maintenant c’est peut-être trop tard.
Malgré cela je vous dit à plus tard.
Mon ordinateur est en panne pour au moins 2 semaines. J’espère que notre monde durera suffisamment de temps pour attendre la réparation et permettre la poursuite de nos échanges.
@jducac
Monsieur De la Fontaine Boileau ne l’aurait pas mieux dit! La raison du plus fort est toujours la meilleure, et les mots pour le dire arrivent aisément! Quoique, de la première source, toujours intarissable…
LE CHÊNE ET LE ROSEAU
Le Chêne un jour dit au roseau :
Vous avez bien sujet d’accuser la Nature ;
Un Roitelet pour vous est un pesant fardeau.
Le moindre vent qui d’aventure
Fait rider la face de l’eau,
Vous oblige à baisser la tête :
Cependant que mon front, au Caucase pareil,
Non content d’arrêter les rayons du soleil,
Brave l’effort de la tempête.
Tout vous est aquilon ; tout me semble zéphir .
Encor si vous naissiez à l’abri du feuillage
Dont je couvre le voisinage,
Vous n’auriez pas tant à souffrir :
Je vous défendrais de l’orage ;
Mais vous naissez le plus souvent
Sur les humides bords des Royaumes du vent.
La Nature envers vous me semble bien injuste.
Votre compassion, lui répondit l’Arbuste ,
Part d’un bon naturel ; mais quittez ce souci.
Les vents me sont moins qu’à vous redoutables.
Je plie, et ne romps pas. Vous avez jusqu’ici
Contre leurs coups épouvantables
Résisté sans courber le dos ;
Mais attendons la fin. Comme il disait ces mots,
Du bout de l’horizon accourt avec furie
Le plus terrible des enfants
Que le Nord eût porté jusque-là dans ses flancs.
L’Arbre tient bon ; le Roseau plie.
Le vent redouble ses efforts,
Et fait si bien qu’il déracine
Celui de qui la tête au ciel était voisine,
Et dont les pieds touchaient à l’empire des morts.
Et je vous ferai grâce du Lion et du Rat:
Il faut, autant qu’on peut, obliger tout le monde :
On a souvent besoin d’un plus petit que soi….
@ Vigneron 31 mai 2010 à 23:26
Merci de faire ce rappel.
Avec ces fables, le petit peuple faisait l’essentiel de ses études en philospophie. Les hussards de la république laïcs et républicains, associés à leurs collègues propagateurs de la morale religieuse, et aux anciens dont on savait respecter la sagesse accumulée et retransmise, façonnaient le comportement du plus grand nombre. On s’attardait surtout à prolonger les vertus du passé pour préparer l’avenir. Il est vrai qu’on n’avait pas encore fait les grandes découvertes de ces 40 dernières années qui, en s’appuyant sur les référentiels bondissants, et la théorie des ensembles, ont fait évoluer l’enseignement primaire comme jamais.
D’ailleurs les résultats sont là.
Votre rappel est de nature à donner de l’espoir aux plus jeunes encore capables de souplesse et à condition qu’ils ne soient pas implantés dans des endroits trop vaseux qui les laisseraient se déraciner et être emportés par la tempête qui arrive.
Pour les plus anciens, comme moi, les bases sont bien implantées mais les superstructures asséchées sont devenues fragiles. Heureusement, le coeur est bon et la cime est haute ce qui permet encore de voir venir les choses, souvent mieux que les autres.
Dans « A serious man » des frères Coen, une scène montre le héros venu consulter un rabbin. On voit le rabbin seul et contemplatif à son bureau mais la secrétaire refuse au héros l’entrevue. Elle dit “he is busy” et elle ajoute “he is thinking”. Il est occupé, il pense. Le business n’est pas le labour, et business party n’est pas Labour Party. Les affaires, ce n’est donc pas du travail. Si l’argent travaille, c’est comme le bois qui se dilate et se rétracte mais où est sa production ? Lacan en 1973 voyait dans l’inconscient « le travailleur idéal, celui dont Marx a fait la fleur de l’économie capitaliste dans l’espoir de lui voir prendre le relais du discours du maître ». Mais que produit donc l’inconscient ? Ce que (presque) personne n’a envie de s’approprier. On propose pourtant un travail pour l’exploiter, appelé « travail analytique » pour s’occuper donc de la production de son inconscient, ses fruits. Lacan : « Celui qui fait le vrai travail en analyse, c’est celui qui parle, le sujet analysant ». Donc celui qui bosse, est pourtant réputé payer pour travailler ! Le rêve aussi travaille puisqu’on parle du « travail du rêve » Traumarbeit. Il y a aussi l’expression à la mode : le « travail du deuil ». Qu’on perde son travail, sa plus-value, sa belle-mère, sa virginité, son temps, ses dents, il faut faire son deuil, son travail de deuil. On entend ça à la radio : « on attend la cellule psychologique pour que les familles des victimes du crash commencent leur travail de deuil ». Et les victimes du krach en cours, vont-ils commencer leur travail de deuil ? Freud dans le « malaise dans la civilisation » écrit : . « L’homme essaie de satisfaire son besoin d’agression aux dépens de son prochain, d’exploiter son travail sans dédommagement, de l’utiliser sexuellement sans son consentement, de s’approprier ses biens, de l’humilier, de lui infliger des souffrances, de le martyriser et de le tuer. »
Si on remplace « son prochain » par la figure du psychanalyste, le voilà victime consentante du travail du transfert (working throught) (Durcharbeitung) et pourtant dédommagé de l’intérêt qui lui est porté et auquel il s’est offert en tant qu’entrepreneur entrepris par un entreprenant. Un entrepreneur qui ne travaille pas mais aussi produit du transfert de travail de celui qui le consulte jusqu’à ce qu’il le laisse tomber comme un déchet de son travail.
Les prémisses de la réflexion qui suit ici (autant dans le post de PYD que dans le mien d’ailleurs, merci à lui d’avoir toujours cette expression si limpide 😉 ).
La thèse de Jean-Luce Morlie consiste à prétendre que le travail est fondamentalement neutre – ni pénible, ni agréable – et que c’est l’organisation qui en est faite qui le fait pencher de l’un ou l’autre côté, offrant ainsi la perspective d’une autre voie possible ou l’activité la plus infecte aujourd’hui pourrait devenir demain source d’épanouissement…
Clown gris et moi (et quelques autres peut-être) prétendons au contraire que certains travaux sont intrinsèquement pénibles, et que leur mode d’organisation n’est jamais qu’un catalyseur OU un amortisseur de cette caractéristique, avec l’idée sous-jacente que le travail existe au delà de son mode d’organisation: Homo Habilis travaillait déjà en son temps sans pour autant disposer de notre mode d’organisation – il en avait un qui lui était propre, sans toutefois grand rapport avec le notre.
A moins donc de considérer que ce soit la collectivisation du travail elle-même qui soit à la source du problème, force est de reconnaître qu’il y a inégalité de fait dans la « qualité de vie » attachée aux différentes activités professionnelles, et que cette inégalité est indépassable, sauf à imaginer un système où toutes les tâches seraient exécutées par tout le monde – soit à tour de rôle, soit tous en même temps mais dans des proportions minimes, que sais-je encore? – ce qui ne ferait finalement que reporter le problème pour mettre en lumière l’inégalité de fait entre individus (biologique), puisque tout le monde n’a pas l’habileté d’un menuisier, l’intellect d’un doctorant, la condition physique d’un maraicher, etc.
En outre et enfin, je déplore que ce texte qui nous est proposé ait tenté de théoriser et rendre abstrait à l’extrême la chose la plus concrète et la plus pratique au monde, le travail. D’où l’orientation de mes réflexions dans la discussion, volontairement très « terre-à-terre ». L’idée n’étant pas de focaliser la réflexion sur telle ou telle activité en particulier, mais plutôt de rappeler qu’en ce domaine plus que dans d’autres, les seuls mots sont tout à fait insuffisants pour représenter convenablement le réel, et qu’il convenait donc d’y mettre les mains pour palper les choses pour de bon.
Deux remarques.
Votre ami « le clown gris » insiste : – Les hommes ne naissent pas égaux – et vous en rajouter « pour mettre en lumière l’inégalité de fait entre individus (biologique) »
Ce n’est pas « ma » thèse, je m’inscris dans le courant de l’histoire humaine de la nature humaine, jour après jour nous créons cette nature. Jean Piaget, biologiste, soulignait qu’il nous est inné d’être ouvert à l’acquis.
Choisissez votre bifurcation!
La douleur n’a d’autre fonction que de nous alerter d’un danger, certes nous sommes résistants, nous pouvons aller un peu au-delà du seuil d’alerte. Devant l’agression nous avons trois stratégies: le combat, l’inhibition de l’action, la fuite. Pour l’homme, la fuite permet par l’imagination technique de changer le cadre de l’agression. Si vous devez bêcher beaucoup, un tracteur avec l’air conditionné en écoutant France-Culture, c’est mieux , (je ne tiens pas compte de l’endettement vis-à -vis de votre banque, naturellement), mais vous me comprenez.
PS, Pour ma part, plutôt que des tracteurs j’imagine une permaculture BRF intégrée, sur banquette à hauteur de main.
@Jean Luce Morlie
Sur l’égalité:
Jean Piaget était certainement un brave homme fort compétent dans son domaine, pour autant je conçois mal qu’on puisse contester quelque chose d’aussi trivial que l’inégale répartition des talents entre les individus.
Si je comprends bien, selon lui, n’importe qui pourrait à la faveur d’un contexte social favorable, égaler le « génie » d’un Beethoven ou d’un Vinci… C’est à dire, même éventuellement une personne souffrant de troubles psycho-moteurs? Désolé si je parais obtus et un tantinet cruel sur ce point, mais je ne parviens honnêtement pas à me l’imaginer.
Notez à ma décharge que l’éducation nationale française participe pour beaucoup à mettre en évidence l’idée inégalitaire en évaluant régulièrement les acquis de ses élèves et en établissant des classements dès leur plus jeune âge, et que ma pensée a certainement été victime de ce mode de formation, dans une certaine mesure.
Sur la pénibilité:
La technique pour toute réponse à la pénibilité du travail, voilà qui me paraît largement insuffisant. Je vous épargne (ainsi qu’à moi) la longue liste de travaux qui ne peuvent se résoudre par ce genre d’artifice et qui requièrent inconditionnellement leur dose « d’huile de coude ». La résolution de ce type de problèmes ne se solde bien entendu pas toujours par un constat d’infaisabilité pur et simple, mais éventuellement par un différentiel bénéfice – coût jugé trop défavorable (ce que vous avez intuitivement vu en évoquant l’endettement attaché à l’achat d’un tracteur). Toujours est-il que nombre d’entreprises (notamment artisanales) ne peuvent évidemment pas se permettre d’avoir le budget de la NASA juste pour résoudre des questions de confort, si néfaste leurs problèmes soient-ils.
J’apprécie toutefois que vous admettiez mon point de vue par cette suggestion – même à demi-mot : La pénibilité du travail (ou plus précisément de certains travaux) est un donné, et le mode d’organisation est l’outil permettant d’y remédier – ou au contraire de l’amplifier. Je ne souhaitais justement pas dire autre chose.
P.S. Une idée sur laquelle nous nous retrouverons peut-être: Il est grandement nécessaire de revoir la valeur du mythe stakhanoviste, mythe qui s’est (étrangement?) bien acclimaté à l’économie de marché malgré ses origines soviétiques: Sa photo encadrée, bien en vue sur le comptoir de la sandwicherie américaine, on se sentirait presque l’âme d’un petit -ou d’un futur – Stakhanov… (même si les ventes de charbon demeurent assez marginales au McDo, je vous le concède 🙂 ).
Le fait que le culte de la performance se retrouve aussi bien aux heures les plus démentes de l’URSS que dans le fonctionnement des entreprises les plus emblématiques du monde capitaliste actuel devrait éveiller quelques soupçons, ou du moins quelques solides interrogations, non?
@ Dissonance 31 mai 2010 à 06:21
Extrait de « Retour d’URSS d’André Gide 1936
[…] « Je reviens au peuple de Moscou. Ce qui frappe d’abord c’est son extraordinaire indolence. Paresse serait sans doute trop dire… Mais le «stakhanovisme» a été merveilleusement inventé pour secouer le nonchaloir (on avait le knout autrefois). Le stakhanovisme serait inutile dans un pays où tous les ouvriers travaillent. Mais là-bas, dès qu’on les abandonne à eux-mêmes, les gens, pour la plupart, se relâchent. Et c’est merveille que malgré cela tout se fasse. Au prix de quel effort des dirigeants, c’est ce que l’on ne saurait trop dire. Pour bien se rendre compte de l’énormité de cet effort, il faut avoir pu d’abord apprécier le peu de «rendement» naturel du peuple russe. Dans une des usines que nous visitons, qui fonctionne à merveille (je n’y entends rien; j’admire de confiance les machines; mais m’extasie sans arrière-pensée devant le réfectoire, le club des ouvriers, leurs logements, tout ce que l’on a fait pour leur bien-être, leur instruction, leur plaisir), on me présente un stakhanoviste, dont j’avais vu le portrait énorme affiché sur un mur. Il est parvenu, me dit-on, à faire en cinq heures le travail de huit jours (à moins que ce ne soit en huit heures, le travail de cinq jours; je ne sais plus). Je me hasarde à demander si cela ne revient pas à dire que, d’abord, il mettait huit jours à faire le travail de cinq heures? Mais ma question est assez mal prise et l’on préfère ne pas y répondre. Je me suis laissé raconter qu’une équipe de mineurs français, voyageant en U.R.S.S. et visitant une mine, a demandé, par camaraderie, à relayer une équipe de mineurs soviétiques et qu’aussitôt, sans autrement se fouler, sans s’en douter, ils ont fait du stakhanovisme. […]
Vous lisez… ce n’est pas ce que vous décrivez.
Je n’ignore pas que certains rêvent de promouvoir l’inégalité de naissance, sur des bases qui ne sont pas de Droit mais biologiques et le droit suivrait comme d’habitude…, ça s’est déjà fait : les Untermensch, les sous-hommes. Renseignez-vous. C’est pénible que ça ne cesse de revenir.
@pvin
Vous êtes loin du compte, très loin du compte. L’approche que vous m’attribuez est en fait à l’exact opposé de l’idée que je soutiens (je ne m’attarde pas sur le point Godwin que vous frôlez de très près, ça n’en vaut pas la peine).
Je n’ai en l’occurrence aucun désir de « promouvoir » l’inégalité de naissance, je la constate car elle est un fait. Les Lumières aussi l’avaient constaté, c’est d’ailleurs bien pour cela qu’ils avaient décrété l’égalité de droits. Si l’égalité de naissance avait pu exister, décréter l’égalité de droits aurait sans doute été inutile.
Pour le dire plus simplement: Prétendre que deux individus sont identiques alors que l’un est petit et l’autre grand est simplement dénué de sens. En revanche, dire qu’ils disposent de droits identiques indépendamment de leurs tailles respectives est fondamentalement juste. Néanmoins, l’un aura plus de facilités que l’autre dans certaines activités, et ce bien que leurs droits soient les mêmes.
Quant au texte que vous citez, je ne vois pas ce qu’il est sensé démontrer… Gide met en évidence que le stakhanovisme soviétique repose sur des données biaisées, et alors?
Le postulat stakhanoviste demeure néanmoins valable pour la période actuelle: Nos managers considèrent que leurs employés n’en font pas assez et veulent qu’ils en fassent plus. La méthode reste également identique: La mise en avant de certains individus pour stimuler la productivité de l’ensemble.
Si vous voulez me faire dire que les rendements exigés en URSS à l’époque n’étaient absolument pas du même ordre que ceux exigés aujourd’hui dans les entreprises capitalistes je vous le concède bien volontiers, mais je ne vois pas en quoi cela influe sur le principe décrit sinon pour dire qu’il est bien plus néfaste aujourd’hui qu’il ne l’était à l’époque, ce qui va en fait très exactement dans le sens de mon propos.
@ Jean Luc Morlie
Dire qu’il y a une distribution inégale des talents n’est pas dire que les gens ne sont pas égaux. C’est juste dire qu’ils sont différents.
(égaux sur quelle dimension d’ailleurs? les ressources? le bien être? les capabilités comme dirait amartya sen? les « »biens premiers » comme dirait Rawls? etc… parler « d’égalité » purement et simplement c’est bon pour le café du commerce. Il faut préciser. Et c’est à ce moment là que les débats commencent)
Ou alors « inégaux » en terme d’aptitude à réaliser telle ou telle tâche. Les gouts, l’attirance pour tel ou tel métier, ne s’égalisent pas non plus, sauf dans les sociétés totalitaires.
Ne serait ce que les traits de caractère/tempérament jouent un rôle décisif. Tout le monde n’est pas capable de gagner sa vie au poker. Tout le monde n’a pas les capacités mentales qui font le « bon chirurgien ». Tout le monde n’a pas la patience ou les capacité d’empathie que requière telle ou telle activité de « soin ». Bien sûr vous pouvez les apprécier quand même, et vous pouvez également les pratiquer en y étant forcé par la nécessite, mais ça vous coutera « plus » ou « très cher » (au poker).
Tout n’est pas qu’une question de dispositions intellectuelles ou physiques.
Les émotions, les vertus jouent un rôle cardinal dans toute activité humaine. Et ca ca n’est absolument pas égalisable: j’ai lu je ne sais où que le « tempérament » par exemple (à ne pas confondre avec des notions proches) est « fixé » plusieurs semaines avant la naissance et qu’il ne bougera pas (du genre x ou y a tendance à se montrer « mou », et aucune « thérapie comportementale » n’y peut strictement rien changer… puisque c’est fixé en profondeur dans les sphères « inférieures » du cerveau).
Non, tout n’est pas « social » (notre nouveau tyran). Paul en parlerait sans doute mieux que moi mais il fut une période, celle de Piaget justement, où utiliser le mot « nature » était un « gros mot » dans les départements de sciences humaines. C’était du n’importe quoi. La réalité ne plait pas, alors on décrète qu’elle n’est pas comme ça, et on ne fait plus de la recherche mais de « l’instruction à charge » (heureusement entre temps l’éthologie humaine, non sans quelques abus, est revenue remettre tout ce petit monde dans le vrai bain de la réalité).
Du reste c’est très bien comme ça (si on écarte le rêve absurde dans lequel nous sommes tous Mozart et Einstein et Bill Gates et Golden Boy et parés de toutes les vertus)!
C’est justement cette diversité des talents (liée à qui accompagne la diversification des activités qui peuvent se développer au sein d’une communauté humaine, et c’est elle qui constitue la condition de possibilité de toute coopération sociale. Mais aussi… imagine t-on un orchestre composé seulement de violons? Imagine t-on que l’on choisisse ou qu’on tire au sort les violonistes le moins doué pour faire partie de l’orchestre, toutes choses égales par ailleurs?
Le problème de l’égalité concerne les chances égales de cultiver développer ses talents (et ceci requière une organisation sociale complexe), ainsi que la distribution des fruits de la coopération sociale (c’est là qu’intervient la question de la justice).
Or chacun de nous obtient infiniment plus par le biais de la coopération sociale que par ses propres moyens (imaginez que nous devions chacun construire notre maison!). C’est là « l’effet de levier » et la source des devoirs et des obligations que nous avons les uns à l’endroit des autres (et ca ne se réduit pas comme le pensent les libéraux à « payer » pour tel ou tel service, quand bien même la monnaie aurait été instituée pour remplir ce rôle de « mesure »).
Bien sûr il y a des chances pour que telle ou telle communauté produise des individus dotés de telles ou telles caractéristiques particulières en plus grand nombre, en raison de son mode de vie et du fait qu’elle encourage ou promeut les qualités qui permettent de mieux réaliser des activités jugées plus importantes (pour des raisons qui peuvent être « vitales » ou « religieuses » ou je ne sais quoi… il suffit de regarder les performances sportives des jamaïcains au sprint: la génétique y est peut-être pour quelque chose mais c’est surtout l’organisation sociale qui place le sprint au coeur de l’éducation des jeunes et de toutes les manifestations sportives qui joue un rôle crucial ).
Mais ceci concerne le type d’activité proposé et non pas la distribution initiale des talents. Il y a des gens plus talentueux que d’autres, dans tous les domaines. C’est un FAIT. Tout le monde n’est pas U. Bolt! Et de même il y a des activités plus pénibles/risquées que d’autres.
J’ajoute une dernière chose (sans rapport):
Malheureusement, l’idée selon laquelle la productivité des travailleurs est meilleure quand on améliore leurs conditions de travail est fausse (faudra que je remette la mains sur ces études en théorie des organisations). Même si j aurais aimé qu’elle fusse vraie… en fait les performances s’améliorent un temps puis reviennent à leur niveau de base.
La seule variable énormément significative en terme de productivité c’est le degré de cohésion sociale, d’unité, à l’intérieur du groupe de travailleurs dont les taches sont coordonnées.
Ca n a pas de rapport, mais c’est intéressant de le savoir.
@ le clown gris
j’allais justement vous écrire, mais en beaucoup moins bien, si si: ce que vous m’écrivez.
Votre dernière remarque me semble très importante.
Passé un seuil , la pragmatique des échanges sur un fil de blog est éprouvante.
A+
JLM
@ Dissonance
Votre premier §
a/Je me contrefous du point G
b/ Vous pouvez autant qu’il vous plaira contester la façon d’un autre d’entendre ce qu’il entend de ce que vous dites, pourtant ça ne vous appartient plus ; de plus vous êtes alors de ceux qui savent de ce qu’ils disent en faisant l’impasse sur la découverte de l’inconscient et l’invention de la méthode qui permet de s’entendre.
Second § :
Le constat des différences à la naissance n’ont pas attendues les Lumières. Mais comme de tout signe, sa lecture dépend du système disons symbolique pour faire court qui en fabrique une lecture dominante. La lecture de ces différences en termes « égalitaire/inégalitaire » avec leur poids sémantique est relative au contexte où elle advient.
Quatrième §
Gide met en évidence que les 2 derniers § de votre message du 31/05 06.21 montrent votre aveuglement. La version d’origine toujours en cours parle d’un concours spontané entre mineurs ensuite récupérée à fin d’émulation socialiste. Rien à voir avec Taylor, la division du travail, les cadences imposées, les primes à la performance ou les heures supplémentaires et Mac Do. L’ouvrier se sentait maître de son destin et son pays.
Ensuite, puisque je parle de maître et que vous parlez d’esclave, votre renvoi non critique à un site de calculs loufoques a raté la question d’évidence : et qui fournit les calories aux 100 esclaves par français ? Descartes s’est intéressé au corps machine…autrement.
Bien qu’il existe une pénibilité du travail à vous répondre, je vous fais pour une fois généreusement ce cadeau. (C’est juste parce que c’est un blog et qu’il y a d’autres lecteurs qui possiblement modifieront leur lecture).
Le point de départ de vos interventions est la phrase inaugurale :
Vous imaginez 29 mai 2010 à 16:08
qu’à cultiver votre potager aucune autorité capitaliste ne vous y contraint et que c’est un loisir. Il y a de fines formes de suggestions bien plus contraignantes qu’un rapport de forces, mais si vous parlez « loisir », vous êtes déjà dans les effets d’un système contextuel de l’organisation des « loisirs » cf. le coût des semences des oignons de votre père.
Vous imaginez 31 mai 2010 à 17:12
que la « pénibilité existe en dehors de tout contexte social » mais tout contexte social produit un lexique, une aire sémantique, dont tout effort de traduction entre langues produira une perte silencieuse en le désarrimant de toutes les chaînes langagières comme sociales auxquelles il est attaché. C’est illusoire de croire que ce simple terme de « pénibilité » réponde des mêmes affects en tous lieux et tous temps. J’insiste.
Vous imaginez 31 mai 2010 à 19:52
résoudre l’idée de pénibilité autrement qu’en le déplaçant sur le progrès technique. Mais ce progrès là, vous ne sauriez l’empêcher, personne ne le commande.
Vous congratulez Clown gris 30 mai 2010 à 02:36
pour avoir vu si loin dans votre propre façon de penser.
Qu’a t-il écrit ?
« Les hommes ne naissent pas égaux. C’est un fait, et certains devront travailler plus dur que d’autres pour parvenir au même résultat, parce que les talents sont inégalement répartis… » […] Et quelle solution ont-ils trouvé à la pénibilité du travail? Il n’y en a qu’une, qui consisterait à prendre le mal « à la racine »: une certaine forme d’eugénisme libéral: l’extension de la sphère du marché au domaine de la manipulation du patrimoine génétique des générations futures. L’égalitarisme a ses limites. »
Vous contestez 30 mai 2010 à 00:52
que le travail est une caractéristique humaine sans doute en imaginant que les sociétés de fourmis travaillent puisque qu’elles ont des ouvrières.
Vous poursuivez dans une lecture biologique de l’arrêt du travail : « une certaine satisfaction de nature bêtement chimique et tout à fait relative, induite par le cerveau ». A quand le gène de la pénibilité du travail ?
Enfin vous trouvez « illusoire de chercher à considérer le travail autrement que comme une douleur nécessaire » mais vous ne dites rien sur sa nature chimique, comme pour la satisfaction ?
Le corps machine, c’est pas nouveau, mais la réduction de celui-ci au tableau de Mendeleïev, bigre.
30 mai 2010 à 15:18
encore la pénibilité pré-existante au contexte social. Comment mesurer vous ça, la pénibilité ? Le savoir médical évaluatif ? le témoignage ? les deux ? Et surtout en dehors du contexte social !
30 mai 2010 à 22:22 « Homo Habilis travaillait déjà en son temps ».Un écolier se ferait corriger en parlant d’un homme préhistorique partant au travail même avec un outil.
Ensuite vous parlez de :
« mettre en lumière l’inégalité de fait entre individus (biologique), puisque tout le monde n’a pas l’habileté d’un menuisier, l’intellect d’un doctorant, la condition physique d’un maraicher »
31 mai 2010 à 06:21
Vous vous répétez trivialement sur « l’inégale répartition des talents entre les individus, .puis sur la faveur d’un contexte social favorable où n’importe qui pourrait égaler le « génie » d’un Beethoven ou d’un Vinci ».
Puis dans un glissement où vous évoquez les évaluations scolaires des acquis, vous suggérez que celles-ci mettent en évidence l’idée inégalitaire (de « l’inné-galitaire » donc du paragraphe qui précède).
Je maintiens donc que votre discours promeut les critères d’inégalité de naissance, (biologique) comme vous précisez donc et entre parenthèses ce « biologique », pour « expliquer » ce que vous appelez « habilité d’un menuisier » ou « intellect d’un doctorant ».
Je maintiens mon opposition à ce type de promotion, lisible par votre insistance à dénommer les différences à la naissance sous le terme « d’inégalité ».
Enfin je remarque que vous utilisez deux fois l’appel à votre « honnêteté » dans vos messages.
C’est remarquable.
@pvin
Restons-en là. A l’évidence cet échange ne mènera à rien.
J’ habite une commune riche: elle possède sept sources, un canal EDF et son usine de production, une immense forêt exploitée, de magnifiques jardins irrigués par un réseau de canaux. Le village voisin n’ a rien de tout cela. Dans le temps, la vie était bien différente dans les deux villages, la quantité de travail nécessaire pour se nourrir aussi. Cette injustice à sept kilomètres, visible sur les constructions humaines est plus ou moins rééquilibrée par l’ état.
Je dis souvent que travailler, c’ est faire du sport!
Mais là ou je « travaille », une multinationale, c’ est le stress dont les gens se plaignent, les trente cinq heures de présence avec la pression de chefs pressurés, engendrant des phénomènes carriéristes. Chacun protégeant son jardin. Drôle de travail où les pièces du puzzle n’ ont pas d’ autre choix que l’ absentéisme qui atteint les dix pour cent!
Merci pour ce Blog.
Le sens populaire des mots change avec le temps, c’est-à-dire avec les conditions extérieures. Par conséquent l’étymologie d’un mot n’a souvent plus grand chose à voir avec sa définition actuelle. Définir un mot comme =x parce que ce mot signifiait x à l’origine n’est qu’un argument sophistique, qu’Heidegger et ses épigones, par exemple, utilisaient fréquemment pour « prouver » tout et n’importe quoi (au besoin en se servant d’étymologies fantaisistes, d’ailleurs). Quand donc quelqu’un tente de démontrer que tel mot a tel sens parce qu’il a tel sens à l’origine, prudence… A l’extrême, cela peut conduire à faire croire que certains sens (des sentiments, des sensations…) ne sont même pas légitimes ! (ici : « Mon brave, il n’y a pas lieu de se plaindre que le travail soit pénible, puisque travail vient de tripalium ! »)
Vous avez tout à fait raison.
Colin Renfrew, dans « archéologie et langage » proposait d’abandonner la représentation de l’origine des Indo-européens par le traçage de belles flèches sur une carte. De même, réduire le buissonnement du langage en reconstruisant une arborescence inverse crée une impression de logique, et passe côté l’essentiel du langage : le fait que la conscience soit un épiphénomène émergeant après coup de la dynamique d’affect sous-jacente.
Paul Jorion a abordé cette problématique de façon très intéressante dans Intelligence artificielle et mentalité primitive. Actualité de quelques concepts Lévy-bruhliens. Le texte est sur son site.
« Il serait bon d’imaginer une nouvelle science linguistique, elle étudierait non plus l’origine des mots, ou l’étymologie, ni même leur diffusion, ou lexicologie, mais le progrès de leur solidification, leur épaississement le long du discours historique ; cette science serait sans doute subversive, manifestant bine plus que l’origine de la vérité, sa nature rhétorique, langagière » Roland Barthes, cité pa
Dans Wikipedia ….WittgensteinLa définition d’un mot au moyen d’autres mots mène à une régression à l’infini (pour comprendre le mot expliqué il faut comprendre les mots qui servent à l’expliquer, et pour comprendre ceux-ci il faut comprendre les mots qui servent à les expliquer, et ainsi de suite).
Wittgenstein propose alors d’identifier la signification d’un mot à son USAGE.Ceci signifie que nous n’apprenons pas le sens des mots que nous utilisons en apprenant des concepts mais dans la pratique du langage. Wittgenstein parle souvent de dressage (Abrichtung).
En effet travail peut prendre des sens complètement différents selon le contexte comme le dit très justement Xavier. Le travail de l’ouvrier moderne qui trouve tout devant lui déjà pensé et n’a plus qu’à exécuter n’a rien à voir avec celui de son patron qui a pensé et s’est réservé lla division de ce même travail et le plaisir qui l’accompagne. Plaisir si total qu’il est la principale tâche de l’économie de cacher sous des aspects utilitaristes. Les hommes se grouperaient soit disant parce qu’ensemble ils produiraient un gateau est plus gros alors qu’ils se groupent simplement pour le plaisir de se grouper. La nourriture et les besoins n’étant que des prétextes.
@ kabouli
la citation de Barthes, reprise du texte de Paul, ajoute l’histoire des tours et détours des usages successifs. J’ai simplement voulu attiré l’attention sur le rôle d’une l’étymologie écran.
A+
Et bientôt, même malade il faudra continuer à travailler !
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2010/05/29/04016-20100529ARTFIG00350-sante-600-millions-d-euros-d-economies-d-ici-2010.php
Pöur comprendre un mot , il faut comprendre la langue .
Poor comprendre la langue , il faut comprendre la culture.
Pur comprendre la culture , il faut comprendre la vie .
Père comprendre la vie, il faut naitre .
Pir comprendre la naissance , il faut comprendre l’endroit .
Po comprendre l’endroit , il faut le parler à l’envers .
« Le Ciel , Donner, et Dieu , dans la langue tzigane , c’est le même mot » dit
Alexandre Romanès.
PS : « le travail, enfermer, et désespoir » dans la langue des cancres , c’est le même mot .
Mais , si sur terre, il a existé une civilisation où les racines du mot travail sont à chercher dans celles
des mots jeux , bonheur , autonomie, évolution … alors oui, je veus bien m’y intéresser et détourner mon regard du vol des mouches .
N’était-on pas condamné aux travaux forcés couplée à la dégradation civique?
Ne dit-on pas travailler comme un força?
La liberté informatique des un ne passe-t-elle pas par le camps de travail chinois des autres?
Est-il péjoratif, ou pas, de travailler de la cafetière?
Et dire que des ouvriers font des centaines d’heures d’usines pour pouvoir faire des milliers de kilomètres en voiture pour aller courir des marathons.
Trouver dans ma bibliothèque ce matin, la revue « Esprit » – Août-Septembre 1995 – numéro consacré à l’avenir du travail:
p. 72 – Le temps dominant, qui fut le temps sacré dans les sociétés primitives, le temps religieux au Moyen Age et le temps de travail depuis le début de l’ère industrielle pourrait bien être dorénavant le temps libre (1). Toutefois, il ne s’agit pas forcément d’une bonne nouvelle, du moins à court terme, car, en perdant son importance « quantitative », le travail perd en même temps sa fonction d’intégration sociale et se crée par là même, au coeur des sociétés industrielles, un « vide cybernétique » que rien, pour le moment, ne semble devoir combler. ( ds « Révolution informationnelle et mutation du travail »par Jean-Paul Maréchal citant (1) R. Sue, « Temps et ordre… » 1994 p 124)
p. 85 – Sans doute devons-nous aujourd’hui rendre leur sens aux mots et ne plus confondre la culture, c’est-à-dire la mise en valeur des capacités humaines, qui s’accompagne elle aussi le plus souvent de souffrance, de création, de joie, avec le seul travail, comme si la lecture, l’apprentissage, l’éducation, l’art, l’amitié, la cuisine…, devaient tous être subsumés sous le concept unique de travail! Croire que tout cela est du travail, confondre ces activités et ces façons diversifiées d’être humain avec l’exercice d’une activité rémunérée qui récompense la contribution apportée par chacun à la production nationale, c’est confondre l’action et la production – or, comme le soulignait déjà Aristote, la vie est action, non production. Pour le dire encore plus clairement, car c’est bien là le centre de ma démonstration, ce qui s’est passé au cours des deux derniers siècles, ce n’est pas la réduction d’un pseudo-concept de travail au travail salarié, c’est au contraire la réduction de l’ensemble des activités multiples et diversifiées au seul travail; c’est l’invention du concept de travail. ( ds « La fin de la valeur « travail »? » par Dominique Méda)
@ Jean-Luce Morlie,
Je lis votre texte plein d’informations utiles.
Vous nous proposez une lecture commentée du mot « travail », en nous montrant que, au delà de toute dissection linguistique des mots, il existe une lecture inconsciente.
Cette lecture inconsciente est le miel des poètes.
Je pense alors à une phrase de Mallarmé que mon professeur de français de lycée nous avait fait écrire. Une phrase issue de la préface au « Traité du verbe » de René Ghil (intitulé en langage Mallarmé: « Avant-Dire au Traité du verbe »):
Voici la phrase, je l’ai retrouvé:
« Je dis fleur! et hors de l’oubli où ma voix relègue aucun contour, en tant que quelque chose d’autre que les calices sus, musicalement se lève, idée même et suave, l’absente de tous bouquets. »
De la même manière, lorsque nous disons travail, hors de l’oubli où nos voix relèguent l’expérience du travail, en tant que quelque chose d’autre que le mot du dictionnaire, se lève, idée même, l’absent de tout code du travail.
C’est ce que vous avez montré.
—————
Voilà l’emploi étonnant que fait un autre poète de ce mot travail:
LA PORTE
La porte de l’hôtel sourit terriblement
Qu’est-ce que cela peut me faire ô ma maman
D’être cet employé pour qui seul rien n’existe
Pi-mus* couples allant dans la profonde eau triste
Anges frais débarqués à Marseille hier matin
J’entends mourir et remourir un chant lointain
Humble comme je suis qui ne suis rien qui vaille
Enfant je t’ai donné ce que j’avais travaille
(Guillaume Apollinaire, « Alcools »)
* dans un cahier de jeunesse, Apollinaire à écrit: « Les poissons pi-mu (aux yeux accouplés) n’ont qu’un oeil. Les poissons pi-i (aux ailes accouplées) n’ont qu’une aile. Ils vont par couple (Poème chinois) ».
Il y a une chanson très drôle de Jean Ferrat ( j’ai oublié le titre ) sur le droit à la paresse .
Il s’agit de « état d’âme » , facile à trouver sur you tube .