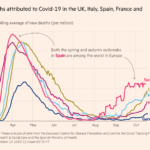
Le statu quo n’est pas envisageable
Profiterons-nous de la pandémie pour opérer les transitions nécessaires, pour infléchir les comportements dans la direction d’un avenir durable et renouvelable ou bien concentrerons-nous tous nos efforts sur une reconstruction à l’identique de nos économies, aussi menacé qu’en soit le modèle ?
Les retombées de la crise de 2008 justifient le scepticisme. Souvenons-nous de M. Sarkozy, et de son enthousiasme dix jours à peine après l’effondrement des marchés financiers : « L’autorégulation pour régler tous les problèmes, c’est fini, déclarait-il. Le laissez-faire, c’est fini. Le marché qui a toujours raison, c’est fini. »
Comment appelle-t-on de telles proclamations tonitruantes, fruits de circonstances très particulières : des serments d’ivrogne. Dont le souvenir s’efface entièrement avec le retour à la sobriété.
Pourquoi rebâtirait-on le même plutôt que selon le concept neuf dont on nous assure qu’il est impératif : une société sans émissions de gaz de serre, aux énergies renouvelables et propres, sans déchets plastiques et nucléaires, et respectant la biodiversité ? Pour une première raison évidente : l’identique est sûr parce que connu alors que l’avenir n’est ni l’un, ni l’autre. Pour modeler l’avenir, il faut se représenter clairement ce qu’il devrait être. S’il est planifié, il est possible de tirer parti d’une crise pour accélérer le processus de mise en oeuvre des objectifs visés. Mais s’il ne l’est pas…
Or, le statu quo ne requiert aucune planification : il suffit de confier aux marchés le soin de décider de l’avenir comme l’aboutissement de millions de décisions individuelles, chacun cherchant à satisfaire son intérêt propre : la « main invisible » dont nous parlait Adam Smith.
Mais, et c’est cela la « tragédie des communs » : pour une espèce comme la nôtre, enfreignant désormais la capacité de charge de son environnement, l’optimisation des comportements individuels précipite l’épuisement des ressources naturelles et la destruction du milieu.
Les marchés ont trop courte vue. Chaque entreprise dispose sans doute d’une représentation adéquate de son propre avenir sous la forme de son carnet de commandes, complétée de la vision qu’a l’organe porte-parole de son secteur, lequel a toujours bien du mal cependant à coordonner ce que pensent ses membres : les intérêts des grands groupes, des PME, et des sous-traitants ne coïncident pas nécessairement.
La reconstitution prioritaire du statu quo se justifie pour une seconde raison : l’urgence que constitue la détresse des salariés. Faut-il vraiment des avions pour faire des sauts de puce entre villes à deux heures l’une de l’autre par le train ? Qu’importe ! il y a des pilotes, des hôtesses de l’air, du personnel d’entretien, qui crient famine en cet instant : remettons-les au travail sans tarder ! Restaurons le statu quo toutes affaires cessantes, et pour ce qui est du reste, on avisera plus tard.
Le résultat est prévisible : une fois le statu quo rétabli, un soupir de soulagement sera poussé, et on aura cessé de comprendre pourquoi il faudrait changer quoi que ce soit.
Or, pendant ce temps-là … en Chine…
Oui, précisément : la Chine, seule puissance probablement à la croissance positive en 2020 et 2021, innovante en Intelligence Artificielle et dans le Big Data, dont elle devient maîtresse de la définition des normes industrielles.
Le Fonds monétaire international (FMI) qui, sur une erreur de calcul, nous avait enjoint en 2009, l’austérité, nous encourage aujourd’hui à « suspendre temporairement les règles budgétaires ». Gita Gopinath, son économiste en chef a déclaré : « À l’avenir, les gouvernements vont probablement devoir améliorer la progressivité de leurs impôts, tout en s’assurant que les entreprises paient leur juste part ». Décidément, les temps changent…
Répondre à Robin Denis Annuler la réponse