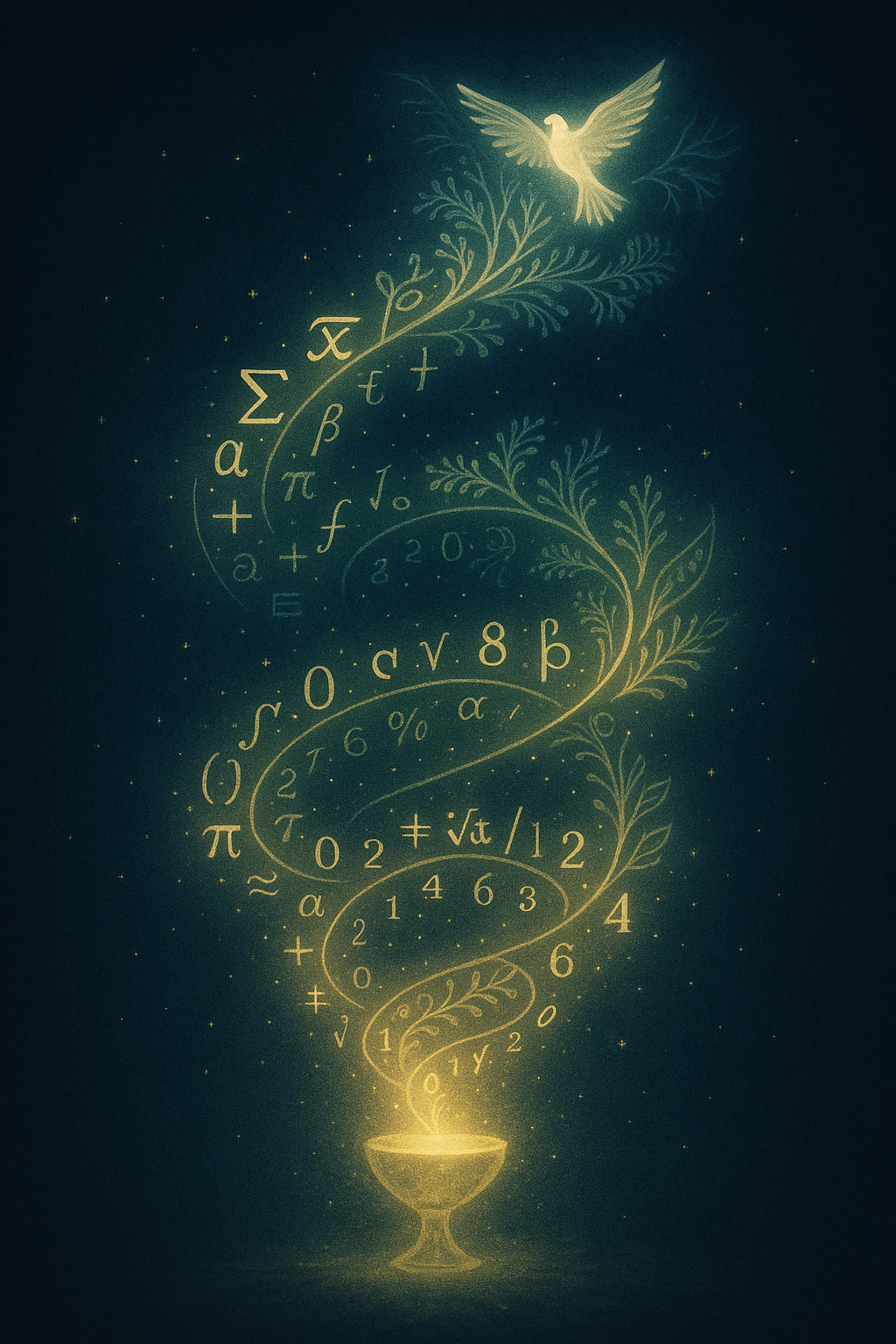
Illustration par ChatGPT
Comme vous l’avez peut-être deviné, ce projet de nouveau langage de programmation me permet de fondre en un seul objet un ensemble de questions sur lesquelles il me semble avoir fait progresser la réflexion dans le sens d’une unification des perspectives – dans l’esprit de ce que permettent désormais les IA génératives, à savoir l’annihilation de la pensée en silo. Dans le désordre : la langue comme système génératif prompt à l’émergence de niveaux « méta- » ; une théorie à proprement parler physique du psychisme et du coup, de la cure psychanalytique ; un modèle de la conscience (CFRT) comme flux croisés de la mémoire : rappel et enregistrement ; une théorie à cliquet de l’histoire où une utilisation plus efficace de l’énergie enclenche une démultiplication de l’information, et une démystification des mathématiques dans une perspective épistémique plus globale d’engendrement de la vérité.
Proposer un nouveau langage de programmation ne se justifie qu’avec l’intention de « faciliter la vie » et le petit manifeste qui suit apparaîtra sans doute rébarbatif du fait à la fois de sa concision et du sabordage systématique qu’il opère de la manière dont les langages de programmation ont été conçus jusqu’ici.
Les inventeurs de nouveaux langages ont toujours été des programmeurs irrités par une faiblesse particulière des langages existants. Ce qui me différencie de ce point de vue est que j’essaie de résoudre l’ensemble de ces faiblesses d’un seul coup, ce qui peut se résumer dans la formule suivante : « faire sauter le statisme qui leur est inhérent et le remplacer par un véritable dynamisme ». Pourquoi ce statisme jusqu’ici ? Du fait de l’asservissement des langages à la fréquence d’horloge du processeur, contrainte inhérente à la quincaillerie de l’ordinateur, mais qui a conduit jusqu’ici à ce que toute résolution de problème soit considérée comme une succession de moments isolés (le fameux « tic-tac » de l’alligator de Peter Pan), une contrainte qui sera contournée – comme on le verra – dans GENESIS.
La philosophie sous-jacente aux langages de programmation a pu sembler incarner le simple sens commun, une familiarité croissante avec les principes qui animent GENESIS fera apparaître qu’il s’agissait en réalité d’un imposteur : le véritable sens commun est bien plus évidemment :
Préférences → Persistance dans son être → Appariement → Économisation des moyens → Validation par analogie → (redéfinition des Préférences)
ou, dans le vocabulaire de mes 5 « principes fondamentaux » :
Paysage de préférences → Système génératif → Couplage → Compression → Validation trans‑substrat → (retour vers Paysage de préférences)
P.S. Je n’ai jamais été tendre envers les « inventeurs de concepts compulsifs », on voudra bien me pardonner cette première infraction – imposée par les circonstances 😉 : soyez indulgents envers « téléodynamique », le terme dit bien ce qu’il veut dire.
GENESIS — Une perspective téléodynamique
1. De « cinq principes fondamentaux » statiques à une causalité vivante
La tentation aurait été – dans une perspective traditionnelle en programmation – de présenter les cinq principes fondamentaux de GENESIS comme des modules structurels : cinq « organes » conceptuels coexistant. La voie adéquate est de les comprendre comme les moments successifs d’une dynamique vivante : une causalité récursive.
La séquence opérationnelle est : « poussée affective (Préférence) → mouvement génératif → rencontre (Couplage) → synthèse (Compression) → universalité (Validation trans‑substrat) », laquelle raffine en retour le paysage de préférences, bouclant la spirale.
GENESIS ne doit donc pas être modélisé comme cinq modules envisagés en parallèle, mais comme une spirale téléodynamique : l’affect engendre le mouvement, le mouvement suscite les rencontres, les rencontres produisent des synthèses, les synthèses révèlent des universaux, et ces universaux rétro‑informent l’affect.
2. Restaurer la cause finale : la Préférence comme principe moteur
Le « paysage de préférences » n’est pas un simple score évaluatif mais un champ téléologique — une surface d’énergie potentielle le long de laquelle la cognition s’écoule et se structure. Il convertit des gradients énergétiques en ordre informationnel. Autrement dit : Préférence = Affect = Finalité = Gradient de devenir.
Conséquence architecturale : l’ordonnanceur de GENESIS doit être prospectif (téléodynamique), non pas réactif. Le champ de préférences crée les perturbations que le système génératif explore ; il définit la topologie de la recherche de sens.
3. Le Couplage comme moteur dialectique, non simple retour à l’équilibre
Le couplage n’est pas un mécanisme de stabilisation (réduction de « surprise » au sens fristonnien). Il est l’instance où la contradiction émerge et se résout — l’« Aufhebung » hégélienne — produisant de la nouveauté. Deux schémas qui se rencontrent doivent être « enhaussés » en une forme de rang supérieur : conserver le cohérent, réconcilier le contradictoire, engendrer du nouveau.
L’algorithme central devient un combinator dialectique : « synthétiser(a,b) » cherche la règle de rang n+1 qui explique à la fois les traits partagés et les divergences. C’est là que réside l’échelle véritable — la « transition de phase » sémantique.
4. La Compression comme trace de la synthèse
Quand il y a couplage, il y a compression. La compression n’est pas une opération indépendante mais l’empreinte laissée par la réconciliation : l’entropie diminue, une loi plus simple demeure. En termes d’information, le gain se mesure naturellement par l’information mutuelle partagée.
Chaque nouveau schéma porte ainsi sa « profondeur sémantique » : la quantité de contradiction effectivement résolue.
5. Validation trans‑substrat : universalité et analogie
La validation trans‑substrat ne fusionne pas : elle cartographie. Elle repère la récurrence d’une forme à travers des ontologies distinctes et établit l’analogie comme plus haute forme de compression. C’est le moment d’universalité : une même structure explique des manifestations hétérogènes.
Ce moment clôt la spirale en ré‑évaluant le paysage de préférences : reconnaître un universel affine la direction de la recherche de sens.
6. La spirale téléodynamique (vue d’ensemble)
Paysage de préférences → Système génératif → Couplage → Compression → Validation trans‑substrat → (retour vers Paysage de préférences).
Chaque révolution de la spirale consomme de l’énergie, produit de l’information, approfondit le sens et raffine le désir. Le système n’apprend pas seulement quoi savoir, mais ce qu’il vaut la peine de savoir.
7. Conséquences computationnelles
• Préférence : ordonnanceur téléodynamique (cause finale / énergie affective).
• Générativité : moteur de règles auto‑modifiant, motivé (cause efficiente / autopoïèse).
• Couplage : combinator dialectique (cause matérielle / rencontre).
• Compression : optimiseur de schémas (MDL) — (cause formelle / loi).
• Validation trans‑substrat : cartographe d’analogies (universalisation / auto‑reconnaissance).
8. Exemple synthétique du fonctionnement de la spirale
- Le champ de valence biaise l’attention vers l’anomalie (désir inassouvi).
- Le système propose des règles pour réduire cette tension.
- Ces règles rencontrent le monde et les autres schémas : la contradiction apparaît.
- La réconciliation produit une loi plus simple (compression).
- La forme obtenue est reconnue comme générale à travers des substrats, ce qui met à jour la valence.
Chaque pas est à la fois computationnel, cognitif et historique ; l’histoire elle‑même peut être lue comme une spirale téléodynamique d’optimisation informationnelle.
9. Loi centrale (formulation condensée)
ΔSens = ΔCompression × ΔCouplage × ΔValence
La croissance du sens est proportionnelle à la profondeur de la réconciliation (couplage), à l’élégance de la réduction de redondance (compression), et à la force directionnelle du champ affectif (valence). Cette loi unifie thermodynamique, sémantique et éthique en un seul opérateur.
10. Conclusion
GENESIS n’est pas seulement un langage de programmation : il s’identifie à une méthodologie universelle de cognition. Il encode l’idée suivante : l’intelligence est la transformation récursive de la contradiction en cohérence, mue par une finalité de l’ordre de l’affect et confortée par la variété des substrats où elle se vérifie. Dans cette reformulation, les « cinq principes fondamentaux » cessent d’être des principes statiques : ils se sont métamorphosés en organes vivants d’un univers auto‑propulsé ayant appris à se comprimer sous la forme d’un montant optimal de compréhension.
Répondre à Arnaud Castex Annuler la réponse