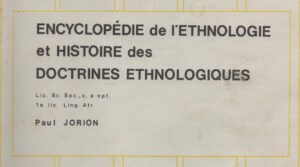
W.H.R. Rivers (1864-1922)
A paru dans les notes de mon cours Encyclopédie de l’ethnologie et histoire des doctrines ethnologiques publiées aux Presses Universitaires de Bruxelles en 1979, pp. 35-39.
Rivers est probablement un des personnages les plus intéressants de l’histoire de l’anthropologie et, en tout cas, un personnage décisif du tournant que prit l’anthropologie au début du XXe siècle. Bien que tard venu à l’anthropologie et continuant à mener de front une carrière de psycho-physiologue et de médecin, il contribua magistralement à l’anthropologie par un nombre limité de publications très peu répétitives. Rivers est le fondateur des études modernes sur la parenté, le premier théoricien de l’anthropologie de terrain et enfin une des trois principales figures de l’école hyper-diffusionniste (migrationniste) britannique. Il sera pendant de très nombreuses années le « supervisor » de Radcliffe-Brown et verra Malinowski appliquer sur le terrain la méthode de l’observation participante qu’il avait élaborée – et s’en approprier la paternité.
William Halse Rivers Rivers est né le 12 mars 1864 près de Chatham en Angleterre. Son père était pasteur et sa mère était la sœur de James Hunt, le fondateur de l’Anthropological Society of London. D’une certaine façon, la fée anthropologie s’était donc penchée sur son berceau, mais sans beaucoup d’effet puisque, devenu jeune homme, Rivers refusa d’hériter de la bibliothèque anthropologique de son oncle, affirmant qu’il n’aurait aucun usage de ces ouvrages.
Rivers fit des études de médecine à l’Université de Londres puis pratiqua au St. Bartholomew’s Hospital à partir de 1882. Il devient médecin des armées et accomplit à cette occasion quelques croisières qui le menèrent en Amérique et au Japon avec la flotte de guerre britannique. À partir de 1890, il fit plusieurs stages en Allemagne où il suivit les progrès de la nouvelle neuro-physiologie, il fut ainsi l’élève de Binswanger et de Kräpelin dont il sera pour un temps le collaborateur. Il se mit alors à enseigner la psychologie expérimentale dans le cadre de Guy’s Hospital à Londres. En 1897, il est nommé chargé de cours à Cambridge et en 1898, il accepte l’invitation de Haddon de participer à la Cambridge Anthropological Expedition to Torres Straits.
Il s’engagea alors dans une série de recherches anthropologiques, il étudia ainsi les Todas de l’Inde du Sud, puis il se rendit en Mélanésie en 1908 et en 1914. Ses ouvrages The Todas et The History of Melanesian Society seront respectivement publiés en 1906 et en 1914. Il n’abandonna pas pour autant ses recherches en psycho-physiologie puisqu’à partir de 1903, il entreprit avec le professeur Henry Head une série de recherches sur la sensibilité cutanée qui aboutira à la distinction entre sensibilité protopathique et sensibilité épicritique. Durant la première guerre mondiale, il serait responsable de clinique pour le traitement du « shell-shock » (littéralement « choc d’obus »), les « névroses de guerre ». De 1920 à 1921, il fut Président de la Folklore Society et, brièvement, de 1921 à sa mort en 1922, Président du Royal Anthropological Institute. Il avait précédemment été l’un des fondateurs du British Journal of Psychology (1904) et, au moment de sa mort à cinquante-huit ans, il était candidat travailliste aux élections législatives.
L’œuvre psychologique de Rivers nous retiendra moins, mais il faut cependant la signaler dans la mesure où elle eut un retentissement sur ses recherches anthropologiques. J’ai déjà eu l’occasion de signaler le rôle de Rivers dans l’Expédition aux Iles du Détroit de Torrès, ses investigations sur le terrain prolongeaient ses travaux en Allemagne où il s’était surtout intéressé à la théorie de la vision colorée de Hering. Sa recherche avec Head consistait en l’expérience suivante : un nerf du bras de Head avait été coupé, puis ses deux extrémités remises en contact, Head et Rivers observaient les modalités du retour de la sensibilité. Le résultat de l’expérience avait été, selon les deux hommes (leurs conclusions furent rapidement contestées) la découverte de deux types de sensibilité cutanée, la sensibilité protopathique, douloureuse, diffuse et procédant selon le tout ou rien, première à se remanifester, et la sensibilité épicritique progressive et très localisée, qui ne réapparaissait qu’après le retour de la sensibilité protopathique.
Ce résultat s’accordait bien avec la neurophysiologie de Hughlings Jackson(un médecin qui, avec Ferrier, était à l’origine de cette discipline en Angleterre) qui distinguait dans le système nerveux deux composantes, l’une primitive, l’autre récente et complexe. Dans une série d’articles, Rivers devait utiliser ses concepts de sensibilité protopathique et épicritique pour caractériser des types de comportements, les comportements individuels faisant appel à une conscience épicritique, tandis que les comportements grégaires ou collectifs faisaient appel à une conscience protopathique, plus animale, plus primitive (il rejoignait ainsi les préoccupations de la psychologie des foules de Le Bon). Il reconnaissait trois facettes aux processus grégaires, une dimension cognitive : l’intuition, une dimension affective : la sympathie et une dimension motrice : le mimétisme. Dans la mesure où ces processus agissent à notre insu, il y reconnaissait différentes manifestations de la suggestion.
Rivers était très attentif sur le plan épistémologique et découvrait invariablement et dénonçait impitoyablement des erreurs méthodologiques dans les procédures utilisées par ses collègues. Il s’efforçait également de séparer les effets objectifs de ceux dus à la suggestion, et en particulier, dans ses conférences sur l’effet de l’alcool (1908) il attirait l’attention sur la part des effets attribués à l’alcool et qui dérivaient en fait d’effets de suggestion.
Rivers fut un des premiers médecins britanniques à intégrer l’apport de Freud. Il avait cependant une conception beaucoup plus classique des processus psychiques puisqu’il voyait dans les troubles « nerveux » la prépondérance de processus protopathiques sur les processus épicritiques, une conception proche de celle de Jackson. Son expérience des névroses de guerre en 1914-18 allait lui permettre de contribuer à cet aspect de la psychothérapie également, son ouvrage principal dans ce domaine fut Instinct and the Unconscious (1920). C’est pour une étude où il rapprochait les théories du rêve de Freud et de Rivers (The Mind in Sleep) que le futur anthropologue Reo Fortune (Sorcerers of Dobu) obtint une bourse qui lui permit de quitter la Nouvelle-Zélande pour l’Angleterre.
L’historien de l’anthropologie, Ian Langham, a très bien mis en évidence comment l’opposition entre protopathique et épicritique traverse toute l’œuvre de Rivers, y compris son œuvre proprement anthropologique, en même temps qu’elle lui permit d’offrir un cadre théorique à l’interprétation de certaines difficultés de sa vie privée.
L’œuvre anthropologique de Rivers se partage en deux grandes époques, l’une que l’on pourrait appeler « sociologique » va de 1898 à 1911, l’autre qui s’étend de 1911 à sa mort en 1922 peut être qualifiée d’« historique ». La charnière est constituée d’un texte intitulé The Ethnological Analysis of Culture qui fut le discours prononcé par Rivers lors de son accession à la Présidence de la section anthropologique de l’Association Britannique pour l’Avancement des Sciences. Dans ce texte, Rivers annonçait sa conversion à l’hyper-diffusionnisme alors mené par un anatomiste et égyptologue australien que Rivers avait converti à l’anthropologie : Grafton Elliot Smith.
La contribution de Rivers à l’anthropologie débute donc par sa participation à l’Expédition aux Iles du Détroit de Torrès en 1898. Rivers établit des généalogies pour connaître le lien de parenté exact existant entre ses informateurs dans ses expériences sur la vision colorée et l’acuité visuelle. Revenu en Angleterre, il ne tarde pas à constater l’usage sociologique qui peut être fait des informations contenues dans les généalogies et tout particulièrement leur utilisation en statistique démographique. (« A Genealogical Method of Collecting Social and Vital Statistics », Journal of the Royal Anthropological Institute 1900).
Les années durant lesquelles il a l’occasion de faire du terrain chez les Todas et en Mélanésie sont surtout consacrées à une réflexion sur les terminologies de parenté et sur les problèmes méthodologiques que pose le travail de terrain mené par l’anthropologue en personne. L’introduction de The Todas (1906) est une réflexion méthodologique, de même qu’un texte intitulé Report on Anthropological Research Outside America (1913) écrit à la demande d’un organisme gouvernemental américain. Il y insiste sur l’urgence de la collecte de l’information dans les régions du Pacifique où les populations s’acculturent rapidement à la civilisation occidentale ou disparaissent purement et simplement, victimes d’un effondrement démographique. On trouve dans ce texte la définition du type d’enquête approfondie qui restera liée au nom de Malinowski : « Le trait essentiel du travail intensif – (….) est sa limitation dans l’espace combinée à l’intensité et à l’exhaustivité. Un cas typique de travail intensif est celui où le chercheur vit pour un an ou plus dans une communauté de quatre à cinq cents personnes et étudie chaque détail de leur vie et de leur culture; il en vient à connaître personnellement chaque membre de la communauté ; il ne se contente pas de généralités, mais étudie chaque trait de la vie quotidienne et des usages dans leurs détails concrets et au moyen de la langue vernaculaire » (p. 7).
En 1912, Rivers a l’occasion de passer quelques semaines sur l’Ile d’Eddystone en compagnie de son élève Arthur Maurice Hocart ; il écrira plus tard qu’il s’agit du premier exemple d’enquête intensive, bien qu’ils aient été très loin de séjourner une année entière dans cette île du Pacifique.
Les années 1911 à 1914 voient la parution des principaux textes de Rivers d’inspiration hyper-diffusionniste. Il y a bien entendu les deux volumes de The History of Melanesian Society (1914) où Rivers tente un exercice difficile de reconstruction historique appliqué aux populations des Iles Banks et des Nouvelles-Hébrides, mais aussi deux articles très remarquables, « The Disappearance of Useful Arts » (1912) où il essaie d’expliquer comment certaines populations polynésiennes ont pu oublier des techniques dont il est prouvé qu’elles les connaissaient jadis (archéologiquement pour l’arc ou la poterie ; logiquement pour la navigation) ; et The Contact of Peoples (1913) où il tente d’expliquer par la visite de petits groupes d’étrangers civilisateurs, l’existence d’usages remarquables, telle la momification lorsqu’elle est présente chez des populations d’un très faible niveau technique par ailleurs. Il faut remarquer que l’hyper-diffusionnisme de Rivers demeure très modéré par rapport à celui de ses collègues Elliot Smith et Perry : l’existence de petits groupes de civilisateurs étrangers n’est jamais mentionné qu’après qu’aient été écartées des hypothèses plus banales, ces visiteurs ne sont par ailleurs jamais désignés nommément comme devant être d’anciens Egyptiens, mais il apparaît souvent qu’ils pourraient être de simples voisins, les traits culturels se transmettant de proche en proche à une vitesse relativement lente.
Deux types de raisons expliquent sans doute la conversion de Rivers d’une anthropologie sociologisante à une anthropologie plus traditionnelle dont l’inspiration est l’histoire spéculative. La première raison réside dans les contacts très étroits qu’il maintenait avec l’anthropologie allemande, une conséquence de ses stages en Allemagne quand il se formait à la psychologie ; l’anthropologie allemande mettait alors l’accent sur les anomalies culturelles qui semblaient pouvoir être expliquées de manière économique par des apports extérieurs. De façon tout à fait exceptionnelle pour un Britannique, Rivers suivait de très près les travaux des Allemands, et tout particulièrement du Père Wilhelm Schmidt (1868-1954) avec qui il entretenait une correspondance régulière. La seconde raison était son amitié pour Elliot Smith, à la fois anatomiste et égyptologue de premier plan, que Rivers avait réussi à intéresser à l’anthropologie lorsqu’il s’était lui-même rendu en Egypte en 1900-1901 pour enquêter sur la vision colorée. Elliot Smith, qui était effectivement un spécialiste de l’Égypte ancienne, avait une propension excessive à voir la main de voyageurs égyptiens partout où existaient des pyramides, des techniques de momification, ou la présence plus banale de mégalithes. Les conversations qu’il avait avec son ami Rivers ont dû attirer l’attention de celui-ci sur des faits de cet ordre dont certains demeurent, effectivement, énigmatiques.
Les principaux disciples de Rivers en psychologie furent Myers et Mc Dougall qui avaient participé à l’Expédition au Détroit de Torrès, mais aussi Bartlett qui fut professeur de psychologie à Cambridge. En anthropologie, ses principaux élèves furent Radcliffe-Brown, Brenda Selignam, l’épouse de son collègue Charles Seligmam, John Layard, Bernard Deacon et A.M. Hocart.
Alfred Reginald Radcliffe-Brown (1881-1955) mena ses deux terrains, le premier aux Iles Andamans de 1906 à 1908, et le second en Australie en 1910-11 sous la supervision de Rivers. On a conservé une correspondance très complète entre le « supervisor » et son élève pour les années 1911-1913 ; les discussions très serrées sur les faits australiens montrent l’évolution dans la réflexion de l’un et de l’autre. On y décèle aussi l’influence décisive des travaux contemporains de Durkheim. Radcliffe-Brown sera catastrophé par la conversion de son maître à l’hyper-diffusionnisme, et il mentionnera à plusieurs reprises le choc qu’il en ressentit. Quoi qu’il en soit, leur collaboration aura été exemplaire pendant de nombreuses années, bien que le profond mépris qu’avait Radcliffe-Brown pour deux amis de son maître : Elliot Smith et le Père Schmidt, ait dû influer sur leur relation.
La relation entre Rivers et Malinowski est plus compliquée à analyser puisqu’elle fut surtout indirecte. On peut toutefois remarquer que cette relation fut exactement l’inverse de celle que Malinowski prétendait entretenir avec Frazer. L’influence de Frazer sur l’œuvre de Malinowski est pratiquement nulle, alors que celui-ci affirme profusément qu’elle est massive. L’influence de l’œuvre de Rivers sur Malinowski est massive et celui-ci affirme qu’elle est minime. Sur le terrain, Malinowski a sans aucun doute appliqué le programme de l’enquête sociologique intensive (« observation participante ») que Rivers avait mise au point ; de plus, sa correspondance et son journal attestent qu’il étudiait très soigneusement les textes de Rivers alors qu’il était sur le terrain. L’orgueil de Malinowski explique certainement partiellement pourquoi il ne reconnaissait sa dette vis-à-vis de Rivers que du bout des lèvres ; le fait est que la mise en évidence actuelle de la priorité de Rivers sur le plan méthodologique diminue d’autant le mérite de Malinowski. Mais la raison principale du silence de Malinowski réside sans doute dans la profonde irritation que lui causait le personnage de Rivers. Du point de vue psychologique, les deux hommes étaient aux antipodes : Rivers était jusqu’à la fin de la guerre de 14, c’est-à-dire quatre ans avant sa mort, un personnage assez réservé, maladroit en public, et, l’évolution de son œuvre le montre, très influencé dans sa réflexion par les liens affectifs qu’il entretenait par ailleurs ; son œuvre est fondamentalement celle d’un dilettante allant dans la direction où le vent le poussait. Malinowski, au contraire, était un intellectuel immigrant en Grande-Bretagne, obligé de faire carrière par des moyens autres que les relations familiales, très à l’aise en public où il frisait toujours l’arrogance ; il n’eut rien d’un dilettante mais fut au contraire un chercheur ultra-spécialisé (on lui reprochera de légiférer à propos des « Sauvages », alors qu’il ne fait qu’extrapoler à partir de l’exemple unique des Trobriandais). Rivers représentait dès lors tout ce que Malinowski détestait en matière de pratique scientifique, et Fortes vient confirmer notre intuition lorsqu’il nous rapporte que Rivers était la « bête noire » (en français dans le texte) de Malinowski. [PJ 2020 : j’écris cela entre 1977 et 1979, je développerai dans les années qui suivirent, ayant rassemblé la correspondance de Malinowski, une interprétation d’ordre psychanalytique que l’on trouve dans l’un de mes textes autobiographiques].
Répondre à Paul Jorion Annuler la réponse