Retranscription de Que font les mathématiciens ? le 18 avril 2021.
Bonjour, nous sommes le dimanche 18 avril 2021 et je voudrais commencer par vous remercier. Parce que je fais des vidéos sur des sujets extrêmement différents. Et d’ailleurs on me reproche un petit peu d’avoir des expertises dans des domaines extrêmement distincts. Je vous en ai fait au départ essentiellement sur des questions d’actualité liées à la finance. Je vous ai parlé, au cours des 5 dernières années, beaucoup de l’actualité aux Etats-Unis. Récemment, je vous ai déjà fait deux vidéos sur une question particulière qui est vraiment une question assez pointue, qui est un domaine qu’on appelle les fondements des mathématiques et en y réfléchissant juste avant de commencer à parler, je me suis dit que dans mes domaines d’expertise, il y en a un dont je vous ai jamais parlé, c’est la psychanalyse et je me suis posé la question, et j’ai trouvé très rapidement une réponse : c’est que, pour moi, la psychanalyse, c’est une pratique, alors que ces autres domaines dont je vous parle, ce sont des choses auxquelles je réfléchis et du coup, il m’arrive de me réveiller le matin en me disant : « Tiens, j’ai envie de dire ça », voilà. La psychanalyse, non. J’ai trouvé ici et là, essentiellement chez MM. Freud, Lacan, Mme Melanie Klein, un certain nombre d’outils et j’ai en ajouté d’autres mais voilà, c’est des outils : il faudrait que je vous décrive une boîte à outils et, ça, apparemment, je n’ai jamais eu envie vraiment de le faire.
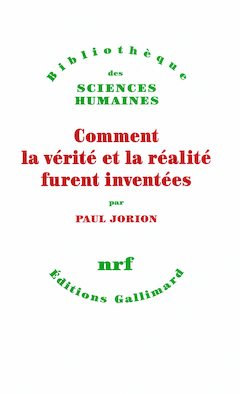
La question des fondements des mathématiques, je lui avais consacré… Voilà, ce livre-là : ça s’appelle « Comment la vérité et la réalité furent inventées ». Ça date de 2009. Il y a 4 parties. La première partie, c’est une réflexion sur un problème qui est central à l’anthropologie : c’est la question soulevée par un philosophe, pas par un anthropologue, par Lucien Lévy-Bruhl, la question de ce qu’il appelait à l’époque « la mentalité primitive ». C’était encore dans une perspective évolutionniste où ce que les sociétés traditionnelles faisaient c’était labellisé : on mettait l’étiquette « primitif » à partir de cette idée que cela relevait sans doute d’un stade très antérieur de la civilisation par rapport à ce que nous connaissons nous-mêmes.
Cette question s’appelait « la mentalité primitive ». Les anthropologues ne s’y sont pas intéressés beaucoup pour une raison essentielle : par dépit, pourrait-on dire. Par dépit parce que, justement, c’est un philosophe extérieur à la profession d’anthropologue, Lucien Lévy-Bruhl, qui a posé toutes ces questions qui auraient dû être posées logiquement par des anthropologues et être résolues par des anthropologues. Et la personne qui a, je dirais, manifesté le plus de dépit, c’est Claude Lévi-Strauss, Claude Lévi-Strauss qui a consacré à cette question de la mentalité primitive en fait deux livres : l’un qu’il a appelé « La pensée sauvage », donc au lieu de dire « mentalité primitive », il a dit « pensée sauvage ». Il a dit essentiellement que le problème ne se posait pas et il a fait un petit livre aussi, « Le totémisme aujourd’hui ». Le totémisme, c’est aussi très relié à ces questions qu’on appelait de « pensée prélogique » ou de « mentalité primitive ». Et là aussi, il a dit que croire qu’il y avait eu un problème de totémisme, c’était être victime d’une illusion d’optique. Or, si vous avez regardé mon blog récemment, vous avez vu que j’ai consacré un feuilleton en 4 épisodes à la question du totémisme qui a été très longtemps, en fait, pendant toute la seconde moitié du XIXème siècle et peut-être en plus, toute la première moitié du XXème, était la question centrale de l’anthropologie. Mais c’étaient essentiellement des non-anthropologues qui apportaient les réponses.
Mon maître Leach avait l’explication pourquoi. Il disait qu’essentiellement, c’est un problème de mathématiques élémentaires : c’est parce qu’il y a très peu d’anthropologues, il y a beaucoup de philosophes, il y a beaucoup de gens en dehors, des sociologues comme Durkheim qui avait résolu en fait la question du totémisme avec Mauss quand il en avait parlé et du coup, les anthropologues ont un peu fait Le renard et les raisins : si ce n’est pas nous qui avons inventé ça ou résolu la question, c’est que c’était une question sans intérêt. Ce n’est pas le cas.
Ce n’est pas le cas. Quand j’ai fait ce livre et qu’on me demandait où est-ce que ça tombait, je disais que c’est de l’anthropologie des savoirs. Mon problème de ce point de vue-là c’était que j’étais le seul à faire des livres dans une discipline qui n’existait pas, qui s’appelle l’anthropologie des savoirs, j’espère qu’il y a d’autres gens qui me rejoindront un jour.
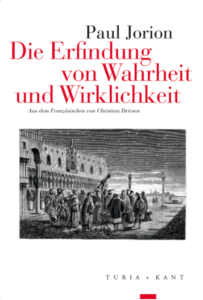 Et à ce propos-là, voilà, ça, c’est un bon signe. Je veux dire que c’est bien, c’est que ça commence à intéresser ailleurs et donc ça, ça a paru il y a quelques semaines : l’invention de la vérité et de la réalité en allemand. J’espère qu’un jour, dans le monde anglo-saxon, on s’intéressera aussi à cet ouvrage.
Et à ce propos-là, voilà, ça, c’est un bon signe. Je veux dire que c’est bien, c’est que ça commence à intéresser ailleurs et donc ça, ça a paru il y a quelques semaines : l’invention de la vérité et de la réalité en allemand. J’espère qu’un jour, dans le monde anglo-saxon, on s’intéressera aussi à cet ouvrage.
Première partie donc, cette question de la mentalité primitive qu’il faut en fait résoudre autrement. En fait, c’est simplement le fait que les sociétés humaines ont produit deux grands types d’approche du monde : celle du monde occidental née dans le croissant fertile (Babylone, Sumer, l’Egypte ancienne), qui est la nôtre : c’est de ça que nous avons hérité, c’est venu par les Grecs anciens puis les Romains, etc., de notre côté. Et puis il y a un autre type de perception du monde, de représentation du monde qui est né en Chine et qui a diffusé ou qui s’est retrouvé par des migrations ou par des moyens quelconques, par des copiages, être la manière de penser sur tout le pourtour du Pacifique. Et donc, ce n’est pas une question d’être « primitif » ou ceci, ou cela, c’est simplement qu’il y a deux options.
Il y a deux options. Voilà : la Chine, indépendamment du monde méditerranéen, et le monde méditerranéen indépendamment de la Chine, ont trouvé deux manières d’appréhender le monde. Nous avons, nous faisant face, ce qui nous a fascinés comme mentalité primitive, pensée prélogique, et tout ça, c’est cette pensée archaïque chinoise. Qui a d’abord cessé d’être archaïque en Chine et qui s’était répandue sur tout le pourtour du Pacifique.
Mais je prenais au sérieux le titre de mon livre : « Comment la vérité et la réalité furent inventées » et donc, la deuxième partie, c’est une réflexion sur les fondements de la logique chez Aristote. Ensuite, la troisième, c’est une réflexion sur la naissance de la notion de réalité objective, nous dirions, au Moyen-âge et à la Renaissance à partir d’une redécouverte des textes d’Aristote, de ses textes perdus. Pourquoi est-ce qu’ils cessent d’être perdus ? Eh bien, c’est parce qu’en 1453, comme vous le savez, chute de Constantinople. Les gens s’enfuient avec ce qu’ils ont, et ils rejoignent l’Occident ayant en particulier avec eux des manuscrits qu’on croyait perdus d’Aristote. Et voilà, ça relance la discussion chez nous et on repart à partir de ça.
Alors, la quatrième et dernière partie du livre, c’est une réflexion sur les fondements des mathématiques : d’où viennent les mathématiques ? Comment est-ce que ça se développe ? Et je m’intéresse en particulier à l’invention du calcul infinitésimal par Newton, Leibniz, Huygens et quelques autres, et je m’intéresse aux questions récentes du rapport entre les modèles mathématiques et la physique.
Voilà, ça, c’est dans la dernière partie de ce livre et au passage, il y a un peu une thèse qui émerge de cette dernière partie du livre, c’est celle d’une dégénérescence du raisonnement mathématique à partir sans doute, je dirais, du XVIIIème siècle. Bon, ça ne m’a pas fait que des amis parmi les mathématiciens. Ils ont pris au sérieux ce que je disais à l’époque et, en particulier, je me souviens d’une discussion : j’avais été invité à présenter mes positions devant des mathématiciens et des philosophes des mathématiques à l’Ecole Normale Supérieure. Mais j’en étais un peu resté là.
Je posais un regard d’anthropologue sur ces questions et d’ailleurs, bon, vous allez voir, c’est une incise mais sans être une incise. A une époque, je suis invité – c’est en 1997 – je suis invité par une université américaine, l’Université de Californie à Irvine qui est dans le Comté d’Orange et là, je suis invité parce que j’ai reçu un prix. Ça s’appelle Regents’ Lectureship. Et donc, on m’invite et je peux faire ce que je veux pendant un moment. Je donne des cours, bien entendu. On me demande de donner des leçons, de faire des séminaires. Tout ça est très sympathique puisque je fais de la finance à ce moment-là depuis 7 ans. Et qu’est-ce que je fais à ce moment-là ? En fait, ma production sur cette année, ça donne deux articles qui sont dans cette même revue Dialectical Anthropology et vous ne serez pas surpris : le premier article s’appelle « Aristotle’s Theory of Price Revisited » (Vol. 23, N°3, 1998 : 247-280) : la théorie des prix d’Aristote revisitée, en français on dirait « Retour à la théorie des prix d’Aristote » et ça, c’est ce qui me permettra par la suite, de produire ce livre qui s’appelle « Le prix » (2010), et « L’argent mode d’emploi » (2009). C’est ce qui est à l’arrière-plan de mon interprétation qui, elle, n’est pas autre chose : c’est mon interprétation aristotélicienne de la finance et bon, là aussi, j’en suis quasiment le seul représentant.
Je n’ai fait que deux articles sur une année mais le premier, il fait 35 pages sur Aristote et le second, qui fait 45 pages, s’appelle : « What Do Mathematicians Teach Us about the World : An Anthropological Perspective » (Vol. 24, N°1, 1999 : 45-98), que nous disent les mathématiciens à propos du monde : une perspective anthropologique. Et ça qui fera le noyau, le cœur de la dernière partie de ce livre « Comment la vérité et la réalité furent inventées ».
Et donc, je m’intéresse à cet aspect particulier, c’est que si on regarde ce que dit Aristote sur ce que c’est que faire des mathématiques, ce que c’est qu’apporter une preuve mathématique, les types de preuves mathématiques, quelle est la qualité de ces preuves mathématiques, là, quand on s’intéresse, comme je l’ai fait en particulier à la démonstration par Kurt Gödel de son deuxième théorème sur l’incomplétude de l’arithmétique, on s’aperçoit – et c’est là qu’a été ma stupéfaction quand même – c’est qu’il y a une succession d’arguments dans cette démonstration par Gödel, qui vont de ceux de la meilleure qualité selon Aristote à ceux de la pire qualité, et dont, selon Aristote, la présence en mathématique n’est absolument pas justifiée : on ne devrait pas accepter comme preuves, le recours à des paradoxes, le cas tangent de la preuve par l’absurde et des choses de cet ordre-là.
Et donc, qu’est-ce que je fais moi dans ce bouquin ? Eh bien, je dis ce que je vois : la perspective d’un anthropologue sur les [fondements] des mathématiques. Bon, pourquoi est-ce que je suis seul dans des domaines comme l’anthropologie des fondements des mathématiques ou l’anthropologie des savoirs ? Probablement pour une raison purement mécanique si l’on veut : c’est qu’il faut avoir lu énormément. Il faut avoir lu énormément pour avoir le culot je dirais – appelons les choses par leur nom – de s’intéresser à ce que font les mathématiciens et éventuellement dire qu’il y a chez eux des erreurs : « L’erreur c’est la suivante, vous auriez dû faire comme ceci ou comme cela », dire : « Non, non, non, ça, c’est de très mauvaise qualité selon Aristote et je suis d’accord avec lui ».
Mais qu’est-ce qui m’avait autorisé à ce genre de culot ? C’était un événement que j’ai mentionné à plusieurs endroits et en particulier dans ce livre « Comment la vérité et la réalité furent inventées », c’est ma stupéfaction d’assister à un cours à la Sorbonne de Roman Jakobson (1896-1982), le grand linguiste, le très très grand linguiste. C’était une leçon qu’il donnait comme ça. Il était de passage et j’avais vu qu’il serait là, à la Sorbonne. Je suis allé écouter ça (± 1970). On doit être une trentaine, il doit y avoir 29 linguistes + Paul Jorion et là, il y a eu ce qu’il a dit… Il a émis le même message, il a exprimé le même message d’une dégénérescence du savoir actuel par rapport au savoir ancien et il a dit, je cite de mémoire : « Il faudra encore beaucoup de temps pour que nous atteignions, nous linguistes, le degré de sophistication, de compréhension, des problèmes linguistiques qui est celui des Scolastiques au Moyen-âge ». Bon, alors, paf ! Et c’est ça qui explique aussi pourquoi, quand je me suis retrouvé coincé rapidement dans des questions d’intelligence artificielle, que j’ai compris, ayant retenu ce qu’avait dit Jakobson : « Là, je n’avance plus », je suis allé voir chez les scolastiques. Jusqu’au jour où je me suis dit : « Ah, voilà, formidable, je sais exactement à quel endroit je vais trouver, chez Guillaume de Sherwood la réponse à la question que j’essaye de résoudre-là » et qu’à la bibliothèque de l’Université de Cambridge, on m’apporte un bouquin qui est, de la première page jusqu’à la dernière, en latin. Il n’a jamais été traduit et c’est là que j’ai pris mon courage à deux mains en disant : « Tu as été sur le banc des écoles à ingurgiter du latin. Ça ne t’a jamais servi à rien. Le moment est venu » et comme c’était du latin du Moyen-âge, c’est-à-dire avec la structure de la phrase qui est déjà la structure de la phrase moderne (que ce soit de l’anglais ou du français), eh bien, il y avait moyen d’avancer + un dictionnaire évidemment pour les choses qui restaient un peu complexes comme les notions de catégorème et de syncatégorème.
Et donc voilà le point où j’en étais arrivé, c’est-à-dire que, voilà, après 1997, je me suis moins intéressé à ces questions de mathématiques, et il a fallu qu’une mathématicienne chinoise – c’est important qu’elle soit chinoise – Yu Li, m’aborde à propos d’un problème justement de logique ancienne chinoise : « Un cheval blanc n’est pas un cheval », un paradoxe de la logique ancienne chinoise. Et, de fil en aiguille, on commence à relire ensemble la partie de mon bouquin consacrée aux mathématiques.
Et là, je dois bien le dire, j’ai eu une appréhension, j’ai eu une appréhension. Je me suis dit : « Voilà, j’ai dit des choses sur les mathématiques, sur les fondements des mathématiques. J’ai dit des choses peu aimables sur les mathématiciens. J’ai fait ça absolument tout seul. Est-ce que je n’ai pas quand même commis de bourde, que quand maintenant je collabore véritablement avec une mathématicienne, qu’on passe tous nos samedis après-midi sur ces questions-là, est-ce qu’elle ne va pas me dire : « Oui mais là, vous vous êtes complètement planté. Vous n’avez rien compris ! » ». Et là, la bonne surprise, l’excellente surprise et pour elle et pour moi, c’est que non, apparemment mon truc tient la route et que quand Yu Li me propose, qu’on avance encore, c’est dans la même direction que celle que j’avais esquissée, c’est-à-dire trouver des naïvetés supplémentaires chez les mathématiciens, voir des confusions de plus, voir que ce qu’ils pensent être des conclusions auxquelles ils sont arrivés par la démonstration d’un théorème, que nous disons : « Non, il y avait là une constatation empirique » et ils ont fait le voyage à reculons en disant : « Maintenant, comme ce fait est indiscutable, que certains types de problèmes ont une solution et que d’autres n’en ont pas, prouvons-le mathématiquement ». Et alors là, ce sont des constructions assez bancales avec des confusions. Je vais vous donner juste l’exemple d’une : toute une discussion entre Kurt Gödel, Alonzo Church, Stephen Kleene et Alan Turing.
Alan Turing, vous connaissez sûrement son nom. Gödel, vous devez le connaître parce qu’on parle de ses théorèmes, Turing parce qu’il est considéré à juste titre comme l’inventeur du concept même de l’ordinateur. Bon, il prolongeait effectivement une réflexion de M. Charles Babbage et de Lady Lovelace au XIXème siècle mais bon, toute une réflexion. Dans son fameux exposé de 1936, et dans sa thèse de 1938, Turing, il y a là la description de l’ordinateur. Alors, on attribue la programmation essentiellement à von Neumann de nos jours mais von Neumann, n’en a jamais parlé par écrit, et c’est donc pour ça qu’on le sait pas trop mais dans ses conversations, dans des lettres qu’il a écrites, von Neumann reconnaissait très honnêtement sa dette envers Turing dans ce qu’il faisait.
Et donc, voilà, je vais vous donner un exemple : au centre de la réflexion de ces personnes, la question de savoir si une proposition est vraie ou fausse et la question de savoir si un certain type de problèmes ont une solution ont été confondues par les mathématiciens sous la forme que « avoir une solution », c’est « être vrai » et que de dire : « Ce type de problème a une solution » et dire « Ce type de problème est vrai », c’est équivalent.
Et là, quelqu’un comme moi, un anthropologue, mais aussi quelqu’un comme Ludwig Wittgenstein, le philosophe, quand nous avons vu ça – on ne l’a pas vu à la même époque et Ludwig Wittgenstein, il l’a dit à l’époque où il a vu ça (1937-1938) – il a dit : « Non les amis, ce n’est pas la même chose ! ». Ce n’est pas la même chose dire qu’une proposition est vraie comme « Les chats ont des moustaches » et de dire « Tel type de problème a une solution » et de résumer ça en disant : « Tel type de problème est vrai », ce n’est pas la même chose ! Vous mélangez, et quand vous faites votre démonstration, vous ajoutez des pommes et des poires et vous dites : « Et le résultat final, je vais l’exprimer en oranges ».
Ce n’est pas [exactement] ça que dit Wittgenstein mais dans de nombreuses réflexions qu’il a sur le théorème de Gödel, dans les discussions qu’il a à l’époque, je crois que je l’ai mentionné la fois dernière, on a des comptes-rendus de discussions entre Wittgenstein et Turing et c’est essentiellement du type de la part de Wittgenstein : « Mais, mon cher M. Turing, est-ce que vous n’avez pas remarqué que quand il y a 5 minutes, vous disiez ceci et que vous utilisiez le mot x de telle manière et que quand vous l’utilisez maintenant, il y a 2 minutes, vous utilisez ce mot x comme s’il était équivalent à l’autre alors que vous l’utilisez dans des acceptions complètement différentes du mot x ? ». Et parfois on voit dans les commentaires de Wittgenstein, quand il s’adresse à Turing, il a du mal à ne pas être condescendant à lui dire : « Mon jeune ami, quand même ! … », etc.
Et il y a eu une réaction l’autre jour d’un collègue mathématicien parce qu’on m’avait demandé d’expliquer plus ou moins ça, ce que je viens de vous dire là, devant l’équipe à laquelle j’appartiens à l’Université Catholique de Lille et mon collègue n’était pas content quand j’ai parlé de la candeur, de la naïveté, de certains grands mathématiciens. Il m’a envoyé une lettre pour me dire qu’on ne pouvait pas dire ça, que c’était choquant de dire ça. Or, désolé, il ne s’agit pas d’être condescendant : je ne vais pas dire que Gödel était un imbécile ou que Turing était un crétin : qu’il a inventé l’ordinateur mais que ça n’a pas d’importance parce qu’il se plantait quelquefois dans ses raisonnements. Je ne dirai jamais ça ! Je ne penserai jamais ce genre de choses, mais trouver des erreurs, découvrir des erreurs dans la manière dont ils ont procédé, oui, là, pourquoi pas, pourquoi pas ? Si je ne connaissais rien aux mathématiques et que je dise : « Ouais, le théorème de Gödel, ça m’a l’air comme ceci… ». Non, j’ai fait le boulot, j’y ai passé des années. Je regardais l’autre jour quand j’ai commencé à lire véritablement sur cette question du théorème de Gödel, sur les fondements des mathématiques. Les premiers bouquins que j’ai achetés, c’est en 1984, 1985, 1986, c’est-à-dire une douzaine d’années avant que j’aie l’impression d’avoir quelque chose que je peux véritablement présenter. Et avec des sommes de lectures : les trois livres qui font des analyses extrêmement précises de la démonstration du théorème de Gödel, je les ai là. Ils sont entièrement annotés, non seulement surlignés mais avec des commentaires dans la marge. Je ne me suis pas avancé en terrain découvert, en ayant l’impression parfois de couper les coins ou des machins comme ça, de prendre la diagonale. Non, non, non.
Et donc, ça me fait très plaisir d’abord, qu’une mathématicienne me donne l’envie de réfléchir à ça, qu’on avance ensemble et que ça confirme la voie que j’avais prise. Et là, j’ai dit tout à l’heure le fait qu’elle est mathématicienne est évidemment essentiel mais le fait qu’elle est Chinoise est important aussi. Pourquoi ? Parce qu’elle m’avait abordé à propos de ce problème de logique chinoise « Un cheval blanc n’est pas un cheval » qu’avait présenté le logicien chinois Kung-sun Lung (320-250 av. J-C) et là, Yu Li comme moi, nous posons un regard sceptique à la fois sur la manière dont la pensée occidentale envisage ce genre de choses et la pensée chinoise, et nous nous sommes intéressés [chacun] depuis très longtemps à la différence entre ces deux types de pensées. La preuve [pour moi], c’est que la pensée archaïque chinoise [analysée par moi dans « Principes des systèmes intelligents » {1989} et que], c’est la première partie de mon bouquin « Comment la vérité et la réalité furent inventées ». Et que nous avons là cette possibilité, je dirais, anthropologique, qui lui est venue à elle du fait qu’elle vient de cette culture chinoise et qu’elle a appris la culture occidentale, et que moi, c’est dans l’autre sens : je me suis intéressé à partir de la culture occidentale, à la culture chinoise. Et nous voyons que dans ces deux appréhensions du monde, il y a deux façons de faire les choses et du coup, ça nous offre un [un sens critique] d’une certaine manière.
La Chine n’est pas sceptique quant à l’usage des mots à l’origine. On ne sait pas, en Chine très ancienne, on ne sait pas qu’il y a des gens ailleurs qui appellent un serpent autrement donc quand on pense au serpent, on considère que le caractère et le mot prononcé associés au serpent font partie de sa nature profonde, comme le fait qu’il n’a pas de pattes, qu’il ondule sur le sol, qu’il a souvent des crocs avec du venin, etc. Tandis que dans la Grèce ancienne, on sait qu’il y a des Perses : ils ne sont pas loin, ils n’arrêtent pas de nous envahir et avec lesquels c’est la castagne permanente, et que eux, pour le mot « chat » ou pour le mot « chien », ils ont un mot tout à fait différent et que ça ne fait pas une grande différence et que, donc, ces mots sont des étiquettes arbitraires.
Donc, deux pensées très très différentes : la pensée chinoise « totémique » à notre sens, proche de cette mentalité primitive qui n’a aucun intérêt pour la théorisation, pour la classification et ainsi de suite, mais qui s’intéresse aux affinités, ce que nous appelons des affinités « secrètes » parce qu’on ne comprend pas exactement comment ça marche, c’est-à-dire une logique de l’émotion qui est en arrière-plan de tout ça.
Alors voilà, j’ai fait un point. De fait, je vous ai parlé de beaucoup de choses, de toutes ces choses que je fais en même temps et là, on peut peut-être les joindre. J’ai parlé à la fois de ce que je fais dans la finance et de ce que je fais en anthropologie et de ce que je fais maintenant en mathématiques parce que, effectivement, tout ça fait partie d’une réflexion de ma part que j’appelle « anthropologie des savoirs » ou « anthropologie des fondements mathématiques » dans un cas bien particulier. C’est une réflexion sur les savoirs et sur les modes de pensée, sur la manière dont nous réfléchissons. Alors, je l’ai dit tout au départ : ça n’a pas beaucoup intéressé les anthropologues. Ils se sont intéressés à ça à une période où c’était essentiellement un philosophe qui faisait pratiquement tout le boulot, Lucien Lévy-Bruhl dans la période entre 1910 et 1938. Les Anglo-saxons se sont ré-intéressés à cette question. Ils ne l’ont pas appelée « mentalité primitive » : ça se faisait pas, ce n’était pas une bonne idée dans les années 1960 et 1970 et là, ils l’ont appelée la « question de la rationalité » : the rationality debate. Et c’est là que moi, je l’ai trouvée en étant étudiant puis professeur à Cambridge. C’est là que j’ai participé à des discussions à cette époque-là sur le débat sur la rationality avec Steven Lukes en particulier … Il y a d’autres personnes dont je voudrais mentionner le nom mais le nom ne me revient pas [Robin Horton]. C’est là que moi, j’ai repris ce problème au passage et où j’ai continué à travailler dessus quand ça cessait d’intéresser tout le monde, d’autant plus qu’il y avait ce handicap en France, c’est-à-dire que Lévi-Strauss ait dit : « Ce n’est pas un problème, ça n’a jamais existé », et écrit deux livres essentiellement pour, comment dire, suturer la question, pour dire « Circulez, y a rien à voir », ce qui n’ était pas… Ça correspondait à sa personnalité, comme Malinowski avait fait, c’est-à-dire : « Je suis considéré comme le grand anthropologue et maintenant, je vais effacer les traces de tous ceux qui sont venus avant moi ». Je ne crois pas que ce soit la bonne manière de faire les choses. Là, je termine sur un peu de psychanalyse. Je crois que ça trahit une très très grande insécurité [personnelle]. Ce n’est pas nécessaire, ce n’est pas nécessaire.
Voilà, allez… Je n’ai pas regardé du tout combien de temps je parlais. Merci à vous qui allez regarder ça, surtout à ceux qui regarderont jusqu’au bout et, de fait, ce n’était pas du tout mon intention mais là, les fils ont été renoués un peu de tout ce que je fais, pourquoi il y a des rapports entre tout ça, quel est « le cheminement de la pensée » comme disait Emile Meyerson, grand philosophe des sciences. Voilà, à bientôt !
Laisser un commentaire