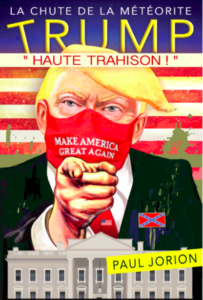
Le terreau où Trump a poussé et fleuri
Si les prochains jours devaient être sans histoire, la tentation apparaîtrait rapidement de considérer la présidence Trump (2016-2020) comme une simple parenthèse, curieuse sans doute mais n’exigeant pas que des leçons en soient tirées. Il s’agirait là d’une erreur tragique car dans le même esprit que Bertolt Brecht écrivant à propos d’Hitler : « Le ventre est toujours fécond d’où a surgi la bête immonde », le terreau qui a permis à un Trump de pousser et fleurir demeurera fertile.
Jusqu’à quand ? Tant que les gouvernements n’auront pas remis au premier rang de leurs préoccupations celle qui dans les années 1930 semblait primordiale à Keynes : faire que le ressentiment ne soit pas le principe de choix de l’électeur dans l’isoloir, sans quoi il votera pour semblable à lui : pour un être tourmenté par la colère comme l’est Donald Trump.
Jonathan Metzl est un médecin américain. S’il s’est mêlé de sociologie, c’est qu’il a voulu comprendre une particularité du comportement de ses patients dans un coin reculé des États-Unis : qu’ils élisaient volontairement des représentants dont le programme heurtait leur intérêt. Dans Dying of Whiteness. How the Politics of Racial Resentment is Killing America’s Heartland (New York : Basic Books 2019) : « Mourir de sa blanchitude. Comment une politique de ressentiment est en train de tuer l’Amérique profonde », il fait part de sa découverte : à ses patients « pauvres blancs », laissés pour compte des États-Unis d’aujourd’hui, il ne reste précisément que la fierté d’être Blancs, et s’ils rejettent les mesures qui iraient dans le sens de leurs propres intérêts, c’est de peur qu’elles ne bénéficient aussi aux Noirs et aux Latinos dont il est essentiel à leurs yeux qu’ils soient maltraités. Ce sont ces traîne-savate que l’on a vu à l’œuvre le 6 janvier dans la foule, en treillis ou déguisé en bison, qui prit d’assaut le Capitole, le parlement américain, portant haut le drapeau sudiste des anciens états esclavagistes. Ces épaves d’une société toujours davantage « en haltères », avec deux grosses boules à ses extrémités : celle des très pauvres et celle des très riches, reliées entre elles par la barre de plus en plus mince que constitue une classe moyenne en voie de disparition. Une tendance que le numérique avait instaurée et que la pandémie accélère encore.
Pourquoi ? Parce que le numérique : l’algorithme, le Big Data, l’Intelligence Artificielle, créent – pratiquement « en roue libre » – une richesse considérable, et que ceux qui se trouvent à proximité de la manne où elle vient se déverser, en sont les privilégiés, alors que les autres occupent des emplois où ils sont chaque jour davantage en surnombre, en concurrence avec des robots faisant le travail plus vite qu’eux, meilleur marché et mieux. Par le biais du télétravail, la pandémie accroît la productivité de ceux dont l’activité est ancrée dans le numérique : moins de déplacements coûteux en carburant et moins de locaux à occuper donc à louer, tandis qu’elle fait monter au premier rang des malades potentiels, ceux dont le travail de maintenance, de manutention, de transport, d’aide à la personne, requiert encore une main d’œuvre humaine abondante, souvent dans des conditions de promiscuité favorables à la contagion. Pour ceux-là, le numérique se limite à facebook où il leur est répété, s’ils ne le croient déjà, que le responsable de leur misère, c’est le plus misérable encore qu’eux : celle ou celui dont la religion est suspecte et le teint, trop foncé.
Tant que notre nouvelle société « en haltères » nous apparaîtra comme une simple bizarrerie et non le problème à résoudre toutes affaires cessantes, le terreau restera fertile où pousseront et fleuriront de nouveaux Donald Trump.
Répondre à Dominique-e Annuler la réponse