Retranscription de Si vous avez besoin d’une religion… j’ai ce qu’il vous faut, le 3 avril 2021.
Bonsoir, nous sommes le 3 avril 2021. C’est le samedi de Pâques. Il est 22h06, je profite du fait que les enfants soient couchés pour m’adresser aux parents. J’ai un message : si vous avez besoin d’une religion, j’ai ce qu’il vous faut. Vous allez vous demander pourquoi je dis ça. C’est parce que, dans des temps aussi troublés que les nôtres et, comme disait l’autre, « ça ira plus mal avant que ça n’aille beaucoup mieux » – j’allais dire : « ça ira pire ». Dans des temps comme ça, les gens, un jour ou l’autre, vont se tourner vers des religions. Ils auront envie de croire de nouveau à quelque chose. Et c’est pour ça : j’ai une sorte de tuyau, voilà.
J’ai quelque chose qui, plutôt que de vous laisser choisir n’importe quoi – des choses qui pourraient, comment dire ? être dangereuses pour l’humanité – je vais vous proposer quelque chose qui existe. Je vais vous parler d’un bonhomme. Il est mort en 1982 et, en 1977, il a fait une grande conférence et les gens étaient assez perplexes. Ils écoutaient ce qu’il disait, les gens se regardaient. Ça a été filmé, vous allez pouvoir voir ça. Les gens se regardaient : « Qu’est-ce que c’est que ce machin ? ». Et à la fin, comme les gens se posaient des questions et qu’ils n’avaient pas du tout entendu ce qu’ils s’attendaient à entendre, il a dit : « Je suis un prophète ». Je ne sais pas si ça a été vraiment noté au moment-même.
Alors, voilà, c’est toute une religion qu’il a proposée. Il y a un enregistrement qui s’arrête un peu avant la fin apparemment, au milieu d’une phrase. Ça dure à peu près une heure. Ça s’est passé à Metz, à Metz, en France. Ça s’est passé à l’hôtel de ville et on le voit : il y a une salle pleine. Il y a plein de gens. À les regarder, ce sont des gens jeunes qui sont là. Et qu’est-ce qu’ils croyaient faire ces gens-là, à qui on a offert quelque chose de tout à fait différent ? Ils croyaient venir écouter un auteur de science-fiction. Ils venaient écouter un auteur de science-fiction et ils ont entendu parler essentiellement de théologie : de la divinité, du paradis, du jardin d’Eden, de qu’est-ce que Jésus-Christ veut dire quand il dit : « Mon royaume n’est pas de ce monde » ? Est-il possible de comprendre ce qu’il veut dire quand il dit : « Le royaume de Dieu est en vous », des choses de cet ordre-là.
Les gens ne s’attendaient pas à ça : ils s’attendaient à entendre Philip K. Dick, parce qu’il s’agit bien de lui, faire un exposé sur ses livres de science-fiction. 1977. Il faut bien situer : c’est l’époque où seuls les gens qui lisent de la science-fiction ont entendu parler de lui. Parce qu’il s’est passé ensuite la chose suivante, c’est qu’on a fait plein de films à partir de ses livres. Ça commence en 1982 avec le « Blade Runner » de Ridley Scott ; en 1990, le « Total Recall » de Paul Verhoeven ; 2002, c’est le « Minority Report » de Steven Spielberg ; en 2006, un film très intéressant puisque c’est du dessin animé fait par-dessus du vrai cinéma, c’est « A Scanner Darkly » de Richard Linklater. On a encore fait d’autres films depuis sur des thèmes de romans ou de nouvelles de Philip K. Dick. Et aussi, en parallèle, on parle bien entendu d’une inspiration de Dick pour la série des films « La matrice », le premier, c’est en 1999.
Donc, le grand public ne connaît pas encore Philip K. Dick. Il n’y a que vraiment les fanas de science-fiction qui le connaissent et ils vont écouter ce bonhomme et qu’est-ce que ce bonhomme raconte ? Il explique une nouvelle religion dont il est le prophète. Il lève tout doute à la fin de la conférence, quant à l’interrogation des gens qui sont là : « Qu’est-ce qu’on a entendu ? On n’a pas entendu un type parler de ses romans de science-fiction. On a entendu autre chose » et il dit le mot, il prononce le mot « prophète » : « Je suis un prophète ». Voilà !
Ce n’est pas comme ça qu’on se souvient de la personne de Philip K. Dick. Si vous regardez sa notice Wikipédia, il y en a d’importantes dans la plupart des langues parce que c’est quelqu’un dont on lit les livres et dont on continue de faire des films à partir de ses nouvelles ou de ses romans. Il y en a à propos desquels, comme Ubik, qui n’a jamais été tourné, des réalisateurs continuent de se disputer en coulisses pour être la personne qui le portera à l’écran.
Et ce personnage-là, donc, Philip K. Dick-le prophète, comme il se définit lui-même, est un personnage tout à fait différent de ce qu’on pourrait imaginer. [PJ : La notice Wikipedia en anglais mentionne « À une époque, Dick eut le sentiment que l’esprit du prophète Élie avait pris son contrôle. Il était convaincu qu’un épisode de son roman Flow My Tears, the Policeman Said une renarration détaillée d’un passage des Actes des Apôtres, qu’il n’avait jamais lu ». Le mot « prophète » apparaît dans la notice en français seulement dans une note en bas de page, en référence à un article de Serge Lehman dans Le Monde, intitulé « Philip K. Dick, un prophète à Hollywood » mais il s’agit là d’une métaphore, la seule apparition du mot prophète dans le texte même étant « il est un maître de la forme courte, doublé d’un prophète de la paranoïa généralisée et de la SF humaniste ».]
Mais il y a encore plus étonnant que ce que je viens de dire. (Je reviendrai sur cette conférence de Metz, sur cette création d’une nouvelle religion mais il écrit par exemple un livre qui s’appelle « VALIS » : « Vast Active Living Intelligence System », un vaste système actif d’une intelligence vivante. Dans ce livre-là, Philip K. Dick fait la chose suivante… il faut que je donne un tout petit élément de contexte avant. Là, on est en 1981, c’est-à-dire quatre ans après la conférence de Metz. Il est considéré fou par son entourage. On considère que c’est un dingue. En 1981 (il mourra en mars 1982), il écrit ce livre qui s’appelle « VALIS » et dans ce livre, il fait la chose suivante. Il y a d’abord un narrateur (en général, on suppose que c’est l’auteur quand rien n’est précisé), et il y a un personnage qui s’appelle Horselover Fat. Le narrateur l’explique très bien, ce personnage, dit-il, c’est moi mais je préfère en parler à la 3e personne. Et il n’y a en effet aucun doute sur l’identité de ce Horselover Fat, car il s’agit d’une traduction rigolote, humoristique, du nom Philip K. Dick. Comment ? Parce que Philippe, étymologiquement en grec ancien, c’est Phil- et Hippe, « hippe » : le cheval, comme dans hippodrome, hippomobile, hippique. Philippe : celui qui aime les chevaux, c’est-à-dire en anglais donc « Horselover » : celui qui aime les chevaux. Et Dick, il le traduit par Fat parce que « dick » veut dire gros en allemand.
Donc, il y a un auteur qui est Philip K. Dick, qui écrit un livre où il est dit qu’il y a un personnage qui est Philip K. Dick, dont parlera le narrateur, mais le narrateur nous explique qu’il ne dira pas « je » pour Philip K. Dick : il l’appellera de ce nom bidon, « Horselover Fat » qui représente Philip K. Dick. Et, je vous l’ai signalé : on est dans un contexte où cette personne, Philip K. Dick, est considérée comme timbrée par sa compagne, par tous ses amis, etc. Et là, dans ce livre écrit à cette époque-là, il y a donc ce personnage de Philip K. Dick mis en scène, qui est effectivement un timbré, et le narrateur dit de lui, c’est écrit en page 17 de VALIS : « Horselover Fat glissait par degrés dans la folie. J’aurais souhaité pouvoir l’aider ». Et il y a des analyses, absolument comme d’un médecin légiste, comme d’un psychiatre légiste expliquant pourquoi ce type est fou. Il explique qu’il a cramé son cerveau en prenant trop de drogues à une époque : « Une question à laquelle nous avons dû apprendre à faire face pendant la décennie de la drogue était : « Comment annoncer à quelqu’un que son cerveau est cuit ? » La question était maintenant passée dans le monde théologique de Horselover Fat comme un problème à résoudre par nous, ses amis. Il aurait été simple de relier les deux dans le cas de Fat : la drogue qu’il a consommée pendant les années 60 lui a cramé la tête dans les années 70 » (page 31).
Il décrit la schizophrénie du personnage. Et sa double personnalité, elle est là, ou même la triple, puisqu’il y a un narrateur qui explique qui est ce Philip K. Dick et qui décrit dans ce livre, sous le nom de « Horselover Fat », le personnage cinglé que son entourage connaît. Mais en retrait, il y a un autre personnage qui lui n’est pas timbré du tout, qui est plutôt, je dirais, du côté d’un psychothérapeute, d’un psychanalyste, d’un psychiatre, qui explique ce personnage-là (Philip K. Dick fou).
Et pour revenir à la conférence de 1977 à Metz, on comprend de quoi il s’agit parce qu’il nous explique le cadre : la série des films « La Matrice » est directement inspirée non pas d’un roman de Philip K. Dick mais de ce qu’il dit dans cette conférence de 1977. Il faut dire qu’il parlait de ce genre de choses ailleurs aussi car il a écrit un gros bouquin, mais alors carrément gros : un bouquin de 8.000 pages qu’il appelle « Exégèse » où il réfléchit à qui nous sommes. On pourrait dire que c’est un véritable ouvrage de théologie. Par ailleurs, les derniers romans comme ce VALIS (1981), mais aussi La transmigration de Timothy Archer (1982), qui est la vraie vie d’un certain James Pike, un évêque dans l’église épiscopalienne et qui a été accusé d’hérésie.
Ses derniers romans, ce n’est pas de la science-fiction : c’est véritablement de la « théologie-fiction ». Ce sont des romans qui sont passionnants à lire mais, à tout moment, on nous parle de la Bible, on nous parle effectivement de la présence de Dieu : « La présence de Dieu – si elle existe – nous permet-elle de communiquer avec les morts ? ». Des choses de cet ordre-là : « C’est quoi notre destin ? » ; « Quels sont les degrés de liberté dont nous disposons à l’intérieur du monde ? » ; « Est-ce qu’on peut prendre son destin en main ? », etc., ainsi que des questions d’ordre éthique.
L’exposé de 1977 est un exposé systématique d’une religion et la description de cette religion, fondée en réalité sur une théorie physique. Tout cela est en effet tout à fait cohérent par rapport à une interprétation de la mécanique quantique par un certain Hugh Everett en 1956.
M. Hugh Everett, un Américain, rédige une thèse et publiera un article l’année suivante. Il sera quasiment recalé par l’université et il fera carrière dans la recherche de l’industrie de l’armement de pointe [PJ : je découvre qu’une firme dont j’ai été l’employé dans le domaine de la finance – American Management Systems – utilisait essentiellement des algorithmes mis au point par lui]. Il est la personne qui a proposé une interprétation de la mécanique quantique très célèbre : celle des « mondes parallèles » ou des « mondes multiples », comme on dit aussi. Cette interprétation explique un phénomène qu’on rencontre en mécanique quantique, à savoir qu’à certains moments, des particules sont dans un état de superposition : elles sont à la fois blanches et noires, disons, sans qu’on ne puisse déterminer lequel des deux. Mais, a lieu à ce moment-là ce qu’on explique comme étant un effondrement de ces états superposés, qui bifurquent entre l’un des deux états possibles. L’interprétation d’Everett c’est de nous dire : « Non, il n’y a pas de résolution sous la forme d’un effondrement de ce train d’ondes : en fait, ces deux états superposés bifurquent pour créer deux univers parallèles ». Et donc, quand on nous dit : « C’est formidable, il y a des milliards d’étoiles, c’est tellement grand, etc. », selon cette interprétation-là, il y a des univers comme ça qui sont créés à la pelle, à tout instant, à tout moment.
Et là, ce que Philip K. Dick fait, c’est qu’il explique un ensemble d’expériences mystiques qui ont été les siennes. Il parvient à l’expliquer dans ce cadre-là. Et si vous connaissez un peu le thème de ses livres, le thème des films qui ont été faits à partir de ses livres, vous savez qu’il y a souvent le personnage du « précog » : la personne ayant une connaissance anticipée. Et par exemple, dans Minority Report, ces précogs sont des créatures qui sont là dans une sorte de piscine dans un état suspendu, mais ils voient des choses qui pourraient se passer et ils sont en connexion avec la police. La police peut empêcher des crimes qui vont avoir lieu à partir de cela. Alors, ça pose tout de suite des problèmes. Si on est dans un monde déterministe, il y a un scénario et puis c’est tout. Si on n’est pas dans un monde déterministe, comment est-ce qu’on peut éventuellement faire basculer d’un parcours possible à un autre ?
Et là, dans la conférence de Metz, Philip K. Dick explique très bien comment il voit les choses dans ce cadre-là. Il dit : « Il y a un monde dans lequel nous sommes, mais en permanence, il y a d’autres mondes possibles, parallèles ». Il donne des chiffres : « Il y en a peut-être 3, il y en a peut-être 30, il y en a peut-être 3.000 » (1977 : 240), dit-il. Il y a des mondes qui sont en train de bifurquer autour du nôtre, dans lesquels nous pouvons basculer. Ce qui fait que c’est cohérent par rapport à cette idée que nous pourrions intervenir d’une certaine manière pour choisir une de ces voies possibles. Nous pourrions basculer dans l’une de ces voies.
Alors, comment est-ce que tout ça est organisé ? Eh bien, dans le cadre de ce que voit Dick, il y a un Dieu qu’il appelle aussi « Le Programmeur », qui est en train de mettre tout cela en place. Et là, ce qui est intéressant, c’est qu’il ne rejoint là pas seulement de la physique mais il rejoint de la philosophie. Il rejoint [Leibniz], il ne le mentionne pas, je ne sais pas si on a mentionné cela à son propos mais c’est tout à fait flagrant pour moi. En fait, ce qu’il défend comme point de vue, dont il dit qu’il en a eu l’expérience en particulier – il explique bien qu’il n’a pas vécu du passé, qu’il n’a pas vécu non plus de l’avenir – il explique bien que s’il y a du « déjà-vu », ce n’est pas par rapport à des choses qui se sont déjà passées : c’est parce que ces choses se passent [parallèlement] en ce moment-même : nous avons la possibilité de passer dans des mondes latéraux et quand il dit : « Le Christ dit : ‘Mon royaume n’est pas de ce monde’’, il dit, « C’est parce qu’il est sur une voie parallèle ». Et on peut se tourner alors vers ce Dieu en lui demandant de sortir du chemin qui est tout tracé. Par la prière par exemple. On peut attirer l’attention du Programmeur (1977 : 241). Et qu’est-ce qu’il a devant lui ce programmeur ? Il a la grande matrice [« Le monde-matrice, celui avec le vrai cœur d’être, est déterminé par le Programmeur » – 1977 : 240) et c’est à partir de là que le terme va être utilisé.
Donc, Dick dit ça en 1977, le terme va être utilisé en particulier dans ce film qui sera réalisé 20 ans plus tard : The Matrix. L’idée vient de là. Il y a ce grand Programmeur et ce programmeur ne joue pas seul : il y a un personnage du type de Satan qui essaye de saboter les choses en permanence, en face de lui [une contre-entité : le sombre contre-joueur – 1977 : 241). Mais, dit Dick, il ne peut arriver à rien parce que, à tout moment, ce Programmeur peut corriger [son programme]. S’il voit qu’on part vraiment dans une très mauvaise direction, il peut revenir en arrière et remettre les choses sur le droit chemin. Et Dick prend un exemple tout à fait contemporain en disant : « On a frôlé la catastrophe avec Nixon : on pouvait tomber dans un état autoritaire et là Dieu : le Programmeur, a fait un petit pas en arrière : il est allé dans la matrice et il a modifié les choses ».
C’est-à-dire qu’en fait, Dieu s’arrange à tout moment pour qu’on soit dans le meilleur des mondes possibles. Ça rejoint exactement l’idée de Leibniz (1646-1716) qu’il y a des tas de mondes possibles mais que nous sommes dans le meilleur de tous. Et vous le savez bien entendu, Voltaire se moque de lui en présentant un héros dans son roman Candide, un héros qui à tout moment s’émerveille, même devant le fait qu’il est à Lisbonne au moment du grand tremblement de terre, en disant : « Ah, ça aurait pu être bien pire ! », etc.
Et le titre de la conférence de Philip K. Dick à Metz, c’est : « Si vous trouvez que ce monde est mauvais, attendez de voir certains autres », voilà. Ce qu’il nous dit, c’est que ça n’a pas l’air très bien notre monde, mais réfléchissons au fait qu’il y a sans arrêt des rétablissements qui interviennent et là, en fait – et c’est mentionné quelque part sur Wikipédia – moi, j’avais proposé une interprétation de ce type-là à propos des mondes parallèles mais qui était d’un ordre un petit peu différent : ce que je disais moi, c’est dans un article qui est paru autour de 2000 [« Pourquoi nous avons neuf vies comme le chats »], c’était la chose suivante : c’est que, s’il y a vraiment des mondes parallèles, si l’interprétation d’Everett de la mécanique quantique est vraie, est la bonne, à ce moment-là, nous n’arrêtons pas, nous, de devoir choisir mais évidemment pas « choisir » : nous sommes entraînés d’un côté ou d’un autre. « Un » principe de choix qui n’est pas « notre » principe de choix. Mais c’est la chose suivante, c’est que si nous sommes dans un grand nombre de mondes et que, par exemple, il y a peut-être disons, 225 possibilités. Dans 224 de ces possibilités, nous mourons d’une manière ou d’une autre et dans la 225ème non, on échappe à [la catastrophe]. Dans quel monde allons-nous continuer à vivre ? Eh bien, l’explication est très simple. Comme le sentiment que nous vivons est attaché au fait que … nous sommes en vie, dans les 224 mondes où nous disparaissons, il ne se passe absolument rien pour nous : nous continuons pépère dans le 225ème où nous nous sortons indemne de choses extraordinaires, échappant à tout ce qui aurait pu nous arriver.
Pourquoi est-ce que nous sommes tous en vie alors qu’en 1962, on a été à 1 mm d’une guerre thermonucléaire ? Eh bien, simplement, peut-être que dans des millions de mondes parallèles, nous sommes tous morts dans une guerre thermonucléaire mais il y en a un, il y a une possibilité que M. Khrouchtchev et M. Kennedy disent : « Bon, allez, on laisse tomber et on continue comme ça ! », et nous sommes nécessairement dans celui-là puisque c’est dans celui-là que nous avons survécu.
Donc, mon interprétation – ça a paru dans les Cahiers du Collège International de Philosophie – ce n’est pas la même que Philip K. Dick, mais on pourrait considérer que si [les mondes parallèles] c’est vraiment l’explication, alors chacun peut venir avec son interprétation de la manière dont ça marche [dans le détail] et il est possible d’expliquer ça de manière un peu différente.
Et donc, Philip K. Dick, pourquoi est-ce qu’il parle de ça quand les gens s’attendent quand même à ce qu’il parle de ses récits de science-fiction ? Il dit : « Tout ce que j’ai écrit, ce n’est pas de la fiction : c’est des choses que j’ai expérimentées, que j’ai vécues véritablement, mais pas dans le passé, pas en étant emmené sur une autre planète : ce sont des choses qui se passent en simultanéité et que je peux raconter. Et quand je vous raconte Le maître du haut-château, quand je vous explique que c’est un monde où les États-Unis et les puissances occidentales alliées ont perdu contre les puissances de l’Axe, contre l’Allemagne et le Japon, c’est une expérience que j’ai vécue à un moment donné dans ma vie. C’était le mauvais scénario. Je me suis trouvé dans ce scénario que Dieu, le Programmeur, a corrigé. Même chose quand, dans mon roman Flow My Tears, the Policeman Said, ‘Coulent mes larmes, le policier dit’, ce monde totalitaire, c’est celui où Nixon n’a pas démissionné et je n’invente rien, ce n’est pas de la fiction : ce sont des choses que je décris à partir de l’expérience que j’ai vécue ».
Il n’explique pas pourquoi il a lui eu cette possibilité de vivre dans ces mondes tangents qui sont là, à côté du nôtre, qui sont des alternatives. Il le laisse entendre : c’est son expérience de la drogue qui lui permet de faire ce genre de choses, la même expérience de la drogue qui fait que ses amis et ses compagnes considèrent qu’il a le cerveau cramé, que le type est complètement parti.
Alors, vous voyez : tous ces éléments, bon, d’abord, ça nous fait d’excellents romans, d’excellentes histoires. Ça nous a fait d’excellents films. Total Recall, on nous en fait un remake. Blade Runner, on nous en fait un remake, c’est-à-dire que quand on a fini de les voir, quelque temps plus tard, on nous refait une autre histoire là-dessus + le thème de la Matrice.
Le thème de la Matrice, c’est un thème qu’on appelle « The Tunnel Under the World » et ça, c’est parce que la première histoire qui raconte ça – j’aurais dû penser à amener le petit livre à côté de moi – la première histoire qui raconte ça, c’est une nouvelle de 1955 [de Frederik Pohl]. C’est la première fois qu’on a, dans la science-fiction, ce thème d’un bonhomme qui ne comprend absolument pas ce qui lui arrive : il a l’impression d’être un peu dans un jour sans fin, qu’il est tout le temps dans la même histoire. Et il finit par se rendre compte qu’il y a des coulisses, et ces coulisses lui font comprendre qu’en fait, il est à l’intérieur d’une maquette. Il est dans une maquette et il y a quelque chose qui est programmé. Et ce couloir sur lequel il débouche, qui montre qu’il y a des coulisses, ce thème est repris bien entendu dans les films de la Matrice : on est là dans la rue, etc., il se passe plein de trucs, et tout à coup, ils ouvrent une porte et ils sont dans un couloir, dans un immense couloir. On est du côté de la Matrice : on est du côté de ce que fait le Grand Programmeur qui est en train, voilà, d’essayer d’arranger les choses. Il a cet ennemi en face. Il a ce type qui est un peu dégueulasse, qui est du côté de la souffrance et tout ça et Dieu, le Programmeur, essaye de nous mener dans la bonne direction, quitte à même revenir parfois en arrière pour réécrire un peu le scénario en voyant que ça tourne très très mal, voilà.
Alors, c’est une petite plaisanterie de ma part mais il y a peut-être davantage de vrai là-dedans que ne pouvaient l’imaginer les gens qui, en 1977, sont là, absolument sidérés, qui viennent écouter un auteur de science-fiction et ce type termine son truc en disant : « Je ne suis pas un auteur de science-fiction : je suis un prophète. Je suis un prophète qui vous explique comment les choses sont exactement en train de se passer, qui vous donne la véritable explication de ce qui se passe ».
Et vous le savez peut-être, parmi les grands fanas du transhumanisme, M. Kurzweil, M. Elon Musk, M. Bostrom qui a ce centre à l’Université d’Oxford sur l’avenir du monde, tous ces gens-là sont des gens qui disent en privé : « Nous croyons à l’histoire de la programmation. Nous croyons que nous sommes à l’intérieur d’un grand machin numérique ». Ils ne se prononcent pas nécessairement sur la qualité du programmeur mais il y a des gens qui croient déjà à cette religion-là et ce sont des gens qui ont beaucoup d’argent et qui ont beaucoup de projets en cours. Est-ce qu’ils reçoivent des instructions de manière directe, comme c’était le cas de Philip K. Dick, sous forme de faisceaux, un genre de réseau laser, une grande lumière rose qui vient lui dire des choses de temps à autre ? Je ne sais pas. Je vous laisse là-dessus.
Allez, à bientôt !
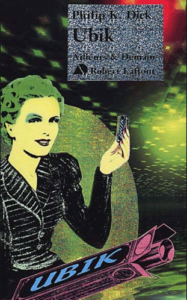
Répondre à juannessy Annuler la réponse