Retranscription de Et pendant ce temps-là… P vs. NP, le 28 mars 2022.
Bonjour, nous sommes le lundi 28 mars 2022. J’appellerai ça : « Et pendant ce temps-là… P vs. NP ». Alors, pourquoi « Et pendant ce temps-là » ? Parce que, à très juste titre, notre attention est attirée essentiellement par l’invasion de l’Ukraine par la Russie et donc, on se sent un petit peu obligé de s’excuser quand on parle de choses peut-être pas frivoles mais de choses moins essentielles dans le cadre de l’actualité. Mais le fait est que vous êtes un certain nombre à m’envoyer des mails ou à faire des remarques, des commentaires sur mon blog en disant : « Où en êtes-vous dans cette question de P vs. NP puisque vous nous avez expliqué, il y a un peu plus d’un an, que vous vous y atteliez ? » Voilà. J’ai dit à un certain moment que j’étais proche d’un résultat satisfaisant.
Alors, pourquoi est-ce que ça traîne ? Pourquoi est-ce que je ne montre rien du tout ? Pour la raison que je vais expliquer. J’ai changé un peu de cap dans la manière d’aborder les choses. Pourquoi est-ce que j’ai changé de cap dans la manière d’aborder les choses ? Eh bien, parce que, dans un cas particulier, celui de la démonstration par Gödel de son théorème sur l’incomplétude de l’arithmétique, j’avais adopté l’attitude suivante, c’est-à-dire que j’avais, en tant qu’anthropologue, historien des sciences, spécialiste de l’épistémologie, je m’étais contenté de relever dans la démonstration par Gödel un certain nombre d’anomalies, d’erreurs, de naïvetés et j’en avais fait un texte qui avait paru à la fin des années 1990 et qui, ensuite, a été repris dans mon ouvrage qui s’appelle « Comment la vérité et réalité furent inventées » publié en 2009 chez Gallimard.
Et là, il y a eu un dialogue avec les mathématiciens. J’ai été invité en particulier à l’Ecole Normale Supérieure par Jean Lassègue. J’ai eu l’occasion de discuter avec Giuseppe Longo, un certain nombre de spécialistes de ces questions et là, on était restés un peu sur ses positions parce que je ne parlais pas assez le langage des mathématiciens. Je parlais le langage de gens qui sont en extériorité aux mathématiques et qui regardent ce que font les mathématiciens. Et la raison pour laquelle j’avais fait ça, c’était pourquoi en fait je m’étais lancé dans un examen de la démonstration par Gödel de son théorème, c’était la chose suivante : c’était parce que avait paru en 1997 un ouvrage de Sokal et Bricmont qui s’appelait « Impostures intellectuelles » où ces scientifiques se moquaient avec énormément de superbe de la manière dont les gens des sciences humaines, les philosophes, parlent de mathématiques, faisant, disaient-ils, énormément d’horreurs, d’erreurs qui sont autant d’horreurs.
[Alan] Sokal, je vous le rappelle, à l’époque, avait publié un texte qui était effectivement une totale imposture dans une revue de ce qu’on appelle cultural studies aux États-Unis mais qui sont des réflexions souvent effectivement extrêmement peu fondées de gens d’inspiration philosophique ou, en général, des gens qui viennent d’études de la littérature et qui produisent, je dirais, de la « non-pensée ».
Critiquer ça, ce n’était pas une mauvaise chose mais dans le sac de Sokal et Bricmont, ils s’en prenaient, en fait, je dirais, à des tas de gens tout à fait honorables dans les sciences humaines et, en particulier, à la suite de cet ouvrage de Sokal et Bricmont avait paru un ouvrage de Jacques Bouveresse, Bouveresse pour lequel j’ai beaucoup de respect par ailleurs. C’est un très très bon… Il est mort maintenant, quelqu’un qui a étudié Wittgenstein avec énormément d’attention. J’ai eu la chance un jour de lui être présenté non pas du tout au titre de chercheur en sciences humaines mais parce que je travaillais, dans le cadre de la banque, pour un patron qui était le frère du philosophe Bouveresse.
Et là, Bouveresse avait fait quelque chose que je trouvais extrêmement critiquable, c’est-à-dire qu’il s’en était pris à Régis Debray parce que Régis Debray avait fait une métaphore à partir de l’idée d’incomplétude, de montrer que les questions de religion ne sont pas intégrables véritablement à nos réflexions de type politique [Prodiges et vertiges de l’analogie (1999)]. Bon, la pensée, la réflexion de Régis Debray était tout à fait honorable et la critique de Bouveresse me paraissait médiocre et, en tout cas, tout à fait inappropriée.
Et là, ça avait provoqué chez moi une sorte de, comment dire, d’esprit de revanche, voilà, d’esprit de revanche parce que je connaissais pas mal les mathématiques et je savais que, pour ce qui était de la qualité des démonstrations de certains théorèmes, les mathématiciens n’avaient pas de leçons à donner à des chercheurs en sciences humaines qui, souvent, sont extrêmement pointilleux quand ils parlent précisément de méthodes dures comme les mathématiques, la physique, etc., font extrêmement attention. Et du coup, j’étais allé un peu fouiller dans cette démonstration par Gödel de son théorème parce qu’il est considéré comme un monument des mathématiques. Et là, plus je creusais, plus j’étais consterné parce qu’il y avait vraiment du n’importe quoi là-dedans : on se moquait du monde. On se moquait du monde et l’image qui m’était venue, c’était celle d’une vieille BD. C’était une aventure de Spirou et Fantasio. Je ne sais plus comment ça s’appelle, « Spirou et le robot » peut-être [« Radar le robot »], où il a un savant fou qui veut mettre le feu à l’atmosphère et sa bombe finit – qui est une espèce de capsule pendue à une montgolfière – finit par s’écraser dans un champ et au moment où Spirou et Fantasio – et Spip – s’approchent de ça, ils s’aperçoivent qu’en fait, à l’intérieur de ça, c’est simplement un amas de détritus, c’est un amas de boîtes de conserves éventrées, etc. Et j’avais la même impression en allant fouiller dans le théorème de Gödel.
J’étais un petit peu averti. J’étais averti pour deux raisons : d’abord parce que j’avais eu comme professeur de logique à Bruxelles Chaïm Perelman qui avait été un très grand critique de la démonstration de Gödel en 1936, quand son théorème avait paru, et également j’avais été à Paris, à l’Ecole Pratique des Hautes Études, j’avais été un élève de Guilbaud et Guilbaud, lui aussi, le mathématicien, Georges Théodule Guilbaud avait été extrêmement critique de la démonstration de Gödel et donc, j’avais deux maîtres que je respecte énormément qui eux-mêmes avaient émis des doutes à ce moment-là. Donc je me sentais, je dirais, un petit peu assuré dans ce que j’allais faire.
Par ailleurs, j’avais fréquenté Braithwaite, Richard Braithwaite. Je l’avais fréquenté au séminaire d’histoire et de philosophie des sciences à Cambridge pendant pas mal d’années. C’était un très vieux monsieur et j’avais le plaisir de l’entendre faire des commentaires sur l’histoire et la philosophie des sciences et c’est la personne qui a fait une remarquable introduction à la démonstration de Gödel dans un petit livre.
Donc, bon, je n’étais pas, je dirais, en terrain… Je ne m’avançais pas à découvert, sans armes, mais qu’est-ce que j’ai fait finalement ? J’ai fait une critique de ce que faisait Gödel qui était de fait inaudible aux mathématiciens, voilà. Je parlais dans un langage qui n’était pas véritablement le leur.
Alors, ces jours-ci, je me suis très rapproché d’avoir fait la même chose avec P vs. NP, c’est-à-dire une explication qui intéresserait sûrement les gens des sciences humaines, les philosophes, les épistémologues en particulier, les historiens des sciences en particulier, mais qui n’intéresserait pas les mathématiciens, qui diraient : « De quoi ça parle ? »
C’est pour ça que, là, j’ai changé de cap. Je me suis dit : je vais faire une démonstration qui sera telle qu’elle convaincra tout le monde, y compris les mathématiciens. Et pour faire cela – bon, je ne vais pas entrer dans les détails, je donnerai les détails quand ce sera terminé – il y a une chose à faire, c’est que les mathématiciens ont pris l’habitude de faire un certain nombre de choses, leurs mathématiques, et puis d’introduire à l’intérieur de leur raisonnement mathématique (ou comme des commentaires en extériorité), des considérations qu’ils appellent « métamathématiques ». Ils ont le sentiment qu’il s’agit d’autre chose mais voilà. Alors, on nous dit « sémantique » et « syntaxe », on nous dit « langage objet » / « métalangage ». On emploie quelques termes comme ça pour faire savoir qu’effectivement, on est conscient qu’il y a des considérations autres, d’un autre type, d’une autre nature que les considérations purement mathématiques, mais on en reste là.
Alors, pour faire comprendre aux mathématiciens ce qui ne marche pas dans P vs. NP, il faut descendre dans ce grand sac qu’eux appellent « considérations métamathématiques » et il faut montrer ce que c’est. Il faut montrer ce que c’est et, en particulier, que c’est essentiellement des considérations en fait de physique qui sont importées – et j’emploie l’expression de « passager clandestin » -, de la physique qui est importée comme passager clandestin dans le raisonnement mathématique. Par ailleurs, il y a des choses encore plus étonnantes. Par exemple, dans l’« oracle » dont parle Turing, là, c’est mettre entre parenthèses, je dirais, un certain nombre de problèmes en les renvoyant à des considérations d’ordre purement pratique ou de manière très indirecte aux rapports entre les mathématiques et la physique. Il y a aussi l’évocation purement et simplement de l’argument d’autorité dans la démonstration de Gödel, de dire : « Les choses sont comme ça puisque c’est moi qui le dis », ce qui pourrait être considéré véritablement comme des horreurs quand on essaye de faire quelque chose, je dirais, de rigoureux d’ordre mathématique.
Alors, c’est ça que je suis en train de faire : je mets au point cette boîte à outils où je décompose entièrement – enfin, je vais essayer de le faire – ce que les mathématiciens appellent des considérations « métamathématiques » et de séparer clairement cela d’autres choses.
Dans le cas de P vs. NP, il y a encore une autre dimension, c’est qu’il y a des considérations d’ordre pratique purement et simplement qui sont importées à l’intérieur de démonstrations mathématiques. Pourquoi ? Parce qu’il s’agit de soucis qui nous viennent des informaticiens, et c’est pour ça que vous trouvez des choses très très curieuses auxquelles on fait allusion à propos de deux théorèmes reliés à P vs. NP : « calculer cela prendrait un temps qui représenterait 14 fois la durée de l’univers », « compter ce nombre de choses, ce serait obtenir un nombre plus grand que les particules dans l’univers », des tas de considérations qui paraissent tout à fait, je dirais, hors de propos à l’intérieur d’une démonstration mathématique mais la justification est qu’il s’agit de considérations d’informaticiens qui ont des problèmes, effectivement, de savoir si on pourra faire des choses dans un temps raisonnable.
Tout ça est mélangé à l’intérieur de P vs. NP : des renvois au monde empirique sans le dire véritablement, faire ce que j’avais appelé dans « Comment la vérité et la réalité ont été inventés », j’avais appelé cela de la « physique virtuelle ». Il y a de la physique virtuelle absolument partout + des considérations d’ordre pratique + encore parfois même, je dirais, le simple recours à l’argument d’autorité du mathématicien qui dit : « Puisque je vous le dis, ça doit être comme ça ». Pourquoi s’autorise-t-il à dire des choses de cet ordre-là ? C’est parce qu’il est convaincu, dans une perspective platonicienne, qu’il n’y a pas de véritable différence entre la physique et les mathématiques et que, donc, tous les arguments sont bons pour prouver ce qu’il entend prouver. C’était le cas en particulier de Gödel. C’est pour cela qu’il y a tant, je dirais, de bourdes et de naïvetés, d’erreurs ici et là dans le théorème, dans la démonstration par Gödel de son théorème, parce que, comme il considère qu’il travaille dans un univers qui est à la fois physique et mathématique, on peut faire appel à ceci, faire appel à cela et pourquoi pas, puisque moi-même qui suis le mathématicien, j’appartiens au monde physique d’une certaine manière, je fais partie de cela.
Là, une petite remarque, justement, qui irait un peu dans le sens d’une justification de l’argument de Sokal et Bricmont : quand Lévi-Strauss vous dit – et ça, c’est véritablement, je dirais, peut-être la chose la plus faible qu’il ait jamais pu dire [je cite de mémoire] : « On me dit qu’il y a des erreurs dans la manière dont je rapporte certains mythes amérindiens mais comme c’est moi aussi, un être humain, qui en parle, eh bien, cela ne fait aucune différence : cela reflète de toute manière l’esprit humain ». Ça, je dirais, ça c’est l’ « esprit de Gödel » manifestement qui a imprégné les sciences humaines et qui a fait dire à des grands savants des sciences humaines des choses qui sont tout à fait inacceptables en termes d’épistémologie et de méthodologie d’ordre scientifique.
Voilà, un petit point sur cette question que vous vous posez, quelques-uns d’entre vous : « Où en est-il dans cette affaire ? ». Je vous tiens, je continue de vous tenir au courant.
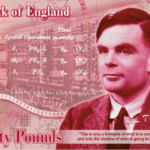
Laisser un commentaire