Les conditions d’une autre histoire de l’anthropologie
A paru dans les notes de mon cours Encyclopédie de l’ethnologie et histoire des doctrines ethnologiques publiées aux Presses Universitaires de Bruxelles en 1979, pp. 4-8.
Comme on s’en doute, les véritables révolutions dans l’histoire de l’anthropologie sont rares. Pour citer quelques noms : Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), Paul Broca (1824-1880), Bronislaw Malinowski (1884-1942), Claude Lévi-Strauss (1908-2009), par exemple. Et ce serait une illusion d’imaginer que tous les membres d’une école anthropologique (l’évolutionnisme, le diffusionnisme, le fonctionnalisme, le structuralisme) affirment le contraire de ce qu’avançaient les membres de l’école dominante précédente. En fait, les dissensions ne portent jamais que sur ce qui, avec le recul, nous apparaît le plus souvent comme des points de détail. Par exemple, les diffusionnistes introduisent le mécanisme de l’emprunt qui permet de rendre compte de quelques anomalies dans la chronologie que les évolutionnistes tentaient d’établir.
Peut-être faudrait-il même disloquer ce partage en écoles.
- Stocking (1974) parvient à distinguer, pour l’évolutionnisme, neuf dimensions sur lesquelles les évolutionnistes pouvaient s’opposer entre eux. Il est donc indispensable d’éclater ainsi le message prétendument unitaire d’une école. Si l’on distingue les options ouvertes au sein d’une école, par exemple, sur le plan politique, dans la conception que les auteurs se font de l’histoire, leur attitude vis-à-vis de la religion, etc., on pourra alors caractériser une œuvre comme « faisceau de traits distinctifs », ce qui sera plus éclairant que de l’identifier purement et simplement au nom de son auteur.
- Il faut clairement distinguer les dimensions implicites que l’historien de l’anthropologie parvient à dégager, des intentions explicites qu’avait l’auteur en écrivant son œuvre et qu’il ne conviendrait pas de négliger puisque ce sont des intentions qui ont donné la forme qu’elle a à leur œuvre. Par exemple, Richard Cull et T.S. Prideaux sont deux anthropologues anglais du milieu du XIXe siècle que nous aurions bien du mal à distinguer, pourtant ils étaient par ailleurs les défenseurs de deux positions opposées en phrénologie et n’arrêtaient pas de polémiquer dans les colonnes du Phrenological Journal ; nous avons ainsi l’attention attirée sur ce qui pouvait les opposer dans leurs conceptions de l’anthropologie.
- Il faut distinguer les diverses options nationales. Le sens politique qu’avaient, dans leur pays respectif, les opinions des diffusionnistes anglais, américains, et allemands, était tout à fait différent. Le diffusionnisme anglais offrait une certaine justification historique à l’Empire britannique en mettant en évidence une sorte de continuité culturelle allant de l’Égypte à l’Australie ; les diffusionnistes américains parvenaient à reconstruire toute l’histoire des sociétés amérindiennes pour lesquelles le grand modèle historique évolutionniste n’avait pas beaucoup de sens ; les diffusionnistes allemands s’efforçaient d’attribuer une identité propre à chaque Culture, une tâche de rationalisation fondamentale pour la justification du Reich. De même, on ne pourrait rien comprendre à l’anthropologie française au début du XXe siècle si l’on oubliait l’objectif de Durkheim : fonder une morale laïque. Ou si l’on négligeait de voir le fondement que le fonctionnalisme apportait à une administration coloniale rationnelle.
- Il convient aussi de distinguer les modèles empruntés à d’autres domaines et leur fonctionnement à l’intérieur de l’anthropologie. Par exemple, l’évolutionnisme de la fin du XIXe siècle sera à la fois le produit de l’évolutionnisme du XIXe, de Turgot et de Condorcet, de l’évolutionnisme social de Spencer, et de l’évolutionnisme biologique de Darwin. Chez Tylor, l’influence de Spencer sera plus sensible, chez Huxley, celle de Darwin.
- Il faut aussi déterminer le type de contraintes impliquées par des options particulières. Un bon exemple est celui des contraintes démographiques différentes qu’impliquent les modèles évolutionniste, diffusionniste et hyper-diffusionniste – que Voget désigne du terme plus exact de « migrationniste » (1975 : 343).
La thèse évolutionniste qui implique la découverte indépendante des principales institutions humaines en de nombreux endroits de la terre présuppose un monde très peu peuplé où les contacts entre diverses populations sont inexistants ; la thèse diffusionniste qui reconnaît comme mécanisme principal de l’évolution culturelle, l’emprunt, exige un monde peu peuplé où les diverses populations sont en contact suffisant pour permettre cet emprunt ; quant à la thèse migrationniste, elle demande un monde pratiquement surpeuplé où le déplacement d’une population provoque « en dominos » le déplacement d’une multitude d’autres. En fait, chaque modèle a sa logique et il n’est pas impossible que chacun rende compte de façon satisfaisante d’un moment particulier de l’histoire de l’humanité.
Mais il y a peut-être encore des raisons plus fondamentales que remettre en cause la notion d’« école ». Raisons que l’on peut illustrer d’exemples en sens opposés.
Remarquons d’abord que les termes qui servent de dénomination aux différentes écoles ont généralement été forgés dans le feu de la polémique aux seules fins de discréditer un adversaire, et qu’il est dès lors aventureux de recourir à ces termes sans un travail préalable. En fait, les écoles recouvrent des ensembles polythétiques de moments dans la pensée d’anthropologues particuliers. Ces moments pouvant être connectés en un réseau de ressemblances en série, sans que rien ne garantisse pour autant que les terminaisons partagent aucune propriété. En d’autres termes, s’il est sans doute possible d’organiser l’ensemble des auteurs regroupés jusqu’ici sous un nom d’école de façon à mettre en évidence leurs points communs, il n’est pas certain pour autant qu’entre deux de ces auteurs pris au hasard, il soit possible de découvrir une communauté de pensée.
Mon premier exemple montre l’aspect dévastateur d’une confiance aveugle dans la notion d’école. Au milieu des années 1960, un débat réunit dans les colonnes de la revue Current Anthropology quelques anthropologues – et non des moindres, puisque les participants au débat étaient Edwin Ardener (1927-1987), John Beattie (1915-1990), Ernest Gellner (1925-1995), Ian Jarvie (1937- …) et Edmund Leach (1910-1989) – autour de l’étrange filiation intellectuelle entre le mythologue James Frazer (1854-1943) et Malinowski. La discussion s’articula autour de la question : Malinowski était-il évolutionniste ? En fait, tout se passait comme si les participants au débat envisageaient une réelle symétrie des points de vue, à savoir que si les diffusionnistes affirment effectivement le contraire de ce qu’avancent les évolutionnistes, alors, tout adversaire des diffusionnistes doit, d’une certaine manière, être évolutionniste. Dans la mesure où les points de litige entre évolutionnistes et diffusionnistes nous apparaissent aujourd’hui accessoires, une telle arithmétique ne devrait pas nous séduire. Bien sûr, la confusion ne date pas d’aujourd’hui, et Malinowski lui-même n’a-t-il pas tendu le piège où tombent ses commentateurs actuels ? Dans la préface de la troisième édition de The Sexual Life of Savages in North-Western Melanesia (1932 : xxii-xxiii), où il explique pourquoi il a cessé d’être évolutionniste, ne confond-il pas sous le nom d’évolutionnisme deux notions, l’une à laquelle il continue manifestement de souscrire : la croyance dans un progrès continu de l’humanité depuis ses origines, l’autre qui a cessé de le toucher : l’intérêt purement intellectuel pour l’origine des grandes institutions, telles la famille, la propriété et l’État ?
Le deuxième exemple montre, à l’opposé, comment un rapprochement qui transcende le partage de la pensée anthropologique en écoles peut se révéler fécond. Rien n’encourage a priori un rapprochement entre l’œuvre de Claude Lévi-Strauss et celle des hyper-diffusionnistes anglais. Ackerknecht a fait remarquer que les sciences de l’homme se sont constituées au XIXe siècle sur le modèle de ce qui tenait lieu alors de science vedette : l’anatomie comparée (1954 : 118). L’ambition de constituer une physiologie sociale n’apparaîtra que plus tard, avec Durkheim. Les hyper-diffusionnistes (« migrationnistes ») : Elliot Smith, Perry et Rivers après sa conversion de 1911, appartiennent à cette première époque, dont ils seront les derniers représentants, plus exactement, ils complètent une démarche apparentée à l’anatomie comparée par l’ambition de constituer l’équivalent d’une embryologie dans le domaine des sociétés humaines. Lévi-Strauss, quant à lui, est sans nul doute un physiologiste, qui s’efforce de dégager les principes de cohérence interne des systèmes symboliques. On connaît la thèse centrale du migrationnisme : la civilisation serait née dans l’ancienne Égypte puis se serait répandue à la faveur de migrations et d’emprunts entre peuples contigus ; il s’agit d’une variante de la théorie de l’Atlantide a fait remarquer le fonctionnaliste Radcliffe-Brown pour qui les préoccupations des migrationnistes relevaient d’une autre époque (1958 [1931] : 53).
Plusieurs éléments contingents sont intervenus dans la naissance de la théorie migrationniste, le premier est la parfaite connaissance de l’Égypte ancienne par l’initiateur du mouvement, Grafton Elliot Smith. Il fut en effet professeur d’anatomie au Caire, et c’est lui qui introduisit l’examen radiographique des momies comme technique archéologique (Todd 1937 : 525). Le deuxième élément contingent fut la découverte de la tombe de Tout-ankh-Amon en 1922 ; cet évènement fortuit qui suscita un grand enthousiasme dans l’opinion fournit sans doute à la théorie migrationniste ce supplément de crédit qui autorisa un « décollage » sinon problématique. D’autres éléments, purement théoriques ceux-là, intervinrent toutefois dans la genèse de la thèse migrationniste. La notion d’« invention indépendante » chère aux évolutionnistes fut soumise à la critique. On sait que pour ceux-ci, l’« unité psychique » de l’humanité permettait à des petits groupes isolés de faire séparément les grandes inventions de l’humanité, et de parcourir ainsi, chacun pour son compte, la route du progrès, seule la vitesse de développement variant d’une société à l’autre. Les migrationnistes constatèrent que les grandes inventions, de l’agriculture à la métallurgie, requéraient le concours de circonstances fortuites difficiles à réunir, et jugèrent qu’il était plus conforme à la raison d’imaginer que les grandes inventions ne s’étaient faites qu’une fois, pour se répandre ensuite à la surface du globe. Autre accent discordant des migrationnistes, l’accent mis sur la stagnation possible des civilisations, et sur leur éventuelle décadence, position inévitable pour des anthropologues qui centraient leur attention sur l’Égypte ancienne. En fait, comme l’a très bien noté Voget, Elliot Smith avait compris la leçon de l’histoire européenne et avait retenu les migrations, le commerce et les guerres de conquête comme principes du développement des civilisations (Voget 1975 : 343).
Si l’on se tourne maintenant vers Lévi-Strauss en gardant à l’esprit ce que je viens de dire, on s’étonnera d’abord du ton très migrationniste de certains passages de son œuvre, je pense en particulier au vingt-quatrième chapitre de Tristes Tropiques intitulé Le Monde perdu (1955 : 281-293). On constatera ensuite que la thèse migrationniste du caractère improbable de la reproduction des grandes inventions trouve plus d’un écho chez Lévi-Strauss. Dans un texte originellement publié en 1952 et remanié en 1973, intitulé Race et histoire, Lévi-Strauss envisage l’improbable concours de circonstances qui a dû présider à l’invention de la poterie ; je me contente de vous en rappeler la conclusion : « Toutes ces opérations sont beaucoup trop nombreuses et trop complexes pour que le hasard puisse en rendre compte. Chacune d’elles, prise isolément, ne signifie rien, et c’est leur combinaison imaginée, voulue, cherchée et expérimentée, qui seule permet leur réussite. Le hasard existe sans doute, mais ne donne par lui-même aucun résultat » (1973 : 406). Ce qu’il propose alors, c’est une interprétation probabiliste de l’histoire, où le progrès technique résulte de l’apparition de séries favorables d’une configuration déterminée. Dans de telles conditions, de fortes densités démographiques locales permettent à des populations voisines en contact, de jouer, en quelque sorte, en coalition, et de participer, je cite « à l’élaboration – le plus souvent involontaire – d’une commune stratégie » (1973 : 414). Ainsi s’explique la moindre capacité d’invention des sociétés solitaires ou entourées de voisines aux techniques peu diversifiées, comme ce fut le cas des sociétés du Nouveau Monde : « A côté d’étonnantes réussites, les civilisations précolombiennes sont pleines de lacunes, elles ont, si l’on peut dire, des « trous ». Elles offrent aussi le spectacle, moins contradictoire qu’il ne semble, de la coexistence de formes précoces et de formes abortives. Leur organisation peu souple et faiblement diversifiée explique vraisemblablement leur effondrement devant une poignée de conquérants. Et la cause profonde peut en être cherchée dans le fait que la « coalition » culturelle américaine était établie entre des partenaires moins différents entre eux que ne l’étaient ceux de l’Ancien Monde » (1973 : 415). Voici parfaitement décrit le mécanisme que postulait Rivers dans son article « The Contact of Peoples », sans pouvoir le décrire, il lui aurait permis de rendre compte de la coexistence de coutumes funéraires complexes et d’une culture matérielle fruste chez les Aborigènes australiens sans devoir postuler une capacité à l’oubli « inégalée » chez ces populations sauvages sporadiquement visitées par des petits groupes d’immigrants civilisateurs (1913 : 482-483).
Mais il ne suffit pas de disloquer la notion d’école, il faut encore s’attaquer aux autres défauts de la proto-histoire de l’anthropologie, telle cette identification des auteurs au sein d’une école, qui fait que les étudiants confondent Maine et McLennan, toujours associés, intervertissent le couple Kardiner & Linton avec le couple Kroeber & Lowie, ou sont incapables de distinguer les fonctionnalistes anglais Firth, Forde & Fortes.
La cohérence interne d’un texte et les lois de transformation qui le lient aux autres textes de cet auteur ne doivent pas non plus cacher les rapports que ce texte entretient avec les textes contemporains, relations de congruence ou d’opposition aux autres textes anthropologiques, mais aussi les relations entretenues avec les textes contemporains hors de l’anthropologie : Stocking a ainsi montré que Matthew Arnold, un poète et littérateur contemporain d’Edward Tylor avait inventé un type d’analyse conceptuelle que les anthropologues continuent eux d’attribuer à Tylor. Et il faut se souvenir à ce propos que l’anthropologie n’a pas eu uniquement à répondre à des questions posées de l’intérieur de sa propre discipline : elle a parfois eu à répondre à des questions politiques comme l’esclavage ou la question nationale, à des questions philosophiques, ou des questions posées par des domaines connexes tels que la phrénologie, ou la sociologie.
Un intérêt tout particulier devrait être porté à ces moments privilégiés où la connaissance anthropologique a progressé plus rapidement à l’occasion de grandes controverses qui agitaient la profession, comme la question du totémisme, de la « mentalité primitive » ou des mariages prescriptifs.
Références :
Lévi-Strauss, Claude, Tristes Tropiques, Paris : Plon 1955
Lévi-Strauss, Claude, Race et histoire, Paris : Denoël-Gonthier 1974
Malinowski, Bronislaw, The Sexual Life of Savages in North-Western Melanesia, London : Routledge & Kegan Paul, 1932 (third edition)
Rivers, W.H.R., « The Contact of Peoples » [1913], in Psychology and Ethnology, London : Kegan Paul, Trench, Trubner & Co 1926, pp. 299-317
Voget, F. W., A History of Ethnology. New York : Holt, Rinehart & Winston 1975
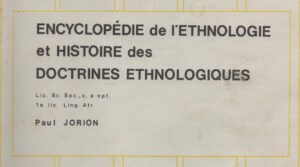
Répondre à timiota Annuler la réponse